« Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu ».
Arthur Rimbaud, Lettre du voyant
Prélude
Je me souviens qu’étant jeune, mon arrière-grand-mère, femme très pieuse, m’avait mis entre les mains des romans d’Henri Bordeaux et de Paul Bourget lesquels, justement, me tombaient des mains.
Comment pouvait-on écrire quelque chose d’aussi insipide que « La robe de laine » ?
Du coup je préférais aller fureter dans la bibliothèque de feu mon arrière-grand-père, bon viveur et mécréant. Il y avait là Montaigne, mais dans une vieille édition où les « s » étaient des « f », rendant la lecture malaisée.
Je m’étais alors rabattue sur les grands livres d’histoire estampillés Hanoteau.
Et cette année je retrouve Paul Bourget, ce qui, du coup, jette sur cette littérature française une lumière particulière.
Parcourons ensemble cet avant-propos éclairant des « Essais de psychologie contemporaine » :
« (…) le Livre devient le grand initiateur. Il n’est aucun de nous qui, descendu au fond de sa conscience, ne reconnaisse qu’il n’aurait pas été tout à fait le même s’il n’avait pas lu tel ou tel ouvrage : poème ou roman, morceau d’histoire ou de philosophie.»
Nous avions l’année dernière trouvé une idée analogue chez Balzac ; rappel :
« Aujourd’hui l’écrivain a remplacé le prêtre, il a revêtu la chlamyde des martyrs, il souffre mille maux, il prend la lumière sur l’autel et la répand au sein des peuples. Il est prince, il est mendiant. Il console, il maudit, il prophétise. Sa voix ne parcourt pas seulement la nef d’une cathédrale, elle peut quelquefois tonner d’un bout du monde à l’autre.1 »
Revenons à cette belle page de Paul Bourget :
« A cette minute précise, et tandis que j’écris cette ligne, un adolescent, que je vois, s’est accoudé sur son pupitre d’étudiant par ce beau soir d’un jour de juin. Les fleurs s’ouvrent sous la fenêtre, amoureusement. L’or tendre du soleil couché s’étend sur la ligne de l’horizon avec une délicatesse adorable. Des jeunes filles causent dans le jardin voisin. »
Donc, tout autour du jeune homme, la lumière, les parfums, les bruits et douces paroles sont autant d’invitations à quitter la sombre et sévère bibliothèque.
1 « Le prêtre catholique »
« L’adolescent est penché sur son livre, peut-être un de ceux dont il est parlé dans ces Essais. C’est les Fleurs du Mal de Baudelaire, c’est la Vie de Jésus de M. Renan, c’est la Salammbô de Flaubert, c’est le Thomas Graindorge de M. Taine, c’est le Rouge et le Noir de Beyle… »
Et ici, aucun doute, dans cette courte liste, figurent deux des livres qui ont profondément marqué l’auteur dans sa jeunesse, ceux précisément que nous étudions cette année.
« Qu’il ferait mieux de vivre ! disent les sages… Hélas ! c’est qu’il vit à cette minute, et d’une vie plus intense que s’il cueillait les fleurs parfumées, que s’il regardait le mélancolique Occident, que s’il serrait les fragiles doigts d’une des jeunes filles. »
Lire, c’est vivre, donc. Non pas dans l’acte mais dans les perspectives indéfinies qu’ouvrent les mots. Lire, c’est donner à l’avance du sens et du poids aux actes à venir, c’est s’ancrer dans la vie en faisant surgir, par la magie des pages, la trame du monde où l’on a pris place.
Et cette idée-là, nous l’avons déjà rencontrée à plusieurs reprises, sous tel aspect ou tel autre. Elle est spécifique à la littérature française. Celle-ci entretient, dès son origine, un double commerce essentiel avec la politique et avec la philosophie.
Origine, au sens fort, du reste. Ce sont les poètes de la Pléiade qui plaident pour la généralisation de la langue « françoise » ; en d’autres termes, la langue elle- même, naît symboliquement des lettres.
Et puis c’est Montaigne oeuvrant à la réconciliation nationale tandis que l’ami La Boétie réfléchit en philosophe aux mécanismes de l’asservissement 2.
Mais naturellement cette structure sous-jacente se renforce encore avec la Révolution. Elle culmine avec la composition par Victor Hugo du roman national – au sens propre – : « Les Misérables ».
Hugo intransigeant avec Napoléon III et que son exil à Guernesey a contraint à renoncer au théâtre, Hugo auquel Flaubert sert de boîte aux lettres clandestine, Hugo que nous verrons bientôt féliciter Baudelaire, non pour ses poèmes mais pour avoir encouru, avec son bouquet de Fleurs du mal, les foudres du procureur Pinard pour
« atteinte à la morale publique, à la morale religieuse et aux bonnes moeurs » sic.
Le même Pinard s’en était pris précédemment à « Madame Bovary ».
Hugo, Flaubert, Baudelaire : ces trois-là constituaient déjà implicitement un syndicat des hommes de lettres, revendiquant hautement la liberté d’écrire.
Et il y en eut beaucoup d’autres.
2 « Discours de la servitude volontaire », 1576
Rappelons pour mémoire que c’est sur une idée de Balzac que la Société des Gens de Lettres fut fondée en 1837. Victor Hugo en fut membre pendant 15 ans.
Revenons à cette liberté essentielle des écrivains qui conduira Baudelaire au tribunal.
Ernest Pinard, qui le cite à comparaître, avait commencé par être séminariste. Mais son directeur de conscience avait sans doute – lui aussi – compris que la bataille contre les mécréants ne se livrait plus désormais sous les arches des églises mais dans les bureaux des éditeurs.
De là, sans doute, ces générations d’écrivains catholiques, assumant une secrète vocation sacerdotale et adroitement cornaqués par l’autorité ultramontaine3.
Dans cette veine nous avions vu, il y a 10 ans, François Mauriac tentant de supplanter Emma Bovary avec sa Thérèse Desqueyroux. Mais il avait mis tellement de vie dans son personnage que, dans les dernières pages du roman éponyme, de l’aveu même de son créateur, Thérèse refusait d’entrer au couvent et disparaissait dans les rues de Paris.
Nous verrons comment Baudelaire s’inscrit paradoxalement dans cette saga 4.
Dernier point : comme mes recherches sur internet me font repérer, je reçois ce lundi 18 octobre5 un message ainsi libellé : « 8,349 papers on Academia discuss « 19th Century French Litterature. » », soit « 8349 articles universitaires sont relatifs au thème de la littérature française du XIX° siècle ».
Pas étonnant ; c’est la plus riche, la plus créative, la plus passionnante. Ni Baudelaire, ni Stendhal ne dépareront cet ensemble.
3 Qui soutient et défend les positions traditionnelles de l’Église italienne, le pouvoir absolu, spirituel et temporel du pape. 4 Cycle romanesque en plusieurs volets, généralement à caractère épique. 5 2021
Introduction
Dans le Panthéon des écrivains et poètes, Charles Baudelaire est inclassable.
Il est l’ami de Flaubert, du moins tant que ses ennuis divers ne l’ont pas contraint à s’exiler en Belgique.
Là il rencontrera Victor Hugo, sur lequel il a composé le plus grand hommage mais qui ne sera publié qu’à titre posthume. L’épouse du poète – qui attend à Bruxelles la fin de l’exil – l’invite à dîner à plusieurs reprises.
Nous sommes en 1865 ; il n’a plus un sou en poche, sa santé est mauvaise, il n’en a plus pour très longtemps à vivre6.
Et sans doute est-il loin d’imaginer à quel point il va compter dans ce Panthéon. Deux des plus grands poètes à venir se réclameront de lui : Stéphane Mallarmé et Yves Bonnefoy, sans parler de la déférence de Rimbaud qui, comme nous l’avons vu en exergue, en fait pratiquement son initiateur.
Par ailleurs il s’est mis progressivement en synergie avec les peintres de l’impressionnisme en train de sortir des limbes. C’est Courbet qui le peint en sombre méditant, du moins apparemment.
En fait une figure féminine servait initialement, dans la composition du tableau, de truchement entre Baudelaire et le reste de l’assemblée : Jeanne Duval, sa maîtresse mulâtre qui comptera tellement dans sa vie.
Et puis, on ne sait trop pourquoi, le poète a demandé au peintre de la faire disparaître. Parce qu’alors la brouille avec elle était définitive ? Ils étaient déjà séparés à cette époque mais Baudelaire continuait à l’entretenir.
On ne sait pas exactement comment s’est achevée cette improbable idylle.
Pour le reste, hormis un ou deux grands traits du portrait qu’en donne la tradition, tout est erroné, ou presque.
Voilà pourquoi il est urgent de rétablir Baudelaire dans sa vérité.
Juste une citation, pour clore cette introduction : dans les dernières lignes de son journal intime qu’il avait intitulé « Mon coeur mis à nu » :
« Faire tous les matins ma prière à Dieu, réservoir de toute force et de toute justice, à mon père, à Mariette et à Poe, comme intercesseurs ; les prier de me communiquer la force nécessaire pour accomplir tous mes devoirs, et d’octroyer à ma mère une vie assez longue pour jouir de ma transformation (…) »
Retour tardif dans le sein de « notre sainte mère l’église » ? Moralisation tardive de sa conduite après des années de débauche ?
Comme nous l’allons voir, c’est un peu plus compliqué. Entrons dans la vie du sujet.
6 Il meurt le 31 août 1867
A – Jeunes années
Cette mère, Caroline Dufaÿs, a 24 ans quand elle épouse son père, François Baudelaire, qui, en cette année 1819, a dépassé la soixantaine. Il faut préciser qu’elle est orpheline et qu’elle n’a donc pas de dot. Néanmoins son mari, vu son âge, s’accommode fort bien de cette jeune épouse.
Petits arrangements entre familles – c’est un couple d’amis de François qui avait recueilli Caroline – arrangements dont Balzac a décliné toutes les variantes dans sa Comédie humaine.
Ce père, né en 1759, avait eu, en 1803, une première épouse qui lui apporta une dot conséquente. De cette union était né un premier fils, Claude, qui devint magistrat. Grand écart entre les demi-frères, à la fois d’âge – 16 ans de différence – et de tempérament. Charles, contrairement à son aîné, n’est pas parti pour faire carrière.
Indiquons encore que ces parents qui – contrairement à ce qu’on pourraient croire – s’entendent fort bien – charrient avec eux une bonne partie de cette histoire convulsionnaire du siècle des révolutions.
Caroline est née à Londres en 1793. C’est dire en trois mots qu’elle est la fille d’émigrés royalistes qui conçoivent sans doute que la Terreur finira bien par mettre un terme à cette révolution.
Du reste son père s’engage dans l’armée royaliste qui débarque en Bretagne deux ans plus tard. Il est abattu à Quiberon, peut-être par l’un des hommes du bataillon de Léopold Hugo, père de Victor 7.
Quand Charles et Victor se retrouveront à Bruxelles en 1865 ils parleront sans doute des tribulations de leurs pères et grands-pères, embarqués dans tel parti ou tel autre, plutôt par hasard que par conviction.
Chacune de leurs mères était royaliste mais, en 1848, Charles Baudelaire est sur les barricades et Victor Hugo, à l’assemblée constituante.
Voyons maintenant, étape par étape, le parcours par lequel Baudelaire s’assied, à 45 ans passés, à la table de cet homme éminent qu’est Victor Hugo, sur lequel, du reste, ses sentiments sont très partagés.
_____________________ 7 « Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie » nous apprend en effet que, «Hugo était alors chef d’état-major. Il prit part à l’expédition de Quiberon. » Cette biographie est l’oeuvre d’Adèle née Foucher, épouse de Victor Hugo, qui l’écrivit pendant leur exil.
I Enfance lumineuse
Ce père qu’il ne gardera pas longtemps, puisqu’il meurt 6 ans après la naissance de ce second fils – le 9 avril 1821 – est sans doute un pédagogue hors pair, plein de sollicitude.
Ce qui incline à le croire, c’est son étonnant passé.
François Baudelaire se destine d’abord aux ordres. Il entre au séminaire et il est ordonné prêtre avant de devenir répétiteur puis professeur particulier.
Et il a sans doute un intérêt profond pour la pédagogie puisqu’il publie bientôt un manuel intitulé « De la langue latine illustrée par des figures ».
Et puis Charles est son second fils et le petit garçon va profiter, même si ce n’est que pour quelques années, du savoir faire acquis avec le premier, laissant alors de la place pour la tendresse paternelle.
On sait par ailleurs que ce père aimait la littérature et qu’il avait aussi du goût pour le dessin où il s’était essayé allant même jusqu’à donner des cours.
Nous retrouverons ces deux caractères chez ce fils chéri. Baudelaire, en effet, deviendra aussi un critique averti des oeuvres exposées aux salons. Et puis il dessinera lui aussi, et avec un incontestable talent (Planche n°1), utilisant avec maestria toutes les techniques, hormis la couleur, exceptées quelques touches de blanc.
De là, en particulier son admiration pour Constantin Guys qui sut si bien saisir l’essence de ce qu’il représentait. Nous y reviendrons.
Enfin dans cette relation essentielle à ses débuts dans la vie, ce père aimant transmet une nébuleuse de sens qui occupera Baudelaire toute sa vie : Dieu.
Certes ce père est devenu un défroqué en 1793 mais il n’a pas cessé pour autant d’être un croyant. Et son fils cadet – qui rendra illustre leur nom de famille – ne cessera pas – contrairement à ce que véhicule sa légende – non seulement de croire en Dieu mais même de faire sa prière.
Autre figure bienveillante penchée sur son enfance : Mariette, la bonne de la famille. Certes le petit Charles aime beaucoup sa mère mais la tendresse et la sollicitude dont un enfant a besoin, c’est cette bonne Mariette qui les lui offre avec générosité.
Alors c’est vers elle qu’il va quand il a besoin d’être consolé ou qu’il a envie de jouer. Et du coup, Dame Baudelaire est jalouse.
Et puis la foudre tombe sur cette enfance heureuse :
=> Le 10 février 1827 son père meurt et la fidèle servante le suit probablement d’assez près. Et s’il y avait la moindre hésitation sur ce que ces deux êtres représentaient pour l’enfant, le journal retrouvé dans les papiers de Baudelaire suffirait à les dissiper.
=> Certes il aime sa mère, en dépit de son remariage, quelques années plus tard avec l’officier Aupick qu’il désignera plus tard, dans ses lettres, sous les termes « ton
mari ». Ceci dit, il ne faut pas noircir le tableau comme on le fait souvent à ce propos.
=> Mais sa mère ne l’a pas aimé comme Mariette et son père l’ont fait, d’une tendresse souriante et généreuse. C’est cela qui fait qu’il les imagine, dans sa prière, directement assis à la droite de Dieu, en puissance d’intercéder en sa faveur.
Oui, décidément, il faut revisiter Baudelaire. Le bicentenaire de sa naissance en est l’occasion. Les commissaires des bibliothèques de Paris s’en sont également saisi pour organiser à la BnF une exposition – du 3 novembre 2021 au 13 février 2022, joliment nommée, Baudelaire, la modernité mélancolique 8
Voyons la suite.
________________ 8 Nous sommes allés la voir ensemble.
II Sombre jeunesse
1) L’interne
En octobre 1829 Charles, à 8 ans et demi, se retrouve interne au lycée Charlemagne à Paris. C’est bien jeune.
Si on en juge par la suite de sa scolarité, ça correspondrait au cours moyen, première année. A cette époque les lycées – institués par Napoléon en 1802 à la place des « écoles centrales » – comportaient deux années d’enseignement primaire, dites « petit lycée ».
Quand sa mère s’était remariée, un an plus tôt, Charles n’avait probablement pas fait le deuil de la mort de son vieux père, sans doute plutôt indulgent grand-père avec ce fils inespéré. Il se souvient déjà avec nostalgie de leurs promenades au jardin du Luxembourg.
Le beau-père, c’est différent, même si ce n’est pas le contraire.
Dans ses lettres l’enfant lui décerne malgré tout le nom de « Papa » et Jacques Aupick l’a surnommé « le mioche ».
Seulement Aupick est un militaire et tout porte à croire qu’il pratique l’éducation à la baguette. Après une année sans doute difficile dans cette famille recomposée, il décide d’inscrire cet enfant dans la filière d’excellence que constituent alors ces établissements, ce qui est peut-être aussi un bon moyen de s’en débarrasser puisque tous sont des internats.
Charles gardera un cruel souvenir de cette séparation.
Trois ans plus tard, nouveaux chambardements : Alphonse, le demi-frère, est nommé juge à Fontainebleau. C’est fort dommageable pour Charles qui l’aimait beaucoup. Tant pis ; il lui écrira des lettres.
Quant à Jacques Aupick, il est muté à Lyon, à la tête d’une des divisions de l’armée en charge de mater la révolte des canuts. Il y deviendra chef d’état major. Du coup dans ses premières lettres à Alphonse, Charles a entrepris de lui conter son voyage par le menu, en plusieurs épisodes.
L’élève Baudelaire se retrouve, toujours interne, au collège royal de cette ville, en 5°. De cette époque on retrouvera un faible écho dans un poème à venir, « Le crépuscule du soir ».
Eh oui, « crépuscule » peut-être aussi du matin, le terme signifiant littéralement « Lumière faible qui se répand lorsque le soleil est en dessous de l’horizon, le matin ou le soir; moment correspondant de la journée ». Le terme vient du latin « creper » : sombre, douteux, incertain.
Baudelaire – qui fut aussi un bon latiniste – composera également un « Crépuscule du matin »
On estime généralement que ces deux poèmes sont relatifs à Paris ; c’est vrai pour l’essentiel. Mais les derniers vers du premier sont en fait Baudelaireun souvenir lyonnais.
On ne peut véritablement les entendre que si l’on sait que l’internat du Collège royal se situait à faible distance de l’asile d’aliénés. Les voici :
C’est l’heure où les douleurs des malades s’aigrissent ! La sombre Nuit les prend à la gorge ; ils finissent Leur destinée et vont vers le gouffre commun ; L’hôpital se remplit de leurs soupirs. – Plus d’un
Ne viendra plus chercher la soupe parfumée, Au coin du feu, le soir, auprès d’une âme aimée.
Encore la plupart n’ont-ils jamais connu La douceur du foyer et n’ont jamais vécu !
Mobilité du foyer du futur poète : au bout de 2 ans Aupick est promu colonel et nommé à Paris. Retour de la famille dans la capitale : Charles entre à Louis-le-Grand.
On sait que dans ces années de l’adolescence il devient un fervent lecteur, en particulier de Chateaubriand. Nul doute, en particulier, que « Le génie du christianisme » ne lui ait amplement donné à réfléchir.
Ils sont tous des deux croyants mais de façon différente. Baudelaire est déiste fervent mais critique sur la Révélation alors que Chateaubriand voit dans la même Révélation le vecteur du progrès universel. L’un confine au mysticisme, l’autre est carrément hégélien, sans d’abord le savoir.
Parvenu en classe de 1°, le jeune Baudelaire remporte le 2° prix de vers latins au Concours général. Il y a là de quoi satisfaire sa mère qui en rêve depuis longtemps.
C’est que ce n’est pas rien, le Concours général.
Il met à l’épreuve, discipline par discipline, au terme des études secondaires, les meilleurs élèves de France et de Navarre.
Y être présenté est un honneur ; décrocher un prix, une consécration.
Et pourtant le souvenir qu’il garde de ce cursus scolaire est plein d’amertume.
Lettre de 1861 à sa mère : « Tu sais quelle atroce éducation ton mari a voulu me faire ; j’ai 40 ans et je ne pense pas aux collèges sans douleur. »
Il passe les vacances suivantes, en famille, dans les Pyrénées et les paysages de montagne lui inspirent l’un de ses premiers poèmes.
Dans cette composition le deuxième quatrain et les deux derniers donnent l’empan de la sensibilité du jeune homme. Examinons les brièvement.
Le premier est tout empreint de la personnification des éléments de la nature, portant déjà le signe d’une sensibilité particulière :
On rencontre un lac sombre encaissé dans l’abîme Que forment quelques pics désolés et neigeux ; L’eau, nuit et jour, y dort dans un repos sublime, Et n’interrompt jamais son silence orageux.
Les derniers, quant à eux, sont déjà porteurs de l’opposition fondatrice de la poésie de Baudelaire. Écoutons-les :
On dirait que le ciel, en cette solitude,
Se contemple dans l’onde, et que ces monts, là-bas, Écoutent, recueillis, dans leur grave attitude,
Un mystère divin que l’homme n’entend pas.
Et lorsque par hasard une nuée errante Assombrit dans son vol le lac silencieux,
On croirait voir la robe ou l’ombre transparente D’un esprit qui voyage et passe dans les cieux.
Des accents pascaliens dans ce poème de jeunesse. Charles Baudelaire, rappelons-le, n’a alors que 17 ans. Incompatibilité, semble-t-il, entre ce paysage – à la fois secret et grandiose – mais qui effraie l’âme du jeune homme – et son aspiration à trouver du sens à sa vie, à le recueillir dans les choses et, singulièrement, dans la beauté.
Impavidité de la matière qui ne révèle rien – ni de sa signification, ni de son origine – sur laquelle pourtant passe temporairement ce qu’on pourrait nommer un miroitement de sens mais qui n’émane que des événements transitoires du monde.
Plus tard, un autre poème dans la section Spleen des Fleurs du mal, entrera en résonance avec celui-ci (Cf polycopié n°2), marquant cette fois clairement le désespoir né de la stérilité de cette quête.
Plus tard encore la promesse de sens surgira à nouveau dans les « Petits poèmes en prose » :
« Eh, qu’aimes-tu donc, extraordinaire étranger ? J’aime les nuages, les nuages qui passent là-bas… là-bas… les merveilleux nuages. »
Mais revenons à la jeunesse de notre poète.
Il faut indiquer d’abord que cette scolarité se termine mal. L’année suivant ces vacances inspiratrices, en terminale par conséquent, Charles Baudelaire est exclu du lycée pour indiscipline.
Cours de philosophie ; l’un de ses camarades lui fait parvenir un billet, un
« petit mot », dirait-on de nos jours ; le professeur les a aperçus et somme Charles de le lui remettre. Celui-ci refuse.
Il est illico conduit chez le proviseur. Même demande ; même refus. Et pour plus de sûreté, l’élève récalcitrant avale le billet.
Déclaration du proviseur : « En vous comportant ainsi, vous vous exposez aux soupçons les plus fâcheux.» L’élève Baudelaire éclate de rire. On ne sait si c’est parce que le sous-entendu lui a paru totalement incongru ou bien s’il s’agissait d’écarter le soupçon d’une relation homosexuelle.
On n’a pas d’autres précisions ; mais à ce propos plusieurs analystes retiennent cette hypothèse. Il est en effet concevable que ces garçons – entrés dans la puberté quelques années plus tôt et cloîtrés la majeure partie du temps – fassent occasionnellement, l’un avec l’autre, l’essai de leur sexualité naissante.
En tout cas l’élève Baudelaire est renvoyé du lycée. Du reste on peut concevoir que la direction de ce prestigieux établissement – que, comme nous l’avions vu lors de « l’année Voltaire », Louis XIV avait placé sous son patronage – évite d’invoquer ce motif quand il renvoie un élève.
Heureusement le jeune Charles, admis comme externe au lycée Saint-Louis, obtiendra malgré tout son baccalauréat.
Il y eut pourtant, dans ce parcours scolaire, un moment de grâce. En 1838 le roi Louis-Philippe qui a décidé de transformer le château de Versailles en musée, y invite, pour une sortie scolaire, tous les élèves du collège royal. En plus, c’est lui qui fait le guide.
La galerie des Batailles laisse Charles indifférent, tant l’académisme lui paraît convenu et artificiel. Tout sauf un tableau, un seul : la bataille de Taillebourg 9. Dans ce grand cadre, aucun académisme, aucune mise en scène, mais la pure furie d’un affrontement à mort.

C’est signé Eugène Delacroix. Il saura s’en souvenir. Après quoi, goûter à l’Orangerie.
Pour revenir aux choses sérieuses, Charles doit maintenant opter pour des études qui lui permettront d’accéder à une profession. A son grand frère Alphonse il a écrit « je ne me sens de vocation à rien. ».
Dans le même temps néanmoins il lui a demandé de lui envoyer les vers composés par leur père. Mais comme, d’autre part, son beau-père insiste, Charles finit par se laisser persuader de s’inscrire à l’École de droit.
_______________ 9 Victoire de Saint Louis, en 1242, sur Henri Plantagenet. 10 Action d’uriner
2) Sarah la louchette
L’avantage des études supérieures c’est la liberté de circuler. Si Charles ne loge pas à la pension Bailly, il est fort possible qu’il y prenne ses repas… Dans tous les cas, il s’y fait des amis, comme lui férus de littérature.
Discussions passionnées et sorties récréatives. Tâtant pour la première fois de la « confiture verte » – autrement dit du haschich – il en est malade : sévère colique.
Le jeune Baudelaire visite le Louvre, approfondissant ses connaissances sur l’activité artistique qui le passionne.
Mais le corps a aussi ses exigences.
Quelques mois après la rentrée il va se « déniaiser » auprès d’une prostituée, Sarah dite Louchette, du fait de son strabisme ; et il attrape une blennorragie dite à l’époque « chaude pisse » du fait des douleurs d’irritation que cette infection provoquait lors de la miction10.
Mais il faut croire qu’il ne lui en a pas voulu, sans doute parce que Louchette connaissait admirablement cet aspect de son métier. Du reste, plus tard, Charles ne lui consacrera pas moins de 2 poèmes de son recueil à venir et l’invoquera encore dans un troisième. harmonique 11 discret avec Brassens dont on se souvient qu’il gardait pieusement un mot de reconnaissance de plusieurs de ces filles qui le remerciaient d’avoir pris leur défense, ceci dans ces termes en particulier :
Bien que ces vaches de bourgeois Nous appellent des filles de joie C’est pas tous les jours qu’on rigole Parole, parole…
Evidemment les vers de Baudelaire ne sont pas du même tonneau.
Le premier de ces poèmes – « Tu mettrais l’univers entier dans ta ruelle » – est, d’un bout à l’autre, l’expression d’un ressentiment. En voici les premiers vers :
Tu mettrais l’univers entier dans ta ruelle, Femme impure ! L’ennui rend ton âme cruelle. Pour exercer tes dents à ce jeu singulier,
Il te faut chaque jour un coeur au râtelier 12.
Et la suite du poème décline la même thématique 13.
Un jeune homme de 18 ans, pour passer cette premier étape du périple d’Éros, doit sans doute être un peu amoureux. De là ce ressentiment pour l’habile professionnelle qui s’attache irrévocablement ses clients par son savoir-faire dans le moment même où ceux-ci, s’ils sont jeunes, rêvent de mettre devant elle, un genou à terre.
Deux autres poèmes gravitent autour du même dissensus 14 : même louche Charles aurait aimé Sara d’amour si elle n’avait pas fait le choix de la prostitution.
Seulement l’aurait-il connue ou simplement rencontrée si elle n’avait pas fait ce choix-là ? Evidemment pas.
Le second poème, « Sarah la louchette », est sensiblement plus tardif. Il atteste de ce que Baudelaire a passé le seuil du ressentiment. Et ce poème a laissé une trace dans nos souvenirs de jeunesse. Nous connaissons tous déjà, en effet, et sans les avoir appris au lycée, ses dernières strophes, du moins en partie.
__________________ 11 Dont l’agencement est fait selon les lois de l’harmonie. Substantif masculin. 12 Initialement assemblage à claire-voie de lattes de bois en plan incliné, fixé au mur d’une écurie ou d’une étable, pour recevoir la ration de fourrage des animaux. 13 Qui pose ou qui est posé comme objet de l’activité mentale, soit implicitement ou sur le mode non réfléchi, soit explicitement ou sur le mode réfléchi. 14 Dissentiment mutuel.
Serge Reggiani avait retenu les trois dernières strophes – moins les deux derniers vers – pour les dire en prélude de la chanson de Georges Moustaki, « La femme qui est dans mon lit », qu’il avait choisi d’interpréter.
Or cette chanson peut être tenue pour une réécriture, en vers plus courts, du poème de Baudelaire. Quand Moustaki écrit, pour les chanter ensuite, les vers suivants :
Les yeux cernés, par les années Par les amours, au jour le jour
La bouche usée par les baisers Trop souvent, mais trop mal donnés
Ou encore ceux-ci :
Le corps lassé trop caressé
Trop souvent, mais trop mal aimé
il est clair non seulement qu’il évoque une prostituée mais encore qu’il s’est directement inspiré du poème de Baudelaire.
Du reste quand Reggiani lui demande l’autorisation d’interpréter « La femme qui est dans mon lit », Georges lui confie sans doute quelle en est la source et, du coup, Serge décide de mettre Baudelaire en exergue de cette belle chanson qui prendra bientôt « Sarah » comme sous-titre.
Pour en revenir au poème de Baudelaire, la première strophe, cette fois, exprime justement le fait qu’il est tombé amoureux de Louchette, au point de trouver du charme à ce qu’il nomme plus loin « ce regard étrange ». Citation :
Invisible aux regards de l’univers moqueur,
Sa beauté ne fleurit que dans mon triste coeur.
Assez joliment la deuxième strophe récuse cette condamnation universelle de la prostitution par le moyen d’un audacieux parallèle entre la prostituée et le poète.
Pour avoir des souliers elle a vendu son âme. Mais le bon Dieu rirait si, près de cette infâme, Je tranchais du Tartufe et singeais la hauteur, Moi qui vends ma pensée et qui veux être auteur.
Si la première a commencé à vendre son corps pour vivre – en particulier pour s’acheter des souliers (et nous retrouverons plus loin cette transaction particulière) – le second ne fait-il pas la même chose en vendant les produits de son coeur, de son âme et de son esprit ? En d’autres termes, en écrivant pour gagner de quoi vivre ?
Mais ce commerce, comme il arrive aussi que l’on qualifie l’amitié, a pourtant quelque chose de terrible, quoique de façon implicite.
Certes Sarah louche, elle est chauve, ses seins pendent… Par conséquent elle devrait se trouver heureuse de l’amour enfiévré de Charles.
Du reste ledit Charles estime sans doute qu’il en fait beaucoup pour rétribuer une maîtresse d’une telle laideur, tout en la couvrant de baisers de la tête aux pieds.
Mais que vaut un amour dont on n’est pas en puissance de refuser, si peu que ce soit, les manifestations ? Rien.
En plus cet amant enfiévré ne trouve le moyen de la protéger ni contre la maladie, ni contre les terreurs nocturnes.
Pourtant les dernières strophes sont un superbe plaidoyer en faveur de ces « filles de joie », comme les nommera plus tard Brassens dans sa « Complainte », qui marche ici dans les pas de Baudelaire.
Messieurs, ne crachez pas de jurons ni d’ordure Au visage fardé de cette pauvre impure
Que déesse Famine a par un soir d’hiver, Contrainte à relever ses jupons en plein air.
Brassens, Moustaki, Reggiani… belle postérité pour Baudelaire, qu’on aurait tort de méconnaître.
Si les romanciers sont devenus les prêtres de la modernité, les chanteurs et chanteuses – du moins ceux de la veine Jacques Canetti 15 – sont devenus ses poètes.
Quant au troisième poème, c’est une erreur de croire qu’il a été composé en souvenir de Sarah.
Seul le premier quatrain évoque Sarah, cette fois, dans des termes fort désobligeants : « affreuse juive 16 », « cadavre étendu », « corps vendu ».
Les trois autres strophes sont évidemment relatives à Jeanne Duval – sa maîtresse mulâtre que nous avons déjà évoquée – notamment le « casque parfumé » de ses cheveux – alors que nous avons vu que, dès 20 ans, Sarah avait commencé à perdre les siens – et, plus encore, le refus de cette femme – qu’il apostrophe – de céder à ses avances ; Sarah, elle, n’en avait pas les moyens.
________________ 15 Son palmarès en matière de découverte et de mise sur orbite de talents nouveaux : Édith Piaf, Charles Trénet, Les Frères Jacques, Juliette Gréco, Félix Leclerc, Charles Aznavour, Georges Brassens, Jacques Brel, Michel Legrand, Boris Vian, Serge Gainsbourg, Pierre Dac, Francis Blanche, Guy Béart, Claude Nougaro, Serge Reggiani, Jeanne Moreau, Raymond Devos, Brigitte Fontaine et Jacques Higelin. 16 Baudelaire n’est pas antisémite ; l’emploi de ce terme est ici commandé à la fois par l’idée de la laideur physique telle qu’elle inspire de la répulsion ou du dégoût et par l’impératif de l’alexandrin qui impose un substantif monosyllabique.
Enfin on trouve dans ce sonnet une dissociation très nette entre le commerce de la chair – donc Sarah – et la passion amoureuse – donc Jeanne.
C’est que Jeanne, même entretenue par Charles, ne se sent nullement tenue de céder à ses retours de flamme.
Il compose donc ce poème dans un temps où, ayant rompu avec Jeanne – temporairement ou définitivement – il est allé se consoler dans les bras de Sarah. C’est que celle-ci, quoique laide et faisant commerce de son corps, avait aussi ce pouvoir de tarir les chagrins.
Qu’on se souvienne des deux derniers vers du poème précédent :
Celle qui m’a bercé sur son giron vainqueur,
Et qui dans ses deux mains a réchauffé mon coeur.
C’est que la prostituée a quelque chose de maternel. Cinquième strophe :
Elle n’a que vingt ans, la gorge déjà basse
Pend de chaque côté comme une calebasse,
Et pourtant, me traînant chaque nuit sur son corps, Ainsi qu’un nouveau-né, je la tête et la mords
Et ici on pense irrésistiblement à Descartes dont la nourrice était louche et qui n’a jamais pu aimer une femme à moins qu’elle ne louchât.
Dernier point. On pourrait se dire que l’expérience de sa relation à Sarah aurait dû en principe lui permettre de mesurer ce que le personnage de Fantine, dans « Les Misérables » de Victor Hugo, avait de véridique.
Et là on pointe la question compliquée des rapports entre ces deux grands poètes.
Comme nous le verrons plus loin, l’article très élogieux que Baudelaire rédige à propos du roman de Hugo est généralement tenu pour une hypocrisie puisqu’il était un partisan inconditionnel de « l’art pour l’art », comme il s’en explique dans son essai, « L’art romantique ».
But it mayn’t be that simple 17.18
_________________ 17 « Il se pourrait bien que ce ne soit pas aussi simple ». L’anglais est souvent plus ramassé que le français. Ici, pratiquement le double de syllabes. Et puis 18 ici on a le droit puisque Baudelaire fut aussi le traducteur d’Edgar Poe.
2 ) Les voyages forment la jeunesse
C’est probablement ce qu’a dû se dire le colonel Aupick avec ce beau-fils revenu sous son toit – plus ou moins – et qui passe son temps à faire la fête au quartier latin avec des amis de rencontre.
Les rapports entre eux se tendent. Non seulement Charles ne fréquente que rarement l’École de droit, mais en plus il n’a même pas eu la décence de se rendre dans le cabinet d’avoué où Aupick lui avait trouvé un stage.
Il pourrait être diplomate – comme le vicomte de Chateaubriand pour lequel il a tant d’admiration. Aupick pense sans doute que ce serait le moyen le plus sûr de le tenir éloigné de ses mauvaises fréquentations. Mais Charles répugne à entamer les études ad hoc.
Non ; il veut être écrivain, poète, même !
A-t-on idée ! Mais le beau-père se garde sans doute bien d’exprimer crument son sentiment. Il commence donc par le tempérer : pour écrire, il faut avoir quelque chose à dire.
On imagine assez bien les termes de la négociation entre beau-père et beau-fils. La France à l’époque, avait encore quelques comptoirs aux Indes orientales, comme on disait alors.
Des navires faisaient du cabotage autour du continent africain avant de remonter, d’île en ile, dans l’océan indien, terminus Calcutta.
Si Charles consentait à s’engager dans ce périple, il pourrait en même temps découvrir le monde et trouver matière à mettre sur pied un commerce lucratif qui lui permettrait d’en vivre.
De toute façon, même s’il comptait bien hériter de son père à sa majorité, il ne pouvait plus compter vivre aux crochets de sa famille jusque là, avec un tel train de dépenses. Et puis, avec ou sans fonds, il faudrait bien qu’il se fasse une situation.
Il faut dire que le jeune homme avait accumulé les dettes, allant jusqu’à atteindre la coquette somme de 3000 francs-or de l’époque, soit 9510 € d’aujourd’hui.
En attendant il faut couvrir les frais du voyage et du séjour. On réunit un conseil de famille en présence du notaire, ce qui permet de dégager la somme de 5000 francs, de quoi payer la croisière19 et assurer les dépenses à terre.
« E la nave va 20 », comme dirait Stendhal, lequel, cette année-là, s’apprête à abandonner sa chère Italie.
________________ 19 Voyage de tourisme ou d’étude à bord d’un navire. 20 Et vogue le navire.
B – Outre-mer
Charles Baudelaire part donc pour Bordeaux. Le 9 juin 1841 il embarque sur un navire au long court, baptisé sans surprise Paquebot-des-Mers-du-Sud.
D’abord ce n’est pas l’entente cordiale entre ce jeune homme très imbu de lui- même – qui a embarqué avec un haut-de-forme – et le reste de l’équipage ; ça ne va d’ailleurs pas mieux avec les autres passagers.
Le temps que le navire parvienne dans la zone du Cap de Bonne espérance – dit encore « Cap des Tempêtes » – et les choses vont changer.
Il faut dire qu’entre les courants contraires et les vents violents des
« quarantièmes rugissants », c’est une zone particulièrement difficile pour les navigateurs.
C’est là que le Paquebot-des-Mers-du-Sud essuie une sacrée tempête.
Et le dandy qui paraissait regarder tout le monde de haut, aide à la manoeuvre – avec courage et savoir-faire – comme si, dans les semaines précédentes, il n’avait rien perdu de la conduite du navire.
Du coup le capitaine le prend en sympathie et les marins cessent de le regarder de travers. Et c’est en circulant parmi eux, sans jamais les empêcher 21, qu’il trouvera l’occasion de son poème le plus magistral.
Mais le premier poème qu’il écrit à l’occasion de ce périple, quelques mois plus tard, est un sonnet de commande. Et il est déjà sur le chemin du retour, ayant sans doute fait le calcul qu’avec ce qui lui reste des subsides familiaux – et en limitant ses dépenses – il aura sans doute de quoi atteindre sa majorité et recevoir sa part de l’héritage paternel.
Après quoi, enfin, il pourra conduire sa vie comme il l’entend. Principales étapes de ce voyage écourté :
= A Port-Louis, capitale de l’ïle Maurice – où le paquebot mouille pour réparations – Baudelaire est descendu s’installer à l’hôtel.
C’est dans cette ville qu’il fait la connaissance de M. Autard de Bragard, lequel, sans doute subjugué par l’intérêt de la conversation du jeune homme, l’invite à plusieurs reprises, y compris dans ses résidences hors la ville.
Charles est transporté par la beauté de la nature.
21 Faire obstacle, s’opposer à.
Madame Autard de Bragard, est charmante et c’est alors qu’il promet à son époux d’écrire un poème en son honneur. Ces deux-là, du moins, n’ont pas contesté ses talents de versificateur.
= 18 septembre 1841, départ du Paquebot-des-Mers-du-Sud pour l’île Bourbon22. C’est là que Charles Baudelaire fait part au capitaine de sa décision de retourner en France.
Celui-ci se met en quête d’un navire pour ce trajet retour.
En attendant le jeune homme compose le poème promis – « A une dame créole et l’adresse à M. Autard de Bragard dans les termes suivants :
« Vous m’avez demandé quelques vers à Maurice pour votre femme, et je ne vous ai pas oublié. Comme il est bon, décent, et convenable, que des vers, adressés à une dame par un jeune homme passent par les mains de son mari avant d’arriver à elle, c’est à vous que je les envoie, afin que vous ne les lui montriez que si cela vous plaît. »
On conviendra que, si ce poème élogieux autant qu’il est possible, avait de quoi franchir la limite du savoir-vivre, ce petit billet redresserait admirablement la barre.
= Ayant envoyé la lettre et le poème le 20 octobre 1841, Baudelaire embarque à bord de l’Alcide quelques jours plus tard. Le 15 février 1842 il débarque à Bordeaux et 5 jours après, il est de retour à Paris.
Néanmoins ce voyage écourté a été fécond. Pas comme Aupick l’escomptait cependant. Loin de mettre au jeune homme du plomb dans la tête, il l’a conforté dans sa vocation première.
Dans ses fontes il y a d’autres poèmes – rimés ou en prose, déjà composés ou en gestation – qui, tout à la fois, témoignent de sa sensibilité particulière et constituent la prima materia23 du grand oeuvre à venir.
Nous avons déjà plus haut fait allusion au plus remarquable. Titre : « L’albatros ».
Comme beaucoup de ses autres poèmes sur lesquels nous reviendrons, celui-ci puise sa vitalité dans les souvenirs et les impressions de ce voyage outre-mer. Mais ce qui le distingue, c’est qu’il est formellement le plus parfait qu’ait composé Baudelaire.
______________ 22 devenue depuis Île de La Réunion.
23 Selon les alchimistes matière de départ pour la création de la pierre philosophale.
Il puise sa force dans une scène – au moins – à laquelle celui-ci a assisté sur le pont du navire : ce majestueux oiseau des mers soudain en butte à la mesquinerie des matelots et auquel, sans doute, va d’abord sa sympathie silencieuse.
Et puis, des années plus tard, sans doute à la suite de ses expériences malheureuses avec les uns ou les autres, ce souvenir vivace ressurgit et il enchaîne jusqu’au dernier quatrain ce qui désormais vaut révélation du sens caché de l’événement d’autrefois.
Le troisième quatrain est tout entier voué à transposer le renversement de la condition du poète par la métaphore de l’albatros qui est ici son incarnation :
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule ! Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid ! L’un agace son bec avec un brûle-gueule, L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait !
Les matelots – qui incarnent l’humanité ordinaire – veulent cruellement l’arrimer à leur trivialité 24, l’un en lui faisant fumer la pipe, l ‘autre en imitant sa façon de marcher, comme s’il était lui-même de la troupe du pont.
Mais l’albatros n’est pas un boiteux et le dernier mot du dernier vers de cet avant- dernier quatrain fait le lien avec le dernier : voler, c’est ce pour quoi l’albatros est fait, de même que le poète a vocation à parcourir par l’esprit les espaces immenses du sens caché des choses, en quête de ce qui se manifeste à travers la beauté.
Qu’on se souvienne ici du raisonnement sur lequel il fondera sa prière quotidienne. Puisque dans le monde, tout a un but, il doit bien, lui aussi, en avoir un ; il prie donc Dieu de le lui révéler.
C’est cette certitude intime – quoiqu’intermittente – non seulement qu’il est poète mais encore qu’il l’est par décret divin, qui va lui permettre de résister bientôt aux pressions de sa famille.
Un dernier poème directement arrimé à cette expérience d’outre-mer – A une Malabaraise – donne la mesure de sa sensibilité exceptionnelle.
Dans ces îles de l’Océan indien où, comme on l’a vu, il peut être invité par les sommités 25, ce sont les esclaves qui éveillent sa sympathie. D’abord c’est Éros sans doute qui les lui montre du doigt puisque ce sont généralement de jeunes femmes. Mais il n’en reste pas là
________________ 24 Au sens premier, caractère de ce qui est devenu banal à force de répétition, parce que trop connu, trop courant. 25 Ici, personne éminente dans la hiérarchie sociale.
Comme on le voit dans celui-ci, non seulement il s’est informé de leur condition, mais encore il a pu – probablement en aparté – nouer un dialogue avec elles.
Il y a cette Malabaraise ; il y a aussi, comme nous verrons plus loin, Dorothée.
C’est ainsi qu’il apprend que c’est seulement quand les esclaves peuvent obtenir leur affranchissement qu’ils ont le droit de porter des souliers.
Précisons que l’esclavage avait été d’abord aboli en 1794 avant d’être rétabli en plusieurs phases sous la Restauration, dans telle colonie ou telle autre.
Ce que Napoléon décrète, c’est l’abolition de la traite des Noirs.
Pour l’abolition de l’esclavage proprement dite, il faudra attendre la révolution suivante : 1848.
Si la jeune Malabaraise rêve d’aller en France, c’est peut-être qu’elle a entrevu la possibilité que ce jeune homme la rachète. Mais quelque contrepartie qu’elle lui ait proposée, celui-ci sait immédiatement qu’elle y perdrait son bonheur de vivre.
Du reste, une fois revenu lui-même dans ces « sales brouillards » – comme il les nomme – il faudra peu de temps à Charles Baudelaire pour regretter le paradis des îles.
Voyons la suite.
C – Entrée en écriture
I Mineur à vie
Une fois rentré à Paris, le jeune Baudelaire retrouve d’abord avec plaisir les habitudes de sa jeunesse. Mais, désormais assuré de sa vocation, il commence à fréquenter les cercles d’écrivains.
C’est que sa conversation ne manque pas d’intérêt.
Ce voyage – qui aura duré un peu plus de 7 mois – a été suffisant pour découvrir un autre canton du monde et pour jeter, de là, un nouveau regard sur celui d’où il venait.
Une fois sa majorité atteinte il quitte la demeure du beau-père – sans doute pas fâché de le voir partir – et s’installe d’abord quai de Béthune, dans l’Île-Saint-Louis.
Il fait bientôt connaissance avec Sainte-Beuve – qu’il avait lu avec délectation – de Victor Hugo – auquel il écrit dès cette année 42, une lettre pleine de déférence – et de Théophile Gautier qu’il tient pour son maître en écriture.
C’est probablement grâce à ces relations qu’il devient pigiste au Corsaire – petit journal de critique littéraire et artistique – auquel il donnera des articles pendant plusieurs années.
En 1844 Le Corsaire fusionnera avec une autre feuille de chou et deviendra « Le Corsaire-Satan » jusqu’en 1847. Après quoi, de libéral qu’il était, le journal passera aux mains des légitimistes.
Il faut préciser qu’en ces temps difficiles pour la liberté d’expression, la critique des oeuvres, littéraires ou graphiques, était un moyen indirect d’entrer dans le champ du débat politique.
Théodore de Banville, Jules Sandeau – époux d’Aurore Dupin devenue George Sand – Alphonse Karr – auteur très prolixe de l’époque – firent aussi partie de ces rédacteurs occasionnels.
Et puis travailler dans un journal, c’est le moyen d’y faire publier ses poèmes.
Enfin, le 9 avril de cette année faste, Baudelaire devient majeur et obtient sa part de l’héritage paternel, soit un total de biens divers (fonds d’actions, terrains, et c…) dont la valeur se situe entre 75 000 et 100 000 francs-or, selon les estimations.
Il est très difficile de préciser l’équivalent actuel de cette somme, non seulement parce que le cours des monnaies n’a cessé de varier dans le temps, mais surtout parce qu’une évaluation exacte de celle-ci passe nécessairement par une estimation de son pouvoir d’achat.
Si l’on se fie à une équivalence donnée une dizaine d’années plus tard – et à condition de retenir la moyenne entre ces deux estimations – ce legs équivaudrait à environ 400 000 € 26.
Et le jeune Baudelaire dépense sans compter. D’abord il n’est jamais satisfait de l’appartement qu’il occupe et change continuellement d’adresse.
Et puis, dans l’intervalle de ses lubies immobilières, il va au théâtre. Du reste c’est « Marion Delorme », pièce qui l’avait enthousiasmé, qui a motivé sa lettre à Victor Hugo. Il est vrai que ce mélodrame à quiproquos et à rebondissements avait de quoi enthousiasmer un jeune homme.
Ensuite Charles invite ses amis au restaurant ; rien, sans doute, n’égale pour lui les discussions passionnées qu’il a avec eux à propos de l’art de de la littérature.
Autres relations essentielles : Théodore de Banville et Félix Tournachon… dit Nadar.
Celui qui le photographiera tant de fois raconte, dans « Baudelaire intime », leur première rencontre, alors qu’il est assis avec Privat d’Anglemont et Théodore de Banville sur un banc du jardin du Luxembourg.
______________ 26 Calcul établi par Colette Becker, sur la base d’une indication donnée par Émile Zola à propos de sa rétribution comme employé dans les docks – 60 francs or par mois – laquelle lui procurait à peine de quoi manger. Le franc-or est demeuré la monnaie d’usage jusqu’en 1920.
« Le propos tout d’un coup tomba à l’aspect encore lointain d’une figure bizarre, fantomatique, qui se découpait sous la voûte des verdures, semblant venir droit vers notre banc. A mesure que l’apparition se rapprochait, comme aimantée sur nous, plus distinctement nous percevions un jeune homme de bonne taille moyenne, élégant, tout de noir vêtu sauf la cravate sang de bœuf, en habit, – ça se rencontrait encore de jour, par-ci par-là, l’habit – qui dut être médité, démesurément évasé du torse en un cornet d’où émergeait comme bouquet la tête, et à basques infinitésimales, en sifflet; l’étroit pantalon sanglé par le sous-pied sur la botte irréprochablement vernie. Col de chemise largement rabattu, manchettes non moins amples en linge très blanc de fine toile protestaient par la proscription du moindre empois contre le supplice d’encarcanement 27 dont l’étrange goût s’obstine à ankyloser nos générations présentes dans les roideurs du calicot silicate ; émancipation du corps n’aurait-elle quelque accointance avec dégagement de l’esprit ?
A la main, gantée de rose pâle, – je dis de « rose » – il portait son chapeau, superflu de par la surabondance d’une chevelure bouclée et très noire qui retombait sur les épaules. Depuis Louis XIV en ses perruques on n’avait vu qu’au statuaire Christophe et à Got dans Monsieur de Pourceaugnac 28, cascades de crinière aussi avantagée.
De premier droit une de ces rencontres où le passant reste ébahi sur place,
«Tiens, Baudelaire ! » dit alors ce Privat qui connaissait l’entier univers et qui, pour une fois, disait vrai. »
Deux remarques à propos de ce long passage :
= Dès cette époque de sa jeunesse Baudelaire a opté pour le dandysme. = Félix Tournachon a bien fait d’abandonner l’écriture au profit de la photographie, devenant alors Nadar.
Rencontre décisive puisque c’est sans doute par l’intermédiaire de Théodore de Banville – dont elle est déjà la maîtresse – que Jeanne Duval et Charles Baudelaire seront présentés l’un à l’autre, dès cette l’année 1842.
D’autre part Théodore de Banville vient de publier – à l’âge de 19 ans – son premier recueil de poèmes, « Les Cariatides ».
Plus tard Baudelaire lui consacrera un sonnet dont la dédicace est le titre – « A Théodore de Banville » et qui porte en sous-titre le millésime : 1842.
Or comme dans cette période de sa jeunesse son esthétique est en cours de constitution, autorisons-nous une parenthèse sur la question.
____________ 27 Néologisme fabriqué à partir du verbe encarcaner : mettre dans un carcan. 28 « Monsieur de Pourceaugnac est une pièce de Molière qui eut en son temps beaucoup de succès. Le personnage finit par se déguiser en femme pour échapper à tous ceux qui s’opposent à son mariage. Il se trouve que la promise est amoureuse d’un jeune homme et que les amis des jeunes gens ont tout mis en oeuvre pour décourager le prétendant.
Vous avez empoigné les crins de la Déesse Avec un tel poignet, qu’on vous eût pris, à voir Et cet air de maîtrise et ce beau nonchaloir, Pour un jeune ruffian terrassant sa maîtresse.
Ce premier quatrain est à double sens. Si la Déesse, avec une majuscule, est a priori Euterpe, la déesse de la poésie, la dénomination, sous la plume de Baudelaire, pourrait bien en sous-main également désigner Jeanne Duval qu’il honore ailleurs de ce titre.
Cette interprétation est corroborée d’abord par l’emploi du terme de « ruffian » au 4° vers. ensuite par la référence répétée, dans les deux tercets, aux infidélités supposées d’Héraclès et de Déjanire.
Enfin on peut sans hésitation rapporter ce « vibrato 29 » du sens au recueil qui se constitua de facto comme manifeste du Parnasse : « Émaux et Camées ».
La métaphore du titre de ce recueil fait justement référence à ces deux catégories de bijoux qui, par leur pouvoir de moduler la couleur ou le relief, tiennent plus qu’ils ne promettent.
____________ 29 Modulation périodique du son d’une note de musique.
Il y a donc ici une ironie mordante du jeune Baudelaire…
1° à ramener Théodore de Banville à cette année clef de 1846 qui fut à la fois celle de leur première rencontre et celle du passage de Jeanne Duval des bras du second à ceux du premier.
2° à le faire implicitement sous le haut patronage de Théophile Gautier, dans le chatoiement du glissement de la déesse Euterpe à la « déesse noire », ainsi qu’on surnommait Mademoiselle Duval.
Dans sa biographie de Baudelaire, Banville garde un silence pudique sur sa relation personnelle avec Jeanne.
Mais dans ce quatrain Baudelaire le véridique paraît bien faire allusion à une scène de violence où il s’en serait pris à Jeanne, selon toute probabilité du fait d’une infidélité.
Il ne fait pas de doute que Jeanne l’infidèle lui a rapporté plus tard cet épisode de sa vie avec Théodore.
Sonnet règlement de compte, décidément, puisque le second quatrain est une caricature de l’esthétique de l’école poétique du Parnasse dont on sait que Théodore de Banville fut, avec Théophile Gautier, l’un des pères fondateurs.
Quelques précisions sur le sujet :
=> Le maître-mot de la doctrine du Parnasse, c’est « l’art pour l’art » et, à titre de conséquence, l’exclusion de toute subjectivité.
=> Cette nouvelle doctrine esthétique s’oppose donc d’une part au romantisme, qui gravitait au contraire autour de la subjectivité (Musset, Vigny), d’autre part à toute espèce d’écriture qui viserait autre chose que la beauté pure (Victor Hugo).
On voit donc que Baudelaire ne trouve pas sa place dans cette classification en voie d’élaboration :
=> Certes il souscrit entièrement au primat de la quête du Beau mais celle-ci ne peut ni exclure la subjectivité, ni se mettre au service d’une autre cause qu’elle-même.
=> Il nouera avec Théophile Gautier et avec Victor Hugo des relations amicales mais jamais il ne souscrira à l’un ou l’autre de leurs crédos respectifs.
A ce titre il est convaincu, d’une part que c’est par la beauté de la forme que l’on peut transmettre de l’essentiel, d’autre part que le rejet du « roman social » n’exclut pas que l’on éprouve de l’empathie pour ses semblables.
Enfin il se procure tous les biens possibles – sans doute en matière de meubles et de vêtements – mais surtout des livres et des tableaux.
Cette fébrilité ne tient pas, comme ses biographes ont tendance à le croire, à l’instabilité de son caractère. C’est précisément l’année suivant celle de son retour, qu’il a rencontré la femme de sa vie : Jeanne Duval.
Elle est figurante au théâtre de la Porte-Saint-Antoine, sous le nom de scène de Berthe. C’est en 1843 que Baudelaire la découvre pour la première fois et il en tombe aussitôt follement amoureux.
Elle est alors la maîtresse de Nadar et c’est peut-être en sa compagnie qu’il en fait la connaissance.
On ne sait pas comment elle a atterri à Paris ni même si « Jeanne Duval » est véritablement son nom. De nombreux commentateurs prétendent que c’est parce qu’elle est poursuivie par les créanciers, qu’elle vient à en utiliser deux ou trois autres.
Les choses sont sans doute un peu plus compliquées. Première certitude : son nom véritable est Jeanne Lemer ; la preuve, c’est que c’est celui qu’emploiera Baudelaire dans un document à caractère officiel, ainsi que nous le verrons plus loin.
Ce qui attire immédiatement le regard de Baudelaire c’est à la fois son allure et sa parenté avec les femmes des îles. Jeanne est une mulâtresse mais, dans ce métissage dont elle est issue, elle tire plutôt sur le blanc que sur le noir.
Sartre dans son « Baudelaire » n’a pas même pris la peine de vérifier à quoi ressemblait cette femme essentielle ; il la nomme – comme les contemporains mauvais coucheurs de Baudelaire – la « Vénus noire ».
Pour en finir avec la question de la carte d’identité de Jeanne, trois précisions :
= Duval était le nom de sa grand-mère, selon l’un des chercheurs. Plusieurs autres en conviennent mais doutent que Jeanne ait pu naître en Bretagne.
Néanmoins cette grand-mère bretonne aurait pu émigrer dans l’une des colonies et s’unir à un Africain. Jeanne est en effet donnée à plusieurs reprises comme une « quarteronne 30 »
= « Mademoiselle Duval » était sans doute à l’origine son nom de scène. Quand on se fait engager comme figurante dans un théâtre, c’est généralement pour devenir actrice. Donc, Berthe Duval, de ce côté-là.
= Le nom qu’elle aspirait à porter était sans doute « Mademoiselle Baudelaire ». Et ici, double sens :
= Le théâtre, toujours, où toutes les actrices étaient désignées comme « Mademoiselle », qu’elles aient été ou non mariées. L’usage vient de la Comédie française.
= L’aspiration à unir sa vie à son cher amant dont elle aurait tant aimé porter le nom. Mais impossibilité de l’épouser : il n’a plus le droit de se marier. Nous allons bientôt voir pourquoi.
Et puis, dans cet amour fulgurant, il y a leur jeunesse à chacun. On prétend qu’elle avait 15 ans lorsque commença sa liaison avec Nadar ; c’est plus que douteux. Certains chercheurs la donnent comme née en 1820, ce qui en ferait d’un an l’aînée de Baudelaire. Vingt ans paraît un moyen terme raisonnable.
En tout cas Charles n’a jamais que 22 ans lorsqu’ils se rencontrent. Et c’est ce qui importe ; ils sont jeunes tous les deux et beaux, chacun à sa façon, et empêchés dans l’élan érotique qui les portent l’un vers l’autre par leur loyauté à l’égard de Félix, dit Nadar.
Naturellement lorsqu’ils finissent par céder, c’est un véritable embrasement. Et Jeanne, parce qu’elle a cette beauté qui n’appartient qu’à elle, mais aussi parce qu’elle est vive et intelligente, va devenir pour ce poète en herbe, une source constante d’inspiration.
Au fond, c’est justement dans les poèmes qu’il lui a consacrés que sont les reliques de cette femme, par lesquelles nous pouvons comprendre ce qu’elle eut pour lui d’essentiel (Cf Polycopié n°5).
30 Quarteron, quarteronne : fils ou fille d’un blanc et d’une mulâtresse, ou d’une blanche et d’un mulâtre.
Jeanne n’est pas facile à vivre, comme nous l’a appris subrepticement le poème dédié à Théodore de Banville. Charles, d’abord aimable garçon – ainsi que Nadar nous l’a découvert lors de leur première rencontre – le sera de moins en moins.
Mais d’abord c’est l’amour fou.
Et ce qui frappe dans quelques uns des poèmes de ce qu’on nomme, dans « Les fleurs du mal », le cycle Jeanne Duval (cf. Polycopié n°5), c’est à quel point cet amour est à la fois tout entier fait d’érotisme et complètement imprégné des souvenirs du périple dans les mers du Sud.
Et l’on comprend alors que dans le poème précédemment évoqué – « A une Malabaraise » – l’opposition entre la douce indolence des îles et la cruelle froideur de la métropole n’est pas une construction de l’esprit ; c’est très exactement ce que Charles Baudelaire éprouve après sa réinstallation à Paris.
Voilà pourquoi quand Jeanne lui apparaît pour la première fois, elle cristallise autour d’elle toute cette nostalgie du voyage. Il n’est pas une partie de son corps qui ne soit connotée de cette réminiscence exotique, hormis les yeux.
C’est là d’ailleurs qu’est le poison. Regard d’or et de fer, qui d’un côté appelle « le rubis, la perle et le saphir », de l’autre est de l’inflexibilité du fer.
Comme en deux ans Charles a dépensé la moitié de son legs et que, aussi bien du côté d’Alphonse Baudelaire que de celui de Jacques Aupick, on voit venir le moment où, à nouveau, il faudra éponger ses dettes en septembre 1844 on se met d’accord pour convoquer un conseil de famille.
D’où il résulte ce qui suit :
= Charles est mis sous tutelle.
= Partant, déclaré mineur, il ne pourra plus accéder au reste de sa fortune. = Son nom figurera sur la liste des interdits banquaires.
= Il n’aura pas non plus le droit de se marier.
= Sur les restes de son héritage, un dividende proportionnel lui sera versé,
versement réparti sur les 12 mois de l’année.
= Enfin Maître Ancelle, notaire, contrôlera régulièrement ses dépenses. Il le
faut bien puisqu’étant déclaré mineur, ce sont ses responsables juridiques qui doivent en répondre.
On se doute que les relations avec Jacques Aupick sont alors définitivement rompues. Plus douloureuse, sans doute, est la fracture qui s’est alors mise en place entre son demi-frère Alphonse et lui.
Sans parler de la mortification qu’il a dû éprouver à imaginer sa mère partie prenante de ce complot.
Enfin c’est à partir de cette date que le nomadisme de Baudelaire change de nature. Jusque là il était sans cesse en quête de ce qu’il y avait de plus beau ; désormais il s’agit d’échapper aux huissiers.
C’est que la somme de 200 francs-or qui lui est versée chaque mois – soit approximativement 480 € – ne suffit évidemment pas pour vivre. Il pourrait y parvenir en la complétant avec ses travaux de plume ; seulement il y a Jeanne.
Et Jeanne est exigeante. Alors Charles invente des fables, promettant à chaque acquisition de payer dans les meilleurs délais. Et puis, dès que les scellés sont posés, il déménage à la cloche de bois31.
En mars 1845 il parvient à publier son premier livre « Le salon de 1845 ». Pas de poèmes, comme on s’en doute, mais une critique picturale des expositions de l’Académie des beaux-arts de cette année-là.
Ça n’est pas pour lui déplaire ; il a toujours été fasciné par les images, comme il le consignera plus tard dans « Mon coeur mis à nu » ; citation : « Glorifier le culte des images (ma grande, mon unique, ma primitive passion). »
Nous exposerons en temps utile le statut très particulier de cet écrit. Ce qui est certain, en dépit de l’ambiguïté de l’énoncé, c’est son caractère véridique.
Ouvrons donc ces pages.
Premier constat : Baudelaire s’impose aussitôt comme le chantre de la modernité. Pourquoi ? Parce qu’il dégage aussitôt, avec une rare pénétration d’esprit et en prenant la défense de Corot, le principe fondamental de l’oeuvre picturale ; citation :
« Tous les demi-savants, après avoir consciencieusement admiré un tableau de Corot et lui avoir loyalement payé leur tribut d’éloges, trouvent que cela pèche par l’exécution, et s’accordent en ceci, que définitivement M. Corot ne sait pas peindre.
– Braves gens qui ignorent d’abord qu’une œuvre de génie – ou si l’on veut une œuvre d’âme – où tout est bien vu, bien observé, bien compris, bien imaginé – est toujours très bien exécutée, quand elle l’est suffisamment.
Ensuite, qu’il y a une grande différence entre un morceau fait et un morceau fini, qu’en général ce qui est bien fait n’est pas fini, qu’une chose très finie peut n’être pas faite du tout et que la valeur d’une touche spirituelle, importante et bien placée est énorme. etc. etc. d’où il suit que M. Corot peint comme les grands maitres. »
Que veut-il dire ? Ceci que quand les touches de peinture déposées sur la toile sont parvenues à capter l’essence de ce qui est représenté, alors il faut lever la main.
31 Déménager sans avertir le propriétaire, en évitant ainsi de payer le loyer.
La Joconde est faite mais elle n’est pas finie. Léonard de Vinci a laissé en plan le paysage qui s’étend derrière Mona Lisa.
Pourquoi ? Par crainte de détruire la magie par laquelle il était parvenu à capter ce que Steiner nommera plus tard « la présence réelle »32.
Dans son journal, ce jour-là Leonardo da Vinci note : « E gia intervenne a me fare una piturra que representava una cosa divina » : « Aujourd’hui il m’est arrivé de peindre une figure véritablement divine. »
Et quand finalement, sur l’invitation de François 1°, il se décide à émigrer en France, c’est le seul tableau qu’il emporte avec lui ; raison pour laquelle il est aujourd’hui au Louvre.
C’est sur le même principe que Baudelaire célèbrera Delacroix, Courbet, Manet mais aussi Daumier ou Constantin Guy. Quand ce qu’on a voulu représenter est là, il faut s’arrêter – en conjurant33 toutes les règles académiques – afin de préserver la magie de l’oeuvre.
Pour revenir au « Salon de 1845 », ce qui saute aux yeux, à parcourir ces quelques 70 pages, c’est que Baudelaire est loin d’être novice en la matière.
Il a une parfaite intelligence de la technique mais aussi une mémoire encyclopédique des tableaux exposés les années précédentes.
C’est ainsi qu’il démonte les oeuvres d’un certain Robert Fleury en renvoyant chacune de ses compositions aux oeuvres qui lui ont servi de modèle.
Mais, sauf exception, il est généralement indulgent, trouvant toujours au moins une qualité à telle ou telle oeuvre d’un exposant. Voilà pourquoi, à plusieurs reprises, il se plait à défendre les oeuvres attaquées par la critique,
A l’occasion il perçoit des correspondances, par exemple entre les tableaux d’Achille Devéria et l’oeuvre littéraire de l’ami de celui-ci, Victor Hugo.
Chemin faisant, Baudelaire élabore ses outils conceptuels. A propos de tel peintre, il regrette que le coloriage ait été préféré à la couleur ; à tel autre, il reproche de trop penser et de ne pas assez peindre.
Peu à peu les principes de son esthétique vont émerger, du moins une fois passée l’épreuve que la vie lui réserve dans les mois suivants.
Une certitude : Delacroix est un génie de la peinture, textuellement, « l’un des spécimens les plus complets de ce que peut le génie dans la peinture. », et ceci à propos du tableau « La Madeleine au désert »
________________ 32 « Réelles présences » 1991.
33 Conjurer : écarter un danger quelconque par différents moyens.
Sans doute Baudelaire est-il particulièrement sensible à ce tableau, ceci parce qu’il rencontre, sous le pinceau d’Eugène Delacroix la même sensibilité que la sienne.
Madeleine, avant d’être canonisée, c’est Marie de Magdala, l’une des trois femmes qui sont mentionnées dans les Évangiles comme disciples du Christ (avec Marthe et Marie de Béthanie). Elle est aussi celle qui, la première, revoit Jésus après sa résurrection et qui va aussitôt prévenir les apôtres.
Elle aurait alors, selon les différents récits évangéliques, tenté de porter la main sur Jésus, geste que celui-ci aurait écarté, ce qui a donné, dans la traduction latine des Évangiles synoptiques, « Noli me tangere » : « Ne me touche pas ».
J’ai le sentiment que Delacroix a voulu, dans ce tableau, représenter Marie de Magdala allongée près du tombeau de Jésus, épuisée après bientôt trois jours d’attente, un regard à la fois perdu dans le vague et retourné en introspection, partagé entre l’espoir et les prémisses du ressentiment.
Bref, la Madeleine amoureuse.
Et cette lecture s’impose immédiatement à Baudelaire, en particulier parce que, dans la lignée de Kierkegaard, il croit que l’amour, quelle que soit sa forme, a la puissance d’engendrer.
Mais il faut bien sortir de ces extases esthétiques et revenir aux dures réalités.
Trois mois après la publication de cette brochure, Baudelaire fait une tentative de suicide ; c’est du moins ce qu’on admet communément.
Seulement il y a lieu d’en douter puisque notre poète aurait tenté de mettre fin à ses jours en se donnant un coup de couteau.
Tant qu’à employer un couteau, autant se trancher la carotide ou s’ouvrir les veines du poignet dans une bassine d’eau.
Et puis il y a l’opium ou le laudanum, couramment employés à cette fin.
Le point important, c’est la lettre qu’il écrit alors à Maître Ancelle.
Il a obtenu de Jeanne qu’elle la porte en mains propres au notaire, raison pour laquelle ladite lettre commence par cette déclaration :
« Quand mademoiselle Jeanne Lemer vous remettra cette lettre, je serai mort. – Elle l’ignore.- Vous connaissez mon testament – sauf la portion réservée à ma mère, mademoiselle Lemer doit hériter de tout ce que je laisserai après paiement fait par vous de certaines dettes dont la liste accompagne cette lettre. »
Dans la même lettre Baudelaire écrit que seulement deux personnes sont susceptibles d’attaquer ce testament : sa mère et son frère. Il prie donc le notaire de leur résister et de respecter scrupuleusement ses dernières volontés.
Comme par ailleurs il notifie que c’est cette mère qui a empoisonné sa vie, il n’est pas interdit de voir, dans cette nébuleuse morbide, à la fois ce qu’on nomme
« un suicide revendicatif » et une tentative d’obtenir la révision de sa situation légale, ou, à tout le moins, le paiement de ses dettes.
Tentative sans effet ; Charles Baudelaire se décide donc à vivre dans les étroites limites fixées par sa famille.
II Des brochures et un roman
Quelques mois après cette aventure tragique, Baudelaire est invité par le maître – à savoir Théophile Gautier – à prendre part à une séance du club des
« haschischins », fondé deux ans plus tôt et installé à l’hôtel Pimodan, dans l’Île- Saint-Louis.
Que le jeune homme n’ait aucune crainte : non seulement l’aventure est collective mais en outre elle se déroule sous le contrôle du docteur Jacques Moreau. Il est en effet question pour celui-ci d’explorer les effets du cannabis sur l’esprit et de déterminer s’il n’y aurait pas moyen de définir ses usages thérapeutiques.
Charles Baudelaire n’a nul besoin d’être rassuré. Son peintre de prédilection, Eugène Delacroix, participe également à ces séances, ainsi que Gérard de Nerval, Alexandre Dumas et, à l’occasion, Victor Hugo, Daumier et Flaubert.
1) En quête du paradis
Petite parenthèse sur les sombres origines du terme « haschischin ». Baudelaire l’évoque partiellement dans « Les paradis artificiels » ; citation :
« (…) le Vieux de la Montagne enfermait, après les avoir enivrés de haschisch (d’où, Haschischins ou Assassins), dans un jardin plein de délices, ceux de ses plus jeunes disciples à qui il voulait donner une idée du paradis, récompense entrevue, pour ainsi dire, d’une obéissance passive et irréfléchie. »
Il faut préciser que si « haschischin » constitue bien l’étymologie de
« assassin », c’est parce que « Le Vieux de la Montagne » – que nous avions brièvement évoqué lors de notre étude de Voltaire – est le surnom du cheik iranien Al Jabal qui employait surtout le cannabis pour expédier ses séides dans les émirats voisins afin d’assassiner leurs souverains et d’en faire plus aisément la conquête.
Comme quoi, de ce côté-là, les choses n’ont pas vraiment changé. Il n’est du reste pas impossible que les commanditaires des attentats suicides actuels emploient quelque drogue adéquate pour accompagner leur promesse d’un avenir paradisiaque et éternel.
Notre vieux à nous est beaucoup plus aimable. François Marie Arouet écrit dans l’une de ses lettres : « (…) dans mon vallon des Alpes ; je suis le Vieux de la Montagne, à cela près que je n’assassine personne. »
Pour revenir à Baudelaire, il ne paraît pas qu’il soit jamais tombé dans l’addiction proprement dite. Certes il prendra régulièrement de la « confiture verte », comme on disait alors , mais, semble-t-il, dans les limites exactes où le cannabis favorise son travail.
Dans la première des deux parties des « Paradis artificiels » – intitulée « Le poème du haschisch » – il se livrera d’abord à un exposé méthodique et exhaustif de tout ce qui est relatif à ce chanvre particulier, cannabis indica selon la nomenclature botanique.
Après avoir détaillé les différentes préparations – ce dont nous avions eu un aperçu – il aborde la question des effets.
Ici, sans doute, il récapitule et ordonne ce qu’il a éprouvé lui-même, les confidences de ses compagnons du « club » et peut-être aussi des indications du docteur Moreau.
Le premier caractère qui émerge de cette compilation, c’est la variabilité.
Et elle est double : non seulement l’effet du cannabis diffère d’un individu à l’autre mais il est également variable pour un même individu.
Passons maintenant cette monographie au tamis de la subjectivité de son auteur. La mise en rapport de deux indications qu’il donne permet d’approcher l’usage personnel qu’il faisait probablement de cette drogue :
= 1° extrait : « Tantôt ce sera une gaieté immodérée et irrésistible, tantôt une sensation de bien- être et de plénitude de vie, d’autres fois un sommeil équivoque et traversé de rêves. »
= 2° extrait : « (…) le thé, le café et les liqueurs sont des adjuvants puissants qui accélèrent plus ou moins l’éclosion de cette ivresse mystérieuse (… ) »
On peut donc amplifier les effets de la prise orale de cannabis en l’accompagnant de café, ce qui a le double avantage
= 1° de réduire la quantité nécessaire pour engendrer la bonne humeur, = 2° d’écarter le risque de sommeil.
Mais Baudelaire est méthodique et va donc exposer ces effets par le menu. Là encore, ne retenons que ce qui est relatif à l’auteur.
Il y a d’abord cette célébration du sommeil ordinaire :
Citation : « Dans le sommeil, ce voyage aventureux de tous les soirs, il y a quelque chose de positivement miraculeux ; c’est un miracle dont la ponctualité a émoussé le mystère. »
Divin sommeil, par conséquent, qui, chaque soir, fait tomber de nos épaules le poids de la vie ordinaire et de ses soucis, parfois si lourds à supporter.
« miraculeux », « miracle », « mystère »… dans ce champ lexical relatif à la personne divine il y a l’idée implicite que celle-ci, par le don du sommeil, oeuvre à notre bien-être.
Eh bien, dans un tout autre registre, le cannabis a, lui-aussi, des vertus métaphysiques, si l’on peut dire.
Baudelaire, après avoir détaillé scrupuleusement les effets de la première prise de confiture verte sur les impétrants34, en vient à l’usage de l’ivresse du haschisch.
Et ici, il commence par faire appel à des témoignages qui font apparaître le décrochage vertigineux entre la conscience ordinaire de soi-même et ce qui advient lors de la première prise.
A propos de l’ivresse régulière Baudelaire détaille ensuite les effets physiques en un tableau tellement terrifiant qu’il dissuaderait n’importe qui de goûter de cette terrible confiture. Le tout est habilement corroboré par le témoignage précédent.
Nouveau décrochage mais cette fois d’une autre nature ; citation : « Des soupirs rauques et profonds s’échappent de votre poitrine, comme si votre ancien corps ne pouvait pas supporter les désirs et l’activité de votre âme nouvelle. » Expérience métaphysique décisive puisqu’il la vit comme celle de l’indépendance de l’âme à l’égard du corps.
La suite du développement repose sur le long témoignage d’un confrère écrivain – sans doute Théophile Gautier – qui raconte une soirée au théâtre sous l’emprise du dawamesk35. On peut définir l’effet de la drogue comme une transfiguration de tout ce qu’il perçoit à cette occasion.
Transfiguration mais aussi ultime décrochage, physique cette fois. Notre homme est mort de froid alors que tout le monde autour de lui a chaud.
C’est maintenant une femme qui se confie, et l’on songe cette fois à Jeanne Duval. Le lieu qu’elle décrit pour cette prise collective puis celui où on la porte lors de la phase d’épuisement qui fait suite à l’exaltation première font penser à l’hôtel Pimodan.
_________________ 34 Celui (celle) qui a obtenu de l’autorité compétente ce qu’il (elle) avait sollicité (charge, titre, privilège). 35 Nom d’origine de la « confiture verte » ; précision nécessaire puisque Baudelaire a relevé que le cannabis que l’on fume a de bien moindres effets.
On sait que Baudelaire y loua un petit appartement au 3° étage.
Ce témoignage est l’occasion d’évoquer la seconde phase de l’ivresse, phase que l’on pourrait qualifier d’heureuse. Il semble qu’elle soit liée à la digestion de la nourriture que l’on prend pour apaiser la faim dévorante que provoque la cuillerée de confiture verte.
Sur ce point on peut imaginer un échange entre Baudelaire et le docteur Moreau. Moyennant quoi il y a de la sagesse à avaler cette cuillerée le matin dans du café, sans autre nourriture avant midi, de façon à laisser le métabolisme lentement absorber la substance de sorte que l’on puisse en recueillir longuement les effets, sans que ceux-ci condamnent l’esprit à l’impuissance.
Ceci me paraît corroboré par une brève indication que l’on retrouvera ultérieurement dans les feuilles volantes36 de Baudelaire : « Travailler de 6 heures du matin à midi, à jeun. »
Petite notation au passage : le nom de cette ivresse heureuse en orient est le « kief » ; comme quoi les termes qui paraissent les plus artificiellement fourbis, ont eux aussi une histoire, voire une préhistoire.
C’est ainsi que « flirter » – insupportable anglicisme à l’oreille du puriste – est initialement un gallicisme, transmué par le sens inégalable de la synthèse des outre Oceano britannico37, à savoir « conter fleurette »… et non pas « compter », comme dans cette belle chanson :
On effeuilla cent fois la marguerite,
Elle tomba cent fois sur « Pas du tout »
Et notre pauvre amour a fait faillite
Il est des jours où Cupidon s’en fout… Bis
Revenons à nos haschischins et au mémoire très méthodique que Baudelaire paraît en tirer. En fait, sans toutefois le préciser, il se centre, au coeur de son exposé, sur son expérience propre.
Sa démarche est la suivante : il circonscrit le tempérament qui obtiendra de cette expérience les effets les plus amples et les plus variés.
Ce sujet théorique, il le bâtit à partir des caractéristiques suivantes :
= « Un tempérament moitié nerveux, moitié bilieux »
= « un esprit cultivé, exercé aux études de la forme et de la couleur ; un cœur tendre, fatigué par le malheur, mais encore prêt au rajeunissement. = « Le goût de la métaphysique, la connaissance des différentes hypothèses de la philosophie sur la destinée humaine ».
= « cet amour de la vertu, de la vertu abstraite, stoïcienne ou mystique,(…) comme le plus haut sommet où une âme distinguée puisse monter. »
____________________ 36 Nom de rubrique incertain comportant au moins deux des termes suivants : hygiène, conduite, morale méthode. 37 Complément de lieu, donc ablatif de la deuxième déclinaison.
Aucun doute possible : ce sujet prétendument théorique, c’est lui-même.
En outre il n’y a pas de meilleur portrait moral de Baudelaire que celui qu’il établit ici.
Et les effets de la « confiture verte » sur un tel sujet sont d’une ampleur inégalable :
1° effet = Transfiguration des couleurs et des formes.
Et, à ce propos, notation évidemment personnelle : « Fourier et Swedenborg,
l’un avec ses analogies, l’autre avec ses correspondances, se sont incarnés dans le végétal et l’animal qui tombent sous votre regard, et au lieu d’enseigner par la voix, ils vous endoctrinent par la forme et par la couleur. »
Qui donc est féru de Swedenborg en France, à cette époque ?
Deux écrivains, pour l’essentiel : Balzac, afin d’en faire de la matière romanesque ; Baudelaire, parce qu’il le prend au sérieux.
Du reste son poème « Correspondances » est directement inspiré de la théorie swedenborgienne des correspondances comme on le verra plus loin.
2° effet = Décuplement du pouvoir de pénétration de l’esprit. Baudelaire, sous couvert de son sujet type, continue à faire part de son
expérience propre : « L’intelligence de l’allégorie prend en vous des proportions à vous-même inconnues ; nous noterons, en passant, que l’allégorie, ce genre si spirituel, que les peintres maladroits nous ont accoutumés à mépriser, mais qui est vraiment l’une des formes primitives et les plus naturelles de la poésie, reprend sa domination légitime dans l’intelligence illuminée par l’ivresse. Le haschisch s’étend alors sur toute la vie comme un vernis magique ; il la colore en solennité et en éclaire toute la profondeur. »
Il est temps d’entrer au coeur du problème si l’on veut comprendre véritablement Baudelaire : il est un mystique ignoré.
Swedenborg fut à la fois un savant, un mathématicien et un fondateur de religion. Dans la seconde partie de sa vie, il écouta avec déférence ce que lui confièrent les anges et les esprits, sur l’invitation du Seigneur38 en personne.
______________________ 38 Il est très difficile de préciser ce que désigne ce terme. Étant donné que l’église de Suède, dont Swedenborg était originaire, tient majoritairement Jésus pour un homme, il semble bien qu’il s’agisse de Dieu lui-même.
On pourra dire ce qu’on voudra sur l’origine de ces révélations ; il reste qu’elles ont exercé une profonde influence, non seulement sur plusieurs églises d’Angleterre mais aussi sur les esprits des uns ou des autres.
Les premières traduction en français sont précoces mais l’édition clef de sa théologie date de 1830.
Schématiquement, le Credo qu’en tira Baudelaire peut être résumé de la façon suivante :
= Tout ce qui existe trouve son origine en Dieu.
= Cette création se répartit entre un monde matériel et un monde spirituel. = Chaque entité de l’un des mondes trouve dans l’autre son entité correspondante.
= Après la mort chacun devient esprit et choisit, au bout du compte, où il veut passer son éternité : enfer ou paradis. Ce choix émane donc de ce qu’il a choisi d’être, aussi bien dans la vie terrestre que dans la vie céleste.
On a donc là une vision irénique du terme de l’existence terrestre. Il n’y a pas de jugement dernier. Chaque être humain se voit ainsi restituer sa pleine et entière responsabilité dans la conduite de son existence, aussi bien ici-bas que dans l’au-delà.
D’autre part chacun devenu esprit après la mort peut prendre en charge certaines missions dans le monde matériel.
Il n’y a pas de Prince des ténèbres pour Swedenborg ; ceux qui portent le nom de Satan sont ceux qui ont opté pour l’enfer parce qu’ils voulaient retrouver, post mortem, le monde où ils avaient vécu.
C’est donc grâce à Swedenborg que Baudelaire conservera toute sa vie une foi inébranlable, croyant non seulement à l’existence de Dieu mais encore intimement persuadé de sa sollicitude.
De là sa prière quotidienne, ses résolutions renouvelées, ses appels à Mariette et à son père. On peut ici formuler l’hypothèse qu’au moment de mourir, ce père si pieux et si bienveillant pour ses enfants les avait fait venir pour leur promettre de veiller sur eux une fois arrivé au ciel.
En outre, sur le plan théorique, il retrouve dans le clivage monde matériel / monde spirituel, le dualisme platonicien monde sensible / monde intelligible, les deux conceptions ayant une différence essentielle avec la doxa chrétienne, c’est que pour Platon aussi bien que pour Swedenborg, l’autre monde est à portée d’esprit.
La poésie a donc le pouvoir d’accéder temporairement à cette terre promise.
A ce coeur de sa religion Baudelaire ajoutera – composant par là une sorte de tableau spirituel qui n’appartient qu’à lui – plusieurs éléments plus spécifiquement catholiques, notamment les sacrements.
Et puis une touche de jansénisme puisque la lecture de Pascal affleure de façon récurrente dans ses réflexions.
Cependant, en bon chrétien – et contrairement à Swedenborg – il est intimement persuadé de l’existence du péché originel. Plus profondément il y a pour lui, dans le monde, un mal radical. Cette certitude lui viendra en particulier des épreuves douloureuses qu’il aura à traverser.
A cet égard il est plus proche de Pascal qu’il nomme du reste dans le poème intitulé « Le gouffre » (cf. Polycopié n°5). Et cette fois le sommeil réparateur est aboli, sans parler de la chute ; celle du poème, pas celle de la damnation divine.
.La frayeur engendrée par ces espaces infinis est telle que, tout compte fait, il eut mieux valu ne pas advenir à l’existence. De là ce vers étrange : « Ah ! Ne jamais sortir des nombres et des êtres ! »
Baudelaire a beau être continuellement partagé entre l’idéal religieux et le sentiment d’un mal insurmontable, il n’en demeure pas moins selon l’intelligence tardive que les critiques ont eu de son oeuvre, « un poète chrétien » ; c’est l’heureuse expression de Marcel Proust 39.
____________________ 39 Lettre de 1905 à Inès Fortoul.
Ceci ne signifie évidemment pas un chantre du catholicisme mais une âme en voie de conversion, capable de blasphémer à l’occasion, comme il l’indique aussi.
Voilà pourquoi le « Poème du haschich », première partie des « Paradis artificiels », est en réalité une fable. Mais dans le sens de La Fontaine puisqu’il s’achève sur une morale.
Et Baudelaire y est formel : il faut à tout prix éviter de tomber dans l’esclavage du « dawamesk ». Passage non équivoque :
« (…) tout homme qui n’accepte pas les conditions de la vie, vend son âme.
Il est facile de saisir le rapport qui existe entre les créations sataniques des poètes et les créatures vivantes qui se sont vouées aux excitants. L’homme a voulu être Dieu, et bientôt le voilà, en vertu d’une loi morale incontrôlable, tombé plus bas que sa nature réelle. C’est une âme qui se vend en détail. »
A ne pas confondre avec la sentence pascalienne « (..) qui veut faire l’ange, fait la bête. » L’homme rejetant sa condition est d’abord, selon Baudelaire, celui qui recherche la puissance ; selon Pascal, il est celui qui recherche la perfection.
Ceci dit, il examine ensuite en quoi pourrait consister un usage tempéré du haschich. Il paraît donc évident, à ce stade, qu’il l’a en effet mis au point pour lui- même. Sans doute finit-il par le condamner mais avec moins de vigueur que précédemment.
C’est qu’ici, une fois de plus, il est partagé, il oscille. Quelques séquences éclairantes :
= La perspective : « tirer du haschisch de grands bénéfices spirituels, en faire une espèce de machine à penser, un instrument fécond »
= Sa contrepartie morale : « au prix de sa dignité, de son honnêteté et de son libre arbitre »
= L’expérience personnelle : « Il est vrai que cet individu est pour ainsi dire cubé 40 et poussé à l’extrême, et comme il est également certain que la mémoire des impressions survit à l’orgie, l’espérance de ces utilitaires ne paraît pas au premier aspect tout à fait dénuée de raison. »
= L’empêchement : « il est de la nature du haschisch de diminuer la volonté, et qu’ainsi il accorde d’un côté ce qu’il retire de l’autre, c’est-à-dire l’imagination sans la faculté d’en profiter. »
= La confidence : « Enfin il faut songer, en supposant un homme assez adroit et assez vigoureux pour se soustraire à cette alternative, à un autre danger, fatal, terrible, qui est celui de toutes les accoutumances. Toutes se transforment bientôt en nécessités. »
_______________ 40 porté au cube, donc deux fois multipliée par soi-même.
Nul doute que Baudelaire n’ait été cet homme adroit et vigoureux qui sut user du dawamesk avec mesure et discernement. Mais c’était en même temps se placer sous le joug de la dépendance, ainsi qu’il en fit également l’expérience.
Voilà pourquoi le terme de cette réflexion morale est une proscription sans équivoque du haschich, même dans cet usage que l’on pourrait qualifier de tempéré.
En conclusion les paradis artificiels sont des illusions destructrices.
Question de l’auteur à son lecteur : « Qu’est-ce qu’un paradis qu’on achète au prix de son salut éternel ? »
« Acheter » est ici à entendre « au cube » : pour se procurer cette confiture verte il faut aussi en payer le prix en numéraire et, quand on n’a pas d’argent, commettre des malhonnêtetés.
Si donc l’on veut gagner le paradis, le vrai, il faut oeuvrer sur terre pour le bien. Et selon le bien. Suit une étonnante évocation du paradis céleste, évocation universaliste, puisqu’on y trouve aussi bien les houris que les muses. Elle est en somme dans la lignée de Swedenborg qui aspirait à édifier une religion universelle.
Voici enfin le secret de la rédemption : « par le travail ».
On conviendra qu’on est ici à 100 lieues de l’image d’Épinal de Baudelaire.
2) Ut pictura poesis
Dans cette résolution le cher Honoré a probablement été le modèle de Charles. Celui-ci relate en effet l’épisode suivant :
« Balzac pensait sans doute qu’il n’est pas pour l’homme de plus grande honte ni de plus vive souffrance que l’abdication de sa volonté. Je l’ai vu une fois, dans une réunion où il était question des effets prodigieux du haschisch. Il écoutait et questionnait avec une attention et une vivacité amusantes. Les personnes qui l’ont connu devinent qu’il devait être intéressé. Mais l’idée de penser malgré lui-même le choquait vivement. On lui présenta du dawamesk ; il l’examina, le flaira et le rendit sans y toucher. La lutte entre sa curiosité presque enfantine et sa répugnance pour l’abdication se trahissait sur son visage expressif d’une manière frappante.
L’amour de la dignité l’emporta. En effet, il est difficile de se figurer le théoricien de la volonté, ce jumeau spirituel de Louis Lambert, consentant à perdre une parcelle de cette précieuse substance. »
Bref, le café, oui ; le haschich, non.
Cette « précieuse substance », c’est la volonté.
Pour Baudelaire elle ne va pas de soi. Voilà pourquoi il s’exhorte quotidiennement par la prière à se mettre au travail.
Et il enchaîne avec une nouvelle brochure : « Le salon de 1846 ».
Or, d’une année sur l’autre, le ton a complètement changé.
Cette brochure-là commence par une apostrophe apologétique aux bourgeois. Les bourgeois sont, écrit Baudelaire « le nombre et la puissance ».
Il ne leur manque que d’être savants.
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il n’y a aucune perfidie dans cette entrée en matière. Comme notre poète sait gré à cette nouvelle classe dominante d’avoir institué des musées, d’encourager les arts, il se propose de mettre à sa disposition, par le moyen de ces quelques pages, ce qu’il sait, l’ayant éprouvé, de la création artistique.
Il ne s’agit donc pas de décerner des palmes ou d’élever des verges.
Baudelaire propose en effet une critique sensible et poétique, capable de faire entrer son lecteur dans l’intimité de l’oeuvre.
Voici en quels termes :
« Je crois sincèrement que la meilleure critique est celle qui est amusante et poétique ; non pas celle-ci, froide et algébrique, qui, sous prétexte de tout expliquer, n’a ni haine ni amour, et se dépouille volontairement de toute espèce de tempérament ; mais, — un beau tableau étant la nature réfléchie par un artiste, — celle qui sera ce tableau réfléchi par un esprit intelligent et sensible. Ainsi le meilleur compte rendu d’un tableau pourra être un sonnet ou une élégie. »
Bref « ut pictura poesis », ainsi que l’a formulé autrefois Horace dans son « Ars poetica » : « Comme la peinture est la poésie ». Plus explicite encore est la formule que Jacques Amyot 41 rapporte dans ses « Oeuvres morales » en 1572, l’attribuant au poète Simonide de Chéos (ou Kos) :
« Simonide dit que la peinture soit une poésie muette, et la poésie une peinture parlante. »
__________________ 41 1513-1593. Né pauvre, il parvient par son travail à accéder à des fonctions élevées, devenant en particulier évêque. Hormis ses charges il fut aussi le traducteur de Plutarque.
Hommage à lui rendu : « Je donne, avec raison, ce me semble, la palme à Jacques Amyot sur tous nos écrivains français » ; signé Montaigne.
De là Baudelaire tire ce qui sera sa ligne de conduite comme critique pictural :
« pour être juste, c’est-à-dire pour avoir sa raison d’être, la critique doit être partiale, passionnée, politique, c’est-à-dire faite à un point de vue exclusif, mais au point de vue qui ouvre le plus d’horizons.»
Comme la suite le montre – et comme nous l’avions déjà vu dans « Le salon de 1845 » – il ne s’agit pas de pinailler sur la finition, sur le trait ou la façon d’user de la couleur.
Il s’agit de s’emparer, en ouvrant l’horizon de sa réception le plus largement possible, de ce que le peintre a voulu non pas tant représenter que présenter – id est rendre présent – et à partir de là, apprécier ce qu’il a pu capter, capturer, de l’essence de la chose.
Le criterium du jugement critique, c’est la nature. En d’autres termes ce que les choses et les êtres sont en eux-mêmes, tels qu’ils surgissent dans l’existence.
Et ici, de façon doublement surprenante, Baudelaire cite Stendhal : « La peinture n’est que de morale construite ! ». Il n’entre pas dans les détails, cherchant seulement un écho à son intuition.
Néanmoins il est bon de préciser que cette citation est extraite d’une note relative au chapitre de « L’histoire de la peinture en Italie » que Stendhal consacre à Michel-Ange et qu’elle est précédée d’une subordonnée conditionnelle :
« Si je parlais à des géomètres, j’oserais dire ma pensée telle qu’elle se présente : la peinture n’est que de la morale construite. »
Autre précision : le contexte incline à entendre par « morale » ce qui est relatif aux moeurs. Ce que cherche à montrer Stendhal, c’est qu’entre Michel-Ange et ses prédécesseurs, l’expression des visages a changé.
Baudelaire ne veut sans doute pas dire la même chose ; mais il est judicieux pour lui de se placer sous ce patronage.
=> Côté Beyle : les oeuvres sont soumises aux critères socio-culturels de l’époque où elles surgissent.
=> Côté Baudelaire : l’oeuvre d’art véritable s’empare de l’essence de ce qu’elle représente ; voilà pourquoi c’est aussi celle qui est en mesure de traverser les siècles.
Et, paradoxalement, ils ont raison tous les deux.
= Baudelaire, en tant qu’il est en effet un critique à la fois sensible et singulier, va encourager cette créativité en l’affranchissant du joug de l’académisme.
Mais cette ouverture à la modernité de la peinture va engendrer à son tour une première époque, celle de l’impressionnisme, époque qui évoluera à son tour vers la liberté totale, s’illustrant en particulier dans la peinture abstraite.
= Stendhal n’a rien inventé. Comme c’est souvent le cas chez lui, hormis la création romanesque, il s’est livré à une compilation méthodique de tout ce qui avait paru sur le sujet. C’est ce savoir encyclopédique qu’il a mis en synergie avec ses découvertes sur le terrain, à la fois sur le plan de l’émotion esthétique et sur celui du repérage des caractéristiques historiques.
A partir de là Baudelaire réalise une synthèse entre l’indépassable singularité de l’oeuvre et la prise en charge, par son auteur, des critères de son époque.
Citation : « Que vous entendiez ce mot de morale dans un sens plus ou moins libéral, on en peut dire autant de tous les arts. Comme ils sont toujours le beau exprimé par le sentiment, la passion et la rêverie de chacun, c’est-à-dire la variété dans l’unité, ou les faces diverses de l’absolu, – la critique touche à chaque instant à la métaphysique. »
Bref, il y a toujours, dans l’oeuvre, un au-delà de la représentation et il est double : un sujet singulier et une conception du monde.
On conviendra que cette intelligence enveloppante du regard de Baudelaire est fort éloignée du pinaillage sur l’exécution. Elle tient avant tout à son expérience de poète.
Ensuite notre critique émérite aborde ce qu’on pourrait nommer « la morale esthétique » de l’époque : le romantisme. Et il va s’appliquer à traquer son essence.
Après avoir convenu d’une part que le romantisme est la manière actuelle de se mettre en quête du beau, d’autre part qu’il y a autant de conceptions de la beauté qu’il y en a du bonheur, Baudelaire se jette à l’eau :
« Qui dit romantisme dit art moderne, – c’est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers l’infini, (…) »
Se jette à l’eau et butte aussitôt sur un écueil : « (…) il y a une contradiction évidente entre le romantisme et les œuvres de ses principaux sectaires. »
Après une digression sur les sensibilités opposées du Nord et du Sud – laquelle se concrétise par une brève comparaison entre Rembrandt et Raphaël – Baudelaire annonce qu’il a trouvé un peintre authentiquement romantique.
Mais son patient lecteur devra attendre. Il consacre en effet le chapitre suivant à la couleur. C’est très beau, très poétique ; ça ressemble à un tableau où Cézanne et Van Gogh auraient chacun mis alternativement leurs touches.
C’est à l’occasion de cette analyse qu’il retrouve, sous la plume d’Hoffmann 42, une confirmation de la théorie des correspondances de Swedenborg :
« Ce n’est pas seulement en rêve, et dans le léger délire qui précède le sommeil, c’est encore éveillé, lorsque j’entends de la musique, que je trouve une analogie et une réunion intime entre les couleurs, les sons et les parfums. Il me semble que toutes ces choses ont été engendrées par un même rayon de lumière, et qu’elles doivent se réunir dans un merveilleux concert. »
________________ 42 1776-1822 Ernst Theodor Hoffmann fut compositeur et écrivain, mais aussi dessinateur. C’est comme auteur des Contes qu’il est resté célèbre, en particulier « Casse-noisette ».
Chapitre qui se clôt sur une analyse des deux tempéraments qui se partagent la création picturale et dont voici la conclusion :
« Les purs dessinateurs sont des philosophes et des abstracteurs de quintessence. Les coloristes sont des poètes épiques. »
Et le chapitre suivant porte pour titre le nom de l’unique peintre véritablement romantique, sans surprise : Eugène Delacroix.
Baudelaire avait déjà célébré, l’année précédente, sa « Madeleine au désert » ; cette fois il va s’efforcer de restituer tout le bonheur qu’il éprouve dans la contemplation des oeuvres de celui qui, par elles, est devenu, citation : « mon sujet le plus cher et le plus sympathique ».
Et pour qu’on ne ramène pas cette célébration à sa pure subjectivité, il cite longuement un critique du salon de 1826 : M. Thiers.
Et il s’agit bien d’Adolphe Thiers, journaliste dans sa jeunesse et engagé ensuite dans un parcours politique mouvementé. Plus tard, opposé au Second Empire, il se fera historien.
Eh bien Adolphe Thiers se voit décerner la palme du jugement droit par Charles Baudelaire qui loue sans retenue son audace : « Ces lignes enthousiastes sont véritablement stupéfiantes autant par leur précocité que par leur hardiesse.
Suit une récapitulation du parcours du peintre célébré, alors dans sa jeunesse, dont on sent que Baudelaire, composant lui aussi un tableau touche après touche, est en train de faire le porte flambeau du romantisme en peinture.
Porte flambeau et porte drapeau puisque, pour avoir péché contre l’académisme alors régnant, Eugène Delacroix se voit bientôt privé des commandes d’État.
Après quoi notre futur poète s’emploie à démonter le parallèle non fondé que certains avaient établi, comme chantres du romantisme, entre Delacroix et Victor Hugo. Suivent des lignes impayables sur Victor Hugo puisqu’elles sont à la fois sans concession aucune et d’une rigoureuse exactitude.
Récréation au passage :
« M. Hugo était naturellement académicien avant que de naître, et si nous étions encore au temps des merveilles fabuleuses, je croirais volontiers que les lions verts de l’Institut, quand il passait devant le sanctuaire courroucé, lui ont souvent murmuré d’une voix prophétique : « Tu seras de l’Académie ! » »
De fait il y était entré 5 ans plus tôt.
Nul doute que l’un ou l’autre de ses familiers n’ait placé cet article entre les mains de Victor, ou Totor, selon le diminutif familier de Juliette Drouet.
Mais si cet homme-là n’a pas de génie, en revanche il ne manque pas de générosité. Et puis, contrairement à son acerbe critique, il sait ce que c’est que le pardon.
N’anticipons pas ; retour au salon de 1846.
Ou, plutôt, à Delacroix. Cette fois Baudelaire est entré dans l’atelier du peintre, qu’il s’agisse de visites ou de confidences, et nous fait part de son extrême rigueur dans l’organisation du travail.
Le problème, c’est qu’on n’a pas encore mis le pied dans ce salon de 1846… En plus il revient sur le tableau déjà célébré l’année précédente : Dante et Virgile aux enfers, tableau datant de 1822.
C’est que cette évocation est pour lui une source d’inspiration, l’oeuvre à partir de laquelle il est en mesure d’élaborer et d’énoncer son esthétique.
Passage éloquent :
« Un tableau de Delacroix, Dante et Virgile, par exemple, laisse toujours une impression profonde, dont l’intensité s’accroît par la distance. Sacrifiant sans cesse le détail à l’ensemble, et craignant d’affaiblir la vitalité de sa pensée par la fatigue d’une exécution plus nette et plus calligraphique, il jouit pleinement d’une originalité insaisissable, qui est l’intimité du sujet. »
Et plus loin, histoire de rétorquer aux persiflages des sculpteurs et affiliés :
« (…) le mouvement, la couleur et l’atmosphère. Ces trois éléments demandent nécessairement un contour un peu indécis, des lignes légères et flottantes, et l’audace de la touche. »
C’est que cette toile est loin d’être simplement « un exemple » de l’oeuvre de Delacroix. Elle est sans doute celle qui illustre le plus parfaitement son art.
Dans « La divine comédie » Virgile est en effet le guide que Dante va suivre dans son périple aux enfers at dans le purgatoire. Après quoi il retrouvera sa chère Béatrice.
Il faut donc que la toile ait le même pouvoir de subjuguer l’imagination que le poème. Et c’est en effet ce à quoi parvient Delacroix dans cette représentation du passage du Styx.
Poursuivant son apologie, Baudelaire revient, sans le dire, sur la Madeleine 43 de l’année précédente, indiquant que son peintre de prédilection est capable du même prodige de « présence réelle », pour reprendre le concept de George Steiner 44, dans les sujets religieux.
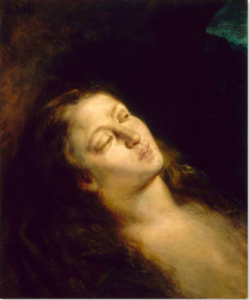
Plus haut, à cet égard et au passage, il s’est judicieusement emparé, pour isoler le génie de ce peintre, du couple métaphorique accouchement / enfantement.
Parmi les artistes de la peinture il y a ceux qui accouchent, id est produisent un tableau selon les règles académiques mais dont on ne sait pas s’il survivra.
Et il y a ceux qui enfantent, c’est-à-dire créent une entité vivante qui parle à ceux qui la contemplent et qui conserve, dans la suite des temps, ce pouvoir de subjuguer.
Et Baudelaire évoque, l’un après l’autre, ces sujets religieux des tableaux de Delacroix que ses lecteurs connaissent et dont ils doivent convenir de la puissance suggestive.
Au passage, parallèle entre la Pieta et la série d’illustrations que Delacroix réalisa pour une édition d’Hamlet. Précisons que Baudelaire avait pour Shakespeare la plus grande admiration. Mais c’est la Pieta, id est la Vierge recevant le corps de Jésus descendu de la croix 45 qui emporte ses suffrages.
Et comme souvent, expression fulgurante du critique : « (…) Delacroix seul sait faire de la religion (…) »
C’est l’occasion d’une profession de foi singulière : « (…) la tristesse sérieuse de son talent convient parfaitement à notre religion, religion profondément triste, religion de la douleur universelle, et qui, à cause de sa catholicité même, laisse une pleine liberté à l’individu (…) »
____________________ 43 Ne pas confondre la Madeleine de Delacroix et la madeleine de Proust. 44 « Présences réelles », 1991.
45 Delacroix… It wasn’t on purpose.
Pour mémoire, en grec, « καθολικός » signifie « universel » ; il faut donc entendre ici, par « catholicité », « universalité ». C’est précisément la dimension de la religion que l’on retrouve à la fois chez Swedenborg et Joseph de Maistre, les deux maîtres à penser de Baudelaire en la matière.
Baudelaire sort provisoirement de Delacroix avec une exquise politesse, énumérant les tableaux qu’il a trouvé imparfaits, mais sans préciser le nom des artistes, excepté qu’ils sont des élèves d’Ingres.
Certes Jean-Auguste Ingres a du talent mais il ne sait rien de la lumière.
Ce n’est pas le cas d’Eugène Delacroix qui, même dans ses oeuvres gigantesques (plafonds de l’Assemblée nationale et de la bibliothèque du palais du Luxembourg ) en met toujours ce qu’il faut.
C’est l’occasion d’autres éloges adressés à son peintre favori, portant successivement => sur le développement d’un talent nouveau : l’art du paysage,
=> sur l’affranchissement à l’égard des convention relatives au sujet. Plutôt que d’opter, comme ses prédécesseurs, pour Apollon et les muses, Delacroix a préféré, une fois encore, accompagner Dante sur les pas de Virgile.
Et Baudelaire de citer longuement Alighieri, certain d’avoir retrouvé le passage – hypothèse ou confidence – qui avait inspiré le peintre.
Occasion d’une nouvelle mise en synergie de la peinture et de la poésie.
C’est que si l’on veut transmettre « l’esprit de cette peinture », pour reprendre sa formulation, c’est seulement par le langage poétique qu’il est possible de le faire, restituant « (…) tout le calme bienheureux qu’elle respire, et la profonde harmonie qui nage dans cette atmosphère.»
On en vient enfin aux toiles exposée au Salon de 1846… à commencer par quatre oeuvres de Delacroix. Cette analyse achevée, notre critique n’en a pas fini pour autant avec « son frère dans l’art », si l’on peut dire.
Le trait constant d’Eugène Delacroix, c’est la mélancolie. Et Baudelaire s’applique ensuite à la traquer dans l’ensemble de son oeuvre. Il termine sur une brève évocation des élèves du maître.
Ensuite, comme il faut bien passer à autre chose, Baudelaire aborde, citation : « M. Tassaert, dont j’ai eu le tort grave de ne pas assez parler l’an passé. »
Compte vite réglé néanmoins ; après avoir convenu – comme on le lui demandait sans doute – que ce M. Tessaert était un artiste de talent, il analyse l’une des deux oeuvres exposées, représentant un marché de femmes qu’il imagine en Turquie ; extrait : « Celle qui est vue de dos, et dont les fesses sont enveloppées dans une gaze transparente, a encore sur la tête un bonnet de modiste, un bonnet acheté rue Vivienne ou au Temple. La pauvre fille a sans doute été enlevée par les pirates. »
Morale de l’épisode : on n’affronte pas Charles Baudelaire sans qu’il se cabre de toute sa force. Si pourtant il est tenu de revenir à la raison, alors il peut être d’une ironie cinglante.
Histoire d’en rajouter Baudelaire fait ensuite une brève apologie d’un peintre ethnologue méconnu, qui « ne fait pas de peinture crâne » comme il est dit ; sous- entendu, « comme M. Tassaert ».
Il s’agit de George Catlin, peintre américain spécialisé dans la représentation des Indiens, dont chacun, encore aujourd’hui, a pu voir les oeuvres, ici ou là.

Suit une sorte de promenade dans le salon virtuel où l’on passe devant les oeuvres en prenant juste le peu de temps qu’il faut pour nommer leur auteur. L’arrêt un peu prolongé devant les oeuvres de M. Decamps fournit l’occasion d’appeler une nouvelle fois Delacroix à la rescousse.
La visite reprend avec la même légèreté, en omettant à nouveau de s’attarder pour de nouvelles critiques. Quelques lignes pour chacun de ces artistes amateurs et puis la réflexion esthétique reprend le dessus.
C’est l’objet du chapitre suivant, intitulé « De l’idéal et du modèle ».
S’il restait quelque doute sur la question, il faut se rendre à l’évidence : Baudelaire, visitant ces expositions, n’entend pas « faire de la communication » ou, plus exactement, ne s’y entend pas.
Visiter ces salons est avant tout pour lui l’occasion de poursuivre sa réflexion philosophique sur le beau. Evidemment, comme il faut bien s’efforcer de gagner sa vie, il oscille en permanence entre la contrainte éditoriale et l’attraction qu’exerce l’oeuvre sur son esprit lorsqu’elle parvient à atteindre cet idéal auquel il aspire lui-même en poésie.
Comme en outre, ainsi qu’on l’a vu, il a aussi un bon coup de crayon, il a fait, dans l’art pictural, cette expérience essentielle de ce qu’il nomme ici l’idéal.
Citation éclairante : « Le titre de ce chapitre est une contradiction, ou plutôt un accord de contraires ; car le dessin du grand dessinateur doit résumer l’idéal et le modèle. »
Et cette captation, ici et maintenant, dans le trait, de ce qui vibre de façon ineffable dans le modèle – fragile et transitoire par nature – c’est bien, en effet, « la présence réelle ».
Suit une audacieuse métaphore mathématique : « La circonférence, idéal de la ligne courbe, est comparable à une figure analogue composée d’une infinité de lignes droites, qui doit se confondre avec elle, les angles intérieurs s’obtusant 46 de plus en plus. »
Il s’agit donc de tendre le plus possible, ut pictura ut poetica 47, vers l’idéal, celui-ci n’étant, au bout du compte, jamais atteint, puisqu’il faut nécessairement passer par l’incarnation.
____________________ 46 Ce n’est pas, comme on pourrait le croire, un néologisme inventé par Baudelaire ; seulement un emploi audacieux de la forme pronominale. Obtuser : rendre plus obtus, en parlant d’un angle. S’obtuser : devenir plus obtus, plus étroit d’esprit… puisque, paradoxalement, c’est l’esprit aigu qui étant le plus pénétrant, saisit mieux le sens de ce qui, à un titre ou un autre, diffère de lui. 47 « Pour la peinture comme pour la poésie ».
Quelques étapes clefs de cette réflexion : « L’art est une mnémotechnie du beau ».
Puis quelques lignes qui ont sans doute enchanté Marguerite Yourcenar, baudelairienne convaincue : « à l’Apollon du Belvédère et au Gladiateur je préfère l’Antinoüs, car l’Antinoüs est l’idéal du charmant Antinoüs. »
Par où l’on voit que l’oeuvre est seulement la corde de rappel qui – dans la lignée de Platon et de Swedenborg – nous met, pendant quelques secondes enchantées, en relation avec l’essence de la beauté.
Et c’est toujours selon le clivage monde sensible / monde intelligible que la suite peut se lire : « Quoique le principe universel soit un, la nature ne donne rien d’absolu, ni même de complet (…) »
Après quoi notre philosophe esthéticien développe longuement le thème de la singularité – aucune pomme n’est identique à une autre, pour faire simple – et sa conséquence sur la nature formelle du travail de l’artiste : retrouver, au delà de ce singulier du modèle, l’universel de l’idéal – ou de l’idéel – c’est-à-dire du principe immatériel avec lequel il est en correspondance.
Ensuite Baudelaire s’engage dans une subtile comparaison entre les dessinateurs – qui sont « naturalistes » de nature, id est arrimés à l’ici-bas – et les coloristes en quête de l’idéal. De là une déduction sans équivoque : « Un dessinateur est un coloriste manqué. »
Représentant le plus éminent de ce groupe : Ingres, lequel marche dans les pas de son illustre prédécesseur : Raphaël.
Baudelaire n’est pas tendre pour les disciples qu’il nomme « ingristes » et qu’il exécute les uns après les autres. Au passage il égratigne Théophile Gautier qui a eu le malheur de louer Vidal, le pire des représentants de cette école.
Ensuite notre méthodique critique entreprend d’appliquer ce clivage à l’art du portrait. Ingres étant passé maître en la matière, le lecteur averti se dit que Baudelaire va se mettre en quête d’un portraitiste coloriste.
Cette fois c’est par l’illustre prédécesseur de Delacroix qu’il commence : Rembrandt.
Et l’on pense aussitôt à l’extraordinaire série des autoportraits. Par quoi il faut convenir que Baudelaire a raison : c’est bien l’ajournement du trait du dessinateur qui permet de préserver, par le « floutage » de la couleur, la « présence réelle » qui émane du portrait
Mais du coup surgit aussitôt la question : dans quelle catégorie Baudelaire placerait-il l’auteur du portrait superlatif, la Joconde ?
Il semble qu’il ait éludé la question ; il n’en consacrera pas moins un quatrain à Léonard de Vinci dans son poème intitulé « Les phares », voué à recenser les peintres éclaireurs de l’humanité souffrante.
Et puis, comme dans le Salon précédent, suit une galerie des peintres mineurs qui ne valent pas qu’on s’arrête devant leurs oeuvres beaucoup plus de temps qu’il n’est nécessaire pour relever les indispensables indications.
Bref chapitre consacré aux deux marottes de la critique d’alors : « Le chic et le poncif 48 ».
________________ 48 Probablement le dessin reproduit par ponçage. On pique, sur toute la longueur de ses lignes, le dessin avec une aiguille ; on remplit les trous avec une poudre colorée ; on transfère, par ponçage, les traits sur un autre support.
Après quoi, dans la même veine, une véritable charge contre « M. Horace Vernet », « militaire qui fait de la peinture » (sic)
Et ici, évidemment, occasion immanquable de se défouler des vexations infligées par son militaire de beau-père.
Cette charge initie ce que Baudelaire nomme plus loin « l’hôpital de la peinture ».
Il y déploie la même pénétration d’esprit que dans ses éloges et il est impitoyable pour les peintres dont il juge les oeuvres irrecevables, ce qu’il justifie toujours avec la plus grande précision.
Autre thème abordé ensuite : le paysage. La démarche est toujours aussi méthodique mais ne s’interdit jamais les digressions. De là cette incise à propos de ce qu’on pourrait nommer la « désincarnation » des représentations du tragique :
« J’ai entendu dire à un poète ordinaire de la Comédie-Française que les romans de Balzac lui serraient le cœur et lui inspiraient du dégoût ; que, pour son compte, il ne concevait pas que des amoureux vécussent d’autre chose que du parfum des fleurs et des pleurs de l’aurore. » En bref, l’idéal n’est pas l’irréel.
Nouvelle charge à propos de ce qu’on nomme « le paysage tragique » contre lequel Baudelaire déploie tout le persifflage dont il est capable : « Vous comprenez maintenant ce que c’est qu’un bon paysage tragique. C’est un arrangement de patrons d’arbres, de fontaines, de tombeaux et d’urnes cinéraires. Les chiens sont taillés sur un certain patron de chien historique ; un berger historique ne peut pas, sous peine de déshonneur, s’en permettre d’autres. Tout arbre immoral qui s’est permis de pousser tout seul et à sa manière est nécessairement abattu ; toute mare à crapauds ou à têtards est impitoyablement enterrée. »
Ensuite, comme précédemment, défilé des paysagistes. Et puis libre promenade parmi les oeuvres des exposants. Un seul trouve grâce aux yeux du poète : Rousseau. Pas Jean-Jacques, évidemment ; ni Henri, dit « le douanier ». Philippe Rousseau. Et il a raison, Baudelaire ; il suffit d’y aller voir.
Humbles sujets mais peintures admirables. Animaux familiers, à la ferme ou dans les fables de La Fontaine ; natures mortes en cuisine ou dans la salle-à- manger… tout est admirablement rendu : le velouté des pêches, la douce fourrure du lapin, l’asperge ou le grain de raisin jouant avec la lumière, l’intrépidité du rat…
Parmi les derniers chapitres on trouve : « Pourquoi la sculpture est ennuyeuse ».
Le lecteur attentif le sait déjà : parce qu’elle est, au cube, l’art exclusif du dessinateur.
Ici, justement, rien de ce pouvoir de fascination que le plus petit tableau de Philippe Rousseau exerce toujours.
Et notre critique d’art – moins consciencieux que passionné par son sujet – débouche, pour finir, sur une sociologie de la transition dans le domaine de l’art.
Autrefois les maîtres ; désormais les ouvriers émancipés.
En bref, la société populaire qui prend la suite de la société aristocratique a, dans le domaine de l’art, aboli les écoles et, par là, fait prospérer la médiocrité.
Citation : « Peu d’hommes ont le droit de régner, car peu d’hommes ont une grande passion. Et comme aujourd’hui chacun veut régner, personne ne sait se gouverner. »
Finalement c’est une chance que Baudelaire soit né tôt et mort à 46 ans. Autrement la proposition d’une peinture libérée de toutes les contraintes l’aurait rendu fou.
Reste cet étonnant pouvoir d’anticipation : « Cette glorification de l’individu a nécessité la division infinie du territoire de l’art. La liberté absolue et divergente de chacun, la division des efforts et le fractionnement de la volonté humaine ont amené cette faiblesse, ce doute et cette pauvreté d’invention ; quelques excentriques, sublimes et souffrants, compensent mal ce désordre fourmillant de médiocrités. L’individualité, – cette petite propriété, – a mangé l’originalité collective ; et, comme il a été démontré dans un chapitre fameux d’un roman romantique, que le livre a tué le monument, on peut dire que pour le présent c’est le peintre qui a tué la peinture. »
Ce roman qui professe que le livre a remplacé le monument, c’est évidemment « Notre-Dame de Paris » de Victor Hugo, publié en 1831.
Rappel du passage clef du chapitre intitulé « Ceci tuera cela » : « Pour démolir la parole construite, il faut une révolution sociale, une révolution terrestre. Les barbares ont passé sur le Colisée, le déluge peut- être sur les Pyramides. Au quinzième siècle tout change. La pensée humaine découvre un moyen de se perpétuer non seulement plus durable et plus résistant que l’architecture, mais encore plus simple et plus facile. L’architecture est détrônée. Aux lettres de pierre d’Orphée 49 vont succéder les lettres de plomb de Gutenberg. Le livre va tuer l’édifice. L’invention de l’imprimerie est le plus grand évènement de l’histoire. C’est la révolution mère. C’est le mode d’expression de l’humanité qui se renouvelle totalement, c’est la pensée humaine qui dépouille une forme et qui en revêt une autre, c’est le complet et définitif changement de peau de ce serpent symbolique qui, depuis Adam, représente l’intelligence. » (Pas tout à fait, Totor ; nouvelle mue avec internet.)
Deux remarques à ce propos :
=> Baudelaire est un lecteur attentif de Victor Hugo parce que celui-ci, quoi qu’il en dise en outre, est lui aussi, comme Théophile Gautier, un maître, non pas tant en versification qu’en liberté de la pensée.
Seulement, dans ce passage, il aurait pu le citer, ce qu’il ne fait pas.
Pourtant, dans une anthologie à venir « Les poètes français 50 », où il prendra en charge, parmi d’autres, le chapitre consacré à Victor Hugo, il sera à la fois incroyablement élogieux et pénétrant.
Plusieurs critiques, à cet égard, qualifie Baudelaire d’hypocrite ; c’est une erreur. Pour être hypocrite il faut avoir une grande maîtrise de soi, être comédien, ne se laisser commander que par le calcul.
Il est vrai qu’à certains égards, on peut tenir Baudelaire pour un comédien. Mais aucun des deux autres traits ne se trouve chez lui.
Il est donc simplement versatile. Un peu comme sur le plan religieux, au fond, oscillant en permanence entre le catholicisme tragique et l’irénisme luthérien de Swedenborg.
=> C’est en 1846, à l’occasion de ce Salon, que se constitue le fond – comme pour un tableau – de la pensée politique de Baudelaire. Il est et demeurera, en dépit de l’épisode ultérieur des barricades, profondément aristocratique, non seulement dans ses goûts personnels mais aussi dans ses options politiques.
Nous verrons plus loin pour quels motifs.
_____________________ 49 Orphée, haute figure légendaire, est supposé être l’origine des rites orphiques. Il pouvait arriver que l’on gravât dans la pierre les différentes phases de cette initiation ainsi que le nom des initiés. 50 « Les poètes français : recueil des chefs-d’oeuvre de la poésie française depuis les origines jusqu’à nos jours. », sous la direction d’Eugène Crépet, édité en 1862.
Ce salon s’achève sur une analyse de ce que notre poète nomme « la beauté moderne » et se clôt sur une apostrophe au grand Balzac dont on aurait très bien pu, d’après lui, figurer les personnages sur des tableaux, comme les artistes antiques représentèrent en leur temps les hautes figures de leur mythologie.
3) La Fanfarlo
Court roman ou longue nouvelle dont le titre étrange est le surnom du personnage féminin autour duquel gravite l’intrigue.
Les éminents critiques universitaires achoppent généralement sur cette création littéraire dont ils ne comprennent pas ce qu’elle fait là, Baudelaire ayant clairement opté, peu de temps plus tôt, pour la poésie.
Ce qu’il ne faut jamais oublier avec Baudelaire et Balzac, c’est qu’ils n’ont pratiquement que leur plume pour couvrir leurs dépenses.
C’est aussi ce qui fonde entre eux un autre rapprochement possible : quand on n’a qu’un mois pour découper et coudre un roman, le mieux est encore d’aller chercher de la toile dans la trame de sa propre existence.
C’est ce qu’ils firent tous les deux.
« La Fanfarlo », c’est l’équivalent de « Louis Lambert ».
Or ce récit est incroyablement précieux pour un biographe à la Michelet.
Il jette en particulier une belle lumière d’aurore sur les amours du prototype. Allons donc y voir de plus près.
L’avatar de l’auteur se nomme Samuel Cramer ; mais comme cela nous est indiqué dès l’incipit, il « signa autrefois du nom de Manuela de Monteverde quelques folies romantiques, »
Il se trouve d’une part que ce récit est signé « Charles Dufaÿs », d’autre part que les parents du personnage sont, citation : « un blême Allemand et (d’) une brune Chilienne », dont il est, nous est-il dit, « le produit contradictoire ».
Or, comme nous le savons, il arrivait à Baudelaire de signer ses publications
« Charles Baudelaire Dufaÿs », accompagnant donc son nom du nom de jeune fille de sa mère.
D’autre part, et à cet égard « produit contradictoire », rappelons qu’il était né de l’union d’une jeune fille de 27 ans et d’un homme mûr de 62 ans.
Le portrait qui suit correspond assez fidèlement au visage de l’auteur : « (…) le front pur et noble, les yeux brillants comme des gouttes de café, le nez taquin et railleur, les lèvres impudentes et sensuelles, le menton carré et despote, la chevelure prétentieusement raphaélesque. »
Quant au portrait moral, il relève carrément de l’autocritique : « (…) un grand fainéant, un ambitieux triste, et un illustre malheureux (…) ». C’est ce qui en fait, comme il est dit plus loin, « (…) l’homme des belles œuvres ratées (…) »
Et c’est, là aussi, éprouvé. Nous avons pu le vérifier dans les brochures consacrées aux salons. Quand une oeuvre suscite son enthousiasme, quand elle ensemence son esprit d’une grande idée, alors il s’élève comme Bellérophon 51 sur Pégase dans le ciel platonicien et laisse en plan la suite de la visite.
Baudelaire est profondément indocile, incapable de se contraindre à ce à quoi il n’a pas choisi d’oeuvrer.
Au passage, il mentionne ce qui fait l’essence de son dandysme, définissant son prototype comme une, citation : « créature maladive et fantastique, dont la poésie brille bien plus dans sa personne que dans ses œuvres »
Nous avions déjà vu comment la première rencontre qu’en firent Théodore de Banville et Nadar avait pris les allures d’une véritable apparition.
Nous y reviendrons.
Cette mention donnée au passage nous permet donc d’approcher ce que fut pour Baudelaire le dandysme. La beauté est l’une des trois valeurs suprêmes qui attestent de l’existence de Dieu.
Dans la lignée de Platon, via Plotin 52 et Swedenborg, Charles Baudelaire révère donc le Bien, le Beau et le Bon.
En attendant d’accomplir son oeuvre poétique, il reste cette opportunité de faire de soi-même une oeuvre, au physique et au mental, ce qui est aussi un moyen de la soustraire aux logiques mercantiles.
Tel est donc le dandysme : la recherche absolue du beau en soi-même.
« Absolue » parce qu’il ne s’agit pas de se conformer aux critères sociaux mais d’incarner en somme une transcendance.
Indiquons quand même au passage que, de façon beaucoup plus prosaïque, cette superbe allure et ce beau parler, c’est aussi ce qui lui permettra de s’inviter chez ses relations les plus fortunées à l’heure du déjeuner. Comme il ne fait pas mine de partir et qu’il navigue toujours dans le firmament de ses brillantes idées, on est bien obligé, à la fin, de lui trouver une place à table.
________________ 51 Héros antique auquel Athéna livra le moyen d’apprivoiser le cheval ailé, grâce auquel il put vaincre la chimère. 52 Platonicien gnostique du III° siècle, il eut une influence notable sur Saint Augustin.
Revenons à « La Fanfarlo ».
Notre romancier en herbe s’embarque ensuite avec enthousiasme – comme il sait si bien le faire – dans une apothéose – en l’espèce celle de son auto-portrait – avant d’en venir à l’effet principal de ses lectures.
La fièvre du récit a fait surgir plus haut – sous la forme initiale d’un « m apostrophe » – un narrateur dont nous ne savons rien. Et puis reprise en main de l’auteur qui joue ensuite avec la typographie de la ponctuation, confiant que, citation :
« après une lecture passionnée d’un beau livre, sa conclusion involontaire était : voilà qui est assez beau pour être de moi ! — et de là à penser : c’est donc de moi, — il n’y a que l’espace d’un tiret. »
Étonnant caractère, en effet, que celui de cet auteur qui est à la fois capable des enthousiasmes les plus enfiévrés et des ironies les plus mordantes.
Paresse, aussi, de se relire puisque le narrateur incertain, après avoir évoqué le fourmillement des dandies, déclare qu’ils ont tous lu, citation « les pages mystiques de Plotin ».
Qu’il y ait, dans la jeunesse d’alors, des effets de mode en matière de lecture, c’est certain. Mais ceux qui, entre la révolution de 1830 et celle de 1848, lisent Plotin, ne sont sans doute pas plus nombreux que ceux qui lisent Swedenborg ; ils se comptent sur les doigts d’une seule main.
Du reste la lecture du mystique suédois sera réservée plus loin au seul Samuel Cramer. On aura compris que ce personnage est indiscutablement l’avatar de Baudelaire.
« La suite est assez délectable » comme le chantera plus tard Brassens.
Samuel aperçoit dans une allée du Luxembourg – où l’on sait déjà que Baudelaire se promenait – un amour de jeunesse, une jeune fille qu’il avait connue à Lyon, désormais femme épanouie mais qui paraît cependant malheureuse.
A Lyon, Charles demeura entre sa 13° et sa 15° année, période des premières amours en effet.
Mais revenons aux avatars. Samuel ose aborder la dame ; la conversation s’engage, d’abord sur le livre qu’elle est en train de lire et qui semble passablement l’ennuyer.
L’avatar est alors délégué par l’auteur pour débiner Walter Scott.
Ici, un aveu : l’un comme l’autre relèvent de la catégorie des « absorbants », c’est-à-dire de ceux qui ont continuellement quelque chose à dire et avec lesquels, quand on a la malchance d’engager la conversation, on ne peut plus en placer une.
Ce fut effectivement le cas de Baudelaire, invariablement, depuis la rencontre évoquée plus haut jusqu’au séjour en Belgique.
Autre surprise : Samuel jouit déjà d’une certaine renommée puisque la dame lui demande de parler de sa poésie. Comme enfin elle décide qu’il est plus que temps de rentrer au foyer, il apprend qu’elle est mariée à un M. de Cosmelly.
Le jour suivant il lui offre son recueil de poèmes, « Les orfraies 53 » ; cette fois Baudelaire vire à l’autodérision. Reste qu’il a pu tenir aussi ses poèmes pour des cris – soit d’appel à l’aide, soit de désespoir – du moins pour certains.
La dame est farouchement critique à l’endroit de ces poèmes et Samuel concède qu’il y a en effet, dans cette poésie, matière à redire.
Citation : « Nous avons psychologisé comme les fous, qui augmentent leur folie en s’efforçant de la comprendre.»
Suit un tableau désolant des flétrissures de l’amour et des malheurs de l’existence.
Et comme Samuel continue sur sa lancée, Madame finit par éclater en sanglots.
Du coup il vire aussitôt à l’apologie des vertus chrétiennes, déclinant les cardinales – de vertus – avec le savoir faire d’un séminariste émérite, ce qu’était aussi Baudelaire, à sa façon.
_____________ 53 L’orfraie est, au sens premier, l’autre nom de l’aigle pygargue ou du balbuzard, deux oiseaux de proie. Par glissement phonétique le nom désigne aussi la chouette effraie, passant ainsi de l’oiseau prédateur à l’oiseau de mauvais augure. Pousser des cris d’orfraie, c’est pousser des cris perçants puis, métaphoriquement, protester violemment.
Alors la dame passe aux confidences.
En dépit de ses méritoires efforts pour être une épouse exemplaire, son mari s’ennuie. Il décide de venir s’installer à Paris ; et là, en à peine plus de temps qu’il n’en faut pour l’écrire, il la trompe avec une comédienne.
Son nom ? La Fanfarlo. Ses caractéristiques ? Aussi bête que belle.
Et Madame de Cosmelly a beau tout tenter pour reconquérir son époux, rien n’y fait. Elle détaille à Samuel tous les chapitres de son chagrin.
Là dessus l’auteur prototype, interrompant son récit, prend la peine de donner les précisions suivantes : « Quelques lecteurs scrupuleux et amoureux de la vérité vraisemblable trouveront sans doute beaucoup à redire à cette histoire, où pourtant je n’ai eu d’autre besogne à faire que de changer les noms et d’accentuer les détails. »
Mais nous n’en savons pas encore assez pour démasquer les prototypes des époux Cosmolly. Cependant comme le prototype de la Fanfarlo pourrait bien être Jeanne Duval, ce M. de Cosmolly pourrait bien être, à un détail près, Théodore de Banville.
Il suffirait justement d’accentuer ce détail : Théodore n’est pas encore marié mais il vit en couple avec cette femme venant de Lyon quand il tombe amoureux de Jeanne Duval.
Voici la suite : tablant sur l’amour que Samuel eut autrefois pour elle et aspirant à se venger de son époux, elle convainc ledit Samuel de séduire la maîtresse dudit époux laissant espérer au vengeur une douce rétribution..
Ne barguignant pas, il se rend aussitôt au théâtre ; la Fanfarlo est à son goût. Citation : « Il la trouva légère, magnifique, vigoureuse, pleine de goût dans ses accoutrements (…) »
Comment en faire la conquête ? En la débinant dans les journaux, ce qu’il entreprend sans retard, étant aussi critique. Après quoi, s’étant ainsi fait repérer, il va la voir un soir après le spectacle, dans sa loge.
Trait caractéristique « Les cheveux lourds et serrés retombaient en avant des deux côtés, lui chatouillaient le sein et lui bouchaient les yeux, de sorte qu’à chaque instant il fallait les déranger et les rejeter en arrière. »
La Fanfarlo est, sans doute possible, l’avatar de Jeanne Duval. Et quand Samuel débarque dans sa loge pour une première rencontre privée, il est donc délégué par la mystérieuse Mme de Cosmelly. afin de séduire la Fanfarlo, de la séparer de Monsieur, ce qui permettra à Madame de retrouver par là ses droits d’épouse.
Ou, s’il s’agit des prototypes, ses droits de maîtresse en titre.
Nous savions que Baudelaire avait fait la connaissance de Jeanne par l’intermédiaire de Théodore de Banville mais nous ignorions dans quelles circonstances.
Celles-ci ont le mérite d’expliquer le premier quatrain du sonnet intitulé « A Théodore de Banville », lequel laissait transparaître, sous la métaphore de la déesse de la poésie, la même Jeanne empoignée aux cheveux lors d’une violente dispute.
Celle-ci résultait sans doute de ce que Banville avait appris que Jeanne était devenue la maîtresse de Charles, sa maîtresse en titre, prototype de Mme de Cosmelly, ayant tout intérêt à le lui faire savoir pour le séparer de sa mulâtresse.
Suite de l’aventure : Samuel ne se lasse pas d’aller voir La Fanfarlo au spectacle. Quand son rôle la fait danser, il entre quasiment en extase.
De là deux digressions successives, la première sur l’art de la danse, la seconde sur la gastronomie. C’est là que nous retrouvons le narrateur : « Si Cléopâtre vivait encore, je tiens pour certain qu’elle eût voulu accommoder des filets de bœuf ou de chevreuil avec des parfums d’Arabie. »
Bref, Baudelaire commence à s’ennuyer avec ses personnages ; et puis, sans doute y a-t-il des choses qu’il ne peut pas dire. Quant à inventer effectivement la suite de leur destin, ça demande probablement trop d’énergie pour un travail alimentaire.
Il se tire d’affaire avec une troisième digression sur l’ameublement qui aboutit assez logiquement à une description de la chambre de la Fanfarlo.
Enfin l’actrice paraît nue ; vives protestations de Samuel qui la veut habillée et maquillée, comme le personnage qu’elle vient d’interpréter : Colombine, de la comedia del’Arte, toute de rouge vêtue. Elle y consent;
S’ensuit une relation quasiment conjugale jusqu’au jour où elle intercepte une lettre de Mme de Cosmelly destinée à Samuel, le remerciant de ses bons offices grâce auxquels celle-ci avait pu rétablir son ménage.
Vive dispute, naturellement ; on sait qu’elles étaient fréquentes entre Charles et sa « Vénus noire », comme Mme Aupick l’avait surnommée.
Certains voient dans la Fanfarlo un avatar de Marie d’Aubrun, autre amour de Baudelaire.
C’est sans doute plus compliqué. En effet c’est la même année, 1847, qu’il fait la rencontre de cette actrice, dont il tombe aussitôt amoureux, et qu’est publiée cette longue nouvelle.
Le plus probable est que le personnage romanesque est composé à partir de deux prototypes : Jeanne Duval et Marie d’Aubrun.
Ce qui est cocasse, du côté des prototypes, c’est que Marie d’Aubrun, quelques années plus tard, deviendra la maîtresse de Théodore de Banville.
Comme si la Fanfarlo, revenant à l’attaque, avait finalement supplanté l’épouse légitime.
Pour revenir aux personnages, cette lettre de remerciement funeste ne met cependant pas fin à la relation amoureuse entre Samuel et l’actrice ; mais, ce qu’éprouve désormais la Fanfarlo c’est, citation : « cet amour que connaissent peu d’âmes, avec une rancune au fond. ».
Quant à Samuel, son sentiment n’est pas de meilleure eau : « Il avait souvent singé la passion ; il fut contraint de la connaître ; mais ce ne fut point l’amour tranquille, calme et fort qu’inspirent les honnêtes filles, ce fut l’amour terrible, désolant et honteux, l’amour maladif des courtisanes. Samuel connut toutes les tortures de la jalousie, et l’abaissement et la tristesse où nous jette la conscience d’un mal incurable et constitutionnel. »
Et ici, sans doute possible, on est revenu de la relation des avatars au lien quasiment conjugal qui unissait Charles Baudelaire et Jeanne Duval.
Il n’ira cependant pas plus loin dans la transposition ; la Fanfarlo, enceinte, accouchera de jumeaux.
Baudelaire a-t-il été embauché par la maîtresse en titre de Théodore de Banville pour séduire la maîtresse en second ? Nous n’en savons rien. Mais les relations entre ces poètes sont tellement conflictuelles et à rebonds qu’on ne peut pas l’exclure.
Charles a fauché la maîtresse de Théodore ?
Très bien. Théodore fauchera la maîtresse de Charles ; enfin, la nouvelle maîtresse.
Charles raconte, par double métaphore, une scène de ménage entre Jeanne et Théodore ? Parfait. Théodore, recensant dans ses « Odelettes » ses contemporains dignes d’éloges, laissera Charles Baudelaire de côté.
Ceci dit, ils n’en resteront pas là, et heureusement.
Une bourde de leur éditeur commun, dans leur jeunesse, avait adressé à l’un les épreuves à corriger de l’autre et réciproquement. Ils ont pu alors examiner au plus près l’évidente parenté de leur poésie respective.
Par la suite subsisteront, entre leurs versifications, de secrets harmoniques.
Une longue étude s’est évertuée à déterminer lequel avait plagié l’autre. Aucun des deux, évidemment. La différence essentielle entre Baudelaire et Banville n’est pas dans le mètre ; elle est à la fois dans le tempérament et dans la conception du monde.
Deux grandes compositions poétiques laissent à penser que Théodore de Banville est un athée paisible.
La première = Dans « La mort des dieux » on perçoit qu’il a pris la mesure de la « damnatio memoriae » que les empereurs chrétiens ordonnèrent contre les cultes antiques.
La seconde = « La mort du poète » est un poème paradoxal ; la jeune amante du poète mourant prie Dieu de pouvoir l’accompagner au Ciel et Dieu exauce sa prière, les faisant mourir tous les deux. Mais dans les derniers vers il nous est dit que des amants, il ne reste rien.
A l’inverse Baudelaire est un croyant déchiré. Il est avide du moindre signe divin susceptible de le guider dans la vie mais il est sans cesse assailli par le sentiment du mal.
Dernier point sur « La Fanfarlo » : le récit se conclut avec une grande maestria, intégrant encore quelques éléments biographiques de l’auteur à une fantaisie exposée avec concision : « La Fanfarlo veut que son amant soit de l’Institut, et elle intrigue au ministère pour qu’il ait la croix. Pauvre chantre des Orfraies ! Pauvre Manuela de Monteverde ! – Il est tombé bien bas. – J’ai appris récemment qu’il fondait un journal socialiste et voulait se mettre à la politique. »
Il n’est pas impossible que Jeanne ait, dès cette époque, avec grande ingénuité, tenté de convaincre son amant d’être candidat à l’Académie française.
Quant au journal socialiste, il faut croire que Baudelaire en avait eu l’idée dès 1846 puisqu’il se lancera effectivement dans cette aventure après la révolution de 1848, fondant avec deux amis, « Le salut public », très éphémère journal, dont ne seront édités que deux numéros, qu’il vendra lui-même dans la rue, vêtu d’une blouse blanche.
Baudelaire obtient que la nouvelle soit publiée dans une revue populaire ; mais il en demande 200 frs, ce qu’il n’obtiendra pas. Le succès n’est pas au rendez-vous non plus.
Le romanesque alimentaire n’ayant rien donné, il revient sans regret au poétique ; mais ça ne nourrit pas non plus son homme.
D Baudelaire, l’homme justement
Avant d’aborder le coeur de l’oeuvre, revenons brièvement à l’auteur.
I Le croyant
Premier axe de sa personnalité généralement oublié : il est croyant.
Même en ses derniers jours où, devenu aphasique, il ne peut plus prononcer que deux syllabes, ce qu’il répète c’est « Crénom ! » Autrement dit « Sacré nom de Dieu ! ». Juron ou blasphème ? Rien n’est moins sûr, en dépit du contresens quasi universel sur la question.
Le témoignage de l’ami Nadar à ce propos montre que c’est le seul mot prononçable qui lui reste, mot du lexique intime qui sert alors simplement à désigner Dieu.
Une seule exception, comme nous le verrons, mais dont tout laisse à penser qu’elle fut l’ultime forme de supplique adressée au Créateur afin qu’il le délivre de ce corps ravagé par la maladie.
Silence de Dieu qui fait écho, des années après le procès, à l’incompréhension des juges. Si l’on est véritablement croyant, autrement qu’à la manière de Pinard, il faut postuler que le mal est, lui aussi, le fait de la puissance divine, que Dieu l’ait voulu ou simplement autorisé.
Et ce qui ouvre à notre poète cette voie paradoxale, c’est que du mal émerge la beauté. Sans doute pour jouir de cette floraison, il faut faire oeuvre, comme un bon jardinier.
Mais quand Baudelaire façonne la dernière strophe de l’un de ses poèmes les plus frappants – « Une charogne » – nul doute qu’il n’éprouve cette certitude de l’existence de ce pouvoir de transfigurer les aspects les plus sombres du réel qu’il a reçu de Dieu en tant que poète.
Alors, ô ma beauté ! dites à la vermine Qui vous mangera de baisers,
Que j’ai gardé la forme et l’essence divine De mes amours décomposés !
L’art du poète c’est aussi ce moyen de saisir l’essence intemporelle de chaque être destiné à la mort et de lui offrir par là une forme de survie.
II Le sensible
Il se trouve que, derrière l’élégant beau-parleur, le trait le plus remarquable du caractère de Baudelaire, c’est la sensibilité et, plus précisément, la sensibilité aux malheurs d’autrui.
Rien à voir avec la « charité chrétienne », charité forcée des bons catholiques qui s’achètent à peu de frais la mansuétude divine (cf.« La fausse monnaie »). C’est la pente naturelle de son coeur qui le porte à explorer, à éprouver et à partager les sentiments les plus intimes et les plus discrets.
Mais pour fixer cette quête dans l’écriture, il lui faut trouver le moyen adéquat.
1) L’art de dire
Poèmes, en vers ou en prose, journal intime, lettres et souvenirs, articles, brochures… Baudelaire a pratiqué toutes les formes d’écriture. Mais de façon très méthodique il voue les deux formes de son dire poétique à des taches bien définie.
=> Pour la prosodie 54 classique, sa forme la plus haute est le sonnet.
Dans un fragment de lettre posthume, publié en 1884 – peut-être un brouillon ou bien un courrier qu’il a renoncé à envoyer – ces quelques phrases pénétrantes :
« (…) parce que la forme est contraignante, l’idée jaillit plus intense. Tout va bien au sonnet. : la bouffonnerie, la galanterie, la passion, la rêverie, la méditation philosophique. Il y a là la beauté du métal et du minéral bien travaillés.
Avez-vous observé qu’un morceau de ciel, aperçu par un soupirail ou entre deux cheminées, deux rochers, ou par une arcade, donnait une idée plus profonde de l’infini que le grand panorama vu du haut d’une montagne ? »
De là suit ce jugement sans appel concernant les longs poèmes :
« c’est la ressource de ceux qui sont incapables d’en faire de courts.»
On se dit donc : voilà ce qui disqualifie « le père Hugo ». Il est cité dans cette ultime liasse de feuillets mais sans plus. C’est sans doute l’intransigeance de l’auteur d’Hernani qui le préserve des invectives de Baudelaire.
Par contre il éprouve une véritable détestation pour Alfred de Musset.
______________ 54 Ensemble des règles de versification.
Citation : « je n’ai jamais pu souffrir ce maître des gandins 55, son impudence d’enfant gâté qui invoque le ciel et l’enfer pour des aventures de table d’hôte, son torrent bourbeux de fautes de grammaire et de prosodie, enfin son impuissance totale à comprendre le travail par lequel une rêverie devient un objet d’art. »
Pourquoi cette intransigeance ? Parce que la forme ramassée et contraignante du sonnet est vouée à s’emparer de l’essence des choses et des êtres.
En user simplement pour paraître et n’être alors pas même capable de s’en tenir aux règles, c’est simplement indigne.
________________ 55 Jeune homme très élégant, raffiné et assez ridicule.
=> Pour les poèmes en prose, il les consacre à partager avec ses lecteurs les expériences essentielles de son existence.
Brève indication donnée à cet égard dans la préface au « Spleen de Paris » (publication posthume) : « Quel est celui de nous qui n’a pas, dans ses jours d’ambition, rêvé le miracle d’une prose poétique, musicale sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s’adapter aux mouvements lyriques de l’âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience ? »
Ceci dit, là non plus il ne fait pas étalage de ses bons sentiments. Mais cette empathie spontanée à l’égard de ses semblables affleure dans nombre de ces textes. Et comme il est par ailleurs d’une scrupuleuse honnêteté, qu’il ne dissimule jamais ce que ses pensées pourraient avoir d’antipathique, on incline à croire en la sincérité de ce sentiment de sollicitude.
2) Trois poèmes en prose
a) La belle Dorothée
Le plus ancien de ces témoignages, quant à l’événement qu’il rapporte, c’est « La belle Dorothée ». Souvenir lointain de son périple dans les mers du Sud dans lequel on lit en filigrane à la fois son admiration pour l’amour quasiment maternel que Dorothée voue à sa petite soeur, et son parti pris de se mettre au service d’un si noble engagement.
Seulement comme Baudelaire s’interdit toute parade factice, il faut lire entre les lignes. « Parade factice » par opposition à « parade expressive », dans la mesure où le dandysme, comme nous l’avions vu, consiste à donner corps à la beauté en faisant de soi-même une oeuvre.
Tout le mouvement de ce poème en prose consiste en une révélation – dans le sens primordial – soit une levée de voile. Quel est donc ce voile ? C’est celui dont la belle apparence enveloppe d’abord cette jeune femme.
Mais Dorothée a beau être aussi belle qu’une statue – torse mince, hanches larges, taille longue, gorge pointue – sa beauté véritable est morale. Et elle l’est d’autant plus que, s’avançant solitaire sous ce soleil accablant, elle ménage ses forces et ne laisse rien paraître de sa peine.
Cet effet de translation du corps à l’âme est doublé par ce qu’on pourrait nommer une dialectique des couleurs. Dorothée est d’abord, dans ce paysage saturé de lumière, une tache noire, paradoxalement « éclatante ».
Mais progressivement, par une sorte de diffraction inversée, elle chatoie de toutes les couleurs : robe rose clair, reflet rouge de l’ombrelle, chevelure presque bleue.
Ce glissement de ce qui se donne à voir est doublé de ce que cette apparition laisse entrevoir : Dorothée, désormais affranchie, a pourtant les pieds nue alors qu’elle aurait désormais le droit de porter des chaussures.
Un premier regard, arrêté à ce qu’on pourrait tenir pour sa coquetterie, imagine qu’il y a là l’orgueil de montrer la beauté de sa jambe et de son pied.
Et puis – et ici il faut revenir à l’expérience passée de Baudelaire – celui qui regardait d’abord sans pénétrer le sens et la portée du but de la belle promeneuse, interroge, réfléchit et, finalement, comprend.
Dorothée ne porte pas de chaussures parce que, bien qu’affranchie, elle a décidé de racheter sa petite soeur afin de la sortir, elle aussi, de l’esclavage.
Pour le reste, c’est au lecteur de conjecturer :
=> les souliers seraient une dépense malvenue quand il faut économiser chaque piastre.
=> Dorothée pourrait bien monnayer son travail à son ancien propriétaire. Alors, pour des raisons de commodité, il est préférable de continuer à paraître son esclave.
Celui qui comprend cela connaît bien la jeune femme, au point de pouvoir décrire non seulement le confort de sa petite case mais encore la façon précise dont Dorothée y jouit de sa modeste existence.
Pas de doute à mon sens : le jeune Charles, dans ce qui lui restait de l’argent alloué par Aupick pour son voyage, a prélevé ce qu’il fallait pour racheter la petite soeur de Dorothée afin qu’elle puisse, elle aussi, être affranchie.
Les derniers mots du poème, sur l’avarice du maître de la petite fille, suggèrent qu’il a fallu au jeune Baudelaire âprement négocier pour obtenir cet affranchissement.
Enfin il se pourrait bien que cette probable largesse soit le motif qu’il ait eu d’écourter son voyage. Au moins il a pu voir Dorothée heureuse avec cette petite soeur.
Dans ce deuxième poème en prose le lecteur attentif sait qu’on est d’emblée dans le véridique. Ceci dit, le risque est grand, lors de cette lecture, de faire un contresens. Nous désignerons Baudelaire comme « le narrateur ».
La trame narrative est simple : ce narrateur a accompagné un ami au bureau de tabac. Celui-ci, examinant après coup sa monnaie, se rend compte qu’on lui a remis une fausse pièce d’argent et la place dans une poche à part.
Attention pourtant : ce n’est pas là qu’est la fausse monnaie.
Les deux hommes croisent un mendiant et lui font l’aumône ; l’ami lui donne la fausse pièce d’argent.
Au passage, deux traits intriqués de la psychologie du narrateur :
= d’une part il est sensible, ici au regard à la fois suppliant et hostile des mendiants, = d’autre part il ne peut s’empêcher de conjecturer sur les motifs qui font agir les humains.
Voilà pourquoi il commence promptement à réfléchir au sens possible du geste de son ami.
Celui-ci a pu vouloir créer un événement heureux dans la vie de ce mendiant. Nul doute ici que, si le narrateur avait agi de la même façon, c’est ce qui aurait motivé son geste.
Ça ne lui suffit pas, son « misérable cerveau », comme il le dit, étant, citation : « toujours occupé à chercher midi à quatorze heures ».
Le voilà donc qui examine silencieusement les conséquences possibles de ce don pour celui qui l’a reçu, de la meilleure à la pire :
= recevoir en échange, après un petit achat, un tas de vraies pièces
= se retrouver en prison pour fausse monnaie.
Mais l’ami le tire bientôt de sa méditation par une déclaration anodine qui le révulse. C’est que celui-ci croit véritablement avoir fait la charité.
Et ici, condamnation sans appel formulée par le narrateur :
« Je vis alors clairement qu’il avait voulu faire à la fois la charité et une bonne affaire ; gagner quarante sols et le cœur de Dieu ; emporter le paradis économiquement ; enfin attraper gratis un brevet d’homme charitable. »
Fausse monnaie, par conséquent, et bêtise abyssale : cet ami – dont on peut supposer qu’il a cessé à l’instant de l’être – prétend tromper Dieu en personne sur la nature de son geste.
Baudelaire n’est pas un bigot ; il aurait même pardonné à cet ami de jouer au trictrac avec la vie de cet homme en prenant le risque de l’envoyer en prison.
Mais présenter à Dieu la fausse monnaie de sa prétendue charité, ça dépasse tout ce que Baudelaire pouvait concevoir en matière d’abjection et de stupidité.
Voici la sentence : « (…) je ne lui pardonnerai jamais l’ineptie de son calcul. »
En résumé le Dieu de Baudelaire, c’ est celui de la Bible, celui qui sonde les reins et les coeurs 56. Il exclut toute pitrerie pieuse, toute espèce de salamalecs.
Voilà pourquoi notre poète – en prose comme en vers – se voue d’abord à la lucidité, qu’il s’agisse de la droiture qui consiste à reconnaître en soi tous les sentiments mauvais ou, plus rarement, la discrète floraison du bien.
C’est le cas du troisième poème.
_________________ 56 Jérémie 17:10 : « Moi, l’Éternel, j’éprouve le cœur, je sonde les reins, Pour rendre à chacun selon ses voies, Selon le fruit de ses œuvres. »
c) Une veuve
Celui-ci, intitulé « Les veuves« , commence par une sorte d’auto-portrait en négatif.
Baudelaire est, à n’en pas douter, un de ces « poètes philosophes » en quête, dans les jardins publics, des « éclopés de la vie ».
Mais le tableau qu’il esquisse des malheureux laisse transparaître sa propre expérience des revers de l’existence. C’est de cela que Baudelaire tient son « oeil expérimenté ».
Le noir vêtement du deuil fait aussitôt reconnaître les veuves. Par empathie spontanée notre poète ne manque jamais de les examiner à loisir, extrayant de leurs postures successives ce que fut leur chagrin et ce qui est leur ennui. Un jour il est captivé par l’une de ces femmes debout devant un de ces concerts publics auxquels on pouvait assister pour trois sous.
Regard, ainsi qu’il l’a exprimé plus haut, « universellement sympathique ».
C’est un alliage improbable qui constitue Baudelaire, à l’oeuvre en particulier dans les poèmes en prose :
=> d’une part une sympathie spontanée pour tout être sensible – y compris, comme le montre le recueil du Spleen de Paris, les femmes et les enfants, mais aussi les chiens et les chats comme l’indique la courte mention qui termine ce texte.
=> d’autre part une rare pénétration d’esprit qui le met en puissance de s’incarner, pendant quelques instants, dans l’autre, quel qu’il soit, et de le saisir de l’intérieur.
Et cette veuve-là – droite, noble, majestueuse – n’a manifestement rien à faire devant un concert quasi gratuit où s’est pressée la plèbe. Rappelons au passage, comme il l’a indiqué plus haut, qu’il est tout autant sensible aux souffrances, citation : « de la faim et du froid humblement, silencieusement supportés.»
Il faudra s’en souvenir quand il s’agira de décrypter ses positions politiques.
Et comme cet homme ne renonce jamais à comprendre ses semblables, il s’est approché de la veuve debout au milieu de la plèbe.
Découverte : elle tient « par la main un enfant comme elle vêtu de noir ».
Et cela suffit à notre poète philosophe pour l’imaginer, capable par amour maternel, de faire taire son deuil pour prendre souci du besoin de cet enfant, au point de sortir d’elle-même, pour lui offrir, avec ces flonflons, de quoi se distraire.
Donc, décidément, Baudelaire poète, philosophe et sensible aux autres. Terminons ce portrait par esquisses.
III Le compliqué
Nous l’avons vu plus haut mettre en oeuvre, exclusivement pour lui-même, un usage tempéré du « dawamesk », tout en condamnant irrévocablement son emploi récréatif et immodéré.
On retrouve une complexité analogue dans ses positions politiques, dans ses rapports aux autres, dans ses amours.
Comment se fait-il qu’il passe en quelques années d’une position révolutionnaire – rappelons qu’en 1848 il est sur les barricades – à une position réactionnaire et monarchiste ?
Pour le comprendre il faut esquisser préalablement une psychanalyse de Baudelaire. Quelques éléments :
La mort de son père survient alors que Charles a 6 ans et qu’il n’est pas encore entré dans ce que Freud définira comme « la période de latence » : fin de la sexualité infantile ; refoulement des désirs, en particulier ceux dont la mère est l’objet ; sublimation ; socialisation et apprentissages variés.
Autrement dit, à 6 ans, non seulement le petit Charles n’a pas encore opéré cette transmutation mais encore il est alors à l’acmé du complexe d’Oedipe.
En bref : vouloir la mère à soi seul et désirer par conséquent la mort du père.
Et comme ce père meurt précisément à ce moment clef du développement de l’enfant, on peut concevoir le poids d’une culpabilité colossale.
Elle sera là jusqu’à la fin, Baudelaire ne cessant au fond jamais de s’autoflageller.
C’est d’abord ce qui explique les bons rapports que l’enfant noue avec Jacques Aupick, son beau-père ; celui-ci le délivre en somme de cette écrasante culpabilité qui se nourrit aussi de posséder la mère à soi seul, pendant les dix-huit mois qui séparent le veuvage de Caroline Baudelaire de son remariage avec Jacques Aupick.
Charles va reporter sur Mariette cet attachement oedipien, le transmuant en tendresse licite pour une figure maternelle.
Dans les vers, pourtant, l’inconscient affleure toujours :
« La servante au grand coeur dont vous étiez jalouse »
« Jalouse » n’est pas une simple métaphore ; c’est aussi la notation, par la bande, d’une rivalité amoureuse, partiellement érotique.
Enfin une autre façon de se libérer de cette culpabilité liée à la mort du père, c’est de s’introjecter 57 les valeurs qui étaient les siennes.
Une lettre tardive de la mère de Baudelaire permet de discerner les contours de cette assimilation, d’autant plus que ce qu’elle y restitue paraît bien correspondre au langage qu’elle a tenu à son petit garçon, espérant, en faisant revivre ce père, le consoler de sa disparition.
Quelques passages éclairants des lettres de Caroline Aupick à Charles Asselineau : « M. Baudelaire était un homme très distingué, sous tous les rapports, avec des manières exquises, tout à fait aristocratiques. » Lettre de 1868, sans autre précision.
Donc si Charles, son fils cadet, devient un parfait dandy, ce n’est pas seulement pour s’appliquer une éthique du beau ; c’est aussi une façon de faire survivre le père et de se délester de la culpabilité lié au désir inconscient de sa mort.
________________ 57 Introjection : Processus mis en évidence par l’investigation analytique : le sujet fait passer, sur un mode fantasmatique, du « dehors » au « dedans », des objets et des qualités inhérentes à ces objets.
L’introjection est proche de l’incorporation qui constitue son prototype corporel mais elle n’implique pas nécessairement une référence à la limite corporelle (introjection dans le moi, dans l’idéal du moi, etc….). Elle est dans un rapport étroit avec l’identification. (d’après le dictionnaire de la psychanalyse de Laplanche et Pontalis).
Même chose pour le tropisme aristocratique qui se traduira, sur le tard, par un renversement des opinions politiques.
Dans une lettre de la mère de Charles à Alphonse, son demi-frère, datée du 24 mars de la même année, on trouve l’indication suivante :
« le nom de Dufays n’est pas celui de M. Baudelaire, mais le mien, que Charles a eu l’idée quelquefois de joindre au sien, en signant ses ouvrages ; il lui est arrivé aussi d’y joindre celui d’Archimbaut, qui est également le mien ; mon nom de baptême est Caroline Archimbaut-Dufays. »
Choisir comme complément de son nom le nom de jeune fille de sa mère, c’est se situer mentalement en amont de l’union de ses parents, donc, aussi, de sa propre naissance.
Double action inconsciente, par conséquent :
= séparer symboliquement ses parents
= se soulager temporairement des déterminations de l’existence, voire de la charge de vivre.
Dans la même lettre :
« Quand la Révolution a éclaté, M. Baudelaire a déployé bien beau caractère ; il a été héroïque. Cela m’a été confirmé par de vieux amis à lui, ses contemporains. Il a risqué vingt fois sa vie pour le duc et la duchesse qui, dans ces malheureux temps de proscription, ont dû se sauver en laissant leurs enfants à M. Baudelaire. »
Il faut donc, en digne fils de ce père,
=> être un héros, ce que Charles fera en montant sur les barricades quelques révolutions plus tard
=> être en amitié d’une absolue fidélité, ce à quoi il ne semble pas qu’il ait jamais manqué.
Cette dualité du père, à la fois audacieuse et admirable, se retrouve encore dans les lignes suivantes :
« M. Baudelaire ayant retrouvé quelques amis de collège dans le parti révolutionnaire, et qui y étaient influents, de ces vieilles amitiés qui survivent au temps, aux événements, aux opinions, il s’est servi d’eux dans l’intérêt de ses amis, tout en leur disant de dures vérités sur la voie où ils étaient entrés, sur leurs excès, sur le but vers lequel ils marchaient, et tout cela avec une éloquence qui les subjuguait. Ils admiraient sans doute ce courage et cette audace qui semblaient courir au-devant de la mort qu’il méprisait pour lui-même, pourvu qu’il pût sauver ses amis. »
On conviendra qu’il y là, pour ce fils orphelin de père, de quoi construire un « idéal du moi » de première bourre.
Après une suite de cette apologie du père – dont on peut déduire à quel point elle a pesé sur la construction de la personnalité du jeune Charles, deux indications :
= Comme secrétaire à la Chambre des Pairs, Joseph Baudelaire , citation : « était Conservateur du Palais et des jardins, Vérificateur, Contrôleur, ayant une grande comptabilité à tenir. C’était lui qui commandait à des artistes de choix les tableaux et statues pour l’ornement du Palais. »
Il s’agit du Palais du Luxembourg.
Nul doute que Charles ne se soit dit que si son père avait vécu quelques années de plus, c’est aussi Delacroix qu’il aurait choisi pour la peinture du plafond de la bibliothèque.
Evidemment l’intérêt précoce que Charles manifeste pour la peinture – quand il rédige le premier salon, en 1846, il a 25 ans et il maîtrise déjà toutes les arcanes du métier – trouve ici sa source.
Enfin, toujours dans la même lettre, cette indication capitale : « Si le père Baudelaire avait vu grandir son fils, il ne se serait certes pas opposé à sa vocation d’homme de lettres, lui qui était passionné pour la littérature et qui avait le goût si pur ! »
Tout est dit. Surmonter cette culpabilité liée au désir de voir mourir le père n’est possible qu’en le faisant survivre, qu’en « introjectant » ce père trop tôt disparu.
Et ce fils étant mort lui aussi, cette mère livre au grand jour ses sentiments sur ce passage du flambeau littéraire du père au fils, écrivant, à propos de son premier époux : « Il aurait été bien fier de le voir entrer dans cette carrière, malgré tous les déboires, toutes les tortures qui y sont attachés. »
On a vu précédemment à quel point Joseph Baudelaire se souciait peu de la sécurité de sa personne quand des intérêts supérieurs étaient en cause.
C’est aussi ce modèle qui servira de viatique à son fils Charles dans les moments difficiles : « A quelques rares défaillances près, je l’ai toujours trouvé fort ; je ne l’ai jamais vu se laisser abattre au milieu de ses plus grands malheurs, car votre ami a été bien malheureux, plus malheureux que vous ne pouvez croire ! »
Revenons à la position politique de notre poète.
Elle est forcément complexe, comme était celle de son père.
Baudelaire est à la fois, comme nous l’avons vu, sensible aux misères et aux détresses du petit peuple – il faut donc y mettre fin – et intimement persuadé de la nécessité de maintenir une aristocratie, mais qui doit être avant tout celle du mérite ; comme en peinture, en somme. Du reste, en grec l’adjectif « ἀριστoς» signifie « le meilleur ».
En 1848, alors qu’il s’est mis à la traduction d’Edgar Poe, une nouvelle révolution émerge en février des rues de Paris. Révolution sociale contre la paupérisation résultant de la libéralisation de l’économie mise en place par Louis-Philippe. Il faut moins d’une semaine pour persuader le roi d’abandonner son trône et c’est bientôt la deuxième République.
Suffisant pour que le 24 Charles abandonne son bureau, sa plume et coure aux barricades. On n’en retient généralement que son singulier mot d’ordre : « A mort le général Aupick ! ». Le beau-père venait d’être nommé à la direction de Polytechnique.
Mais ce qui montre qu’il est perçu comme une exception par le petit peuple de Paris, c’est la gravure que croqua de l’événement Gustave Courbet et qui figurera bientôt en tête du n°2 du « Salut public ».

On l’y voit dressé sur l’amoncellement, tenant un drapeau et un fusil, portant à la fois blouse et chapeau haut de forme.
Et sur le drapeau on pouvait lire deux inscriptions : « Voix de Dieu » et « Voix du peuple » dont on devra convenir qu’elles ne pouvaient être que de lui.
« Le Salut public », c’est le titre du journal que Baudelaire fonde dans la foulée avec deux comparses écrivains, Champfleury et Toubin.
Quatre petites feuilles où se succèdent de courts articles d’une dizaine de lignes et dans lesquelles il s’agit toujours d’inciter le peuple à reprendre son destin en main en poursuivant son effort révolutionnaire.
Il n’y aura que deux numéros, soit qu’il n’y ait plus eu de fonds afin de poursuivre l’aventure journalistique, soit que la suite des événements (élection biaisée des députés de la Constituante, fermeture des ateliers nationaux, répression sanglante de l’insurrection de juin.) ait mis fin aux illusions des rédacteurs.
Ici ou là, dans ces deux numéros, on reconnaît la plume de Baudelaire, et ceci dès le premier article : « On disait au Peuple : défie-toi.
Aujourd’hui il faut dire au Peuple : aie confiance dans le gouvernement.
Peuple ! Tu es là, toujours présent, et ton gouvernement ne peut pas commettre de faute. Surveille-le, mais enveloppe-le de ton amour. Ton gouvernement est ton fils.
On dit au Peuple : gare les conspirateurs, les modérés, les rétrogrades ! Sans doute il faut veiller, les temps sont chargés de nuages, quoique l’aurore ait été resplendissante. Mais que le Peuple sache bien ceci, que le meilleur remède aux conspirations de tout genre est LA FOI ABSOLUE dans la République, et que toute intention hostile est inévitablement étouffée dans une atmosphère d’amour universel. »
On le reconnaît à trois traits en particulier : la force de la conviction, la véhémence du propos, la solidité de la trame de l’énoncé. Dans le même numéro, les premières phrases d’un article intitulé : « Le 24 février. » :
« Le 24 février est le plus grand jour de l’humanité ! C’est du 24 février que les générations futures dateront l’avènement définitif, irrévocable, du droit de la souveraineté populaire. Après trois mille ans d’esclavage, le droit vient enfin de faire son entrée dans le monde, et la rage des tyrans ne prévaudra pas contre lui. Peuple français, sois fier de toi-même ; tu es le rédempteur de l’humanité. »
Accessoirement Baudelaire est probablement le seul des trois rédacteurs qui sait ce qu’esclavage veut dire.
On reconnaît encore son style et sa pensée dans l’appel au ralliement des prêtres du n°2.
C’est lui aussi, avec la concision extrême dont il est capable, qui rédige un entrefilet sur les peintres républicains et un autre sur la réouverture des théâtres.
Qu’est-ce qui fera, par la suite, basculer Baudelaire sur le plan politique ?
Un article du second numéro intitulé « La curée » – où l’on reconnaît à nouveau son style – le laisse présager :
« Indignation ! Nous venons des ministères, de l’Hôtel-de-Ville et de la préfecture de police : les corridors sont remplis de mendiants de place. On les reconnaît à la bassesse de leurs figures empreintes de servilisme.
Non, ce ne sont pas là des Républicains ; un Républicain s’attache à mériter les emplois et ne s’inquiète pas de les obtenir. Les pavés de nos rues sont encore rouge du sang de nos pères morts pour la liberté ; laissons, laissons au moins à leurs ombres généreuses un instant d’illusion sur nos vertus. Encore si ces insatiables dévoreurs de la République avaient combattu avec nous pour son triomphe ; mais celui qui gravit si lestement l’escalier d’un ministre, celui-là, soyez-en sûrs, n’était pas aux barricades. »
Bref, quoi que l’on fasse dans l’ordre politique pour améliorer le sort des humbles, ce sont toujours les plus habiles et les plus égoïstes qui raflent la mise.
Deux petites précisions pour terminer ce développement :
=> C’est une erreur d’attribuer à Baudelaire, comme le fait l’édition de 1908 des Oeuvres complètes, tous les articles du Salut public. Il y avait deux autres rédacteurs dont, du reste, on reconnaît également les styles respectifs.
=> Il faut en finir avec la légende de Baudelaire grimpant sur la barricade uniquement pour déplaire à son beau-père. Il a été authentiquement républicain et il s’est battu pour cette deuxième république aussi longtemps qu’il y a cru.
Et puis, tout compte fait, autant retourner à son écritoire composer des poèmes, du moins lorsqu’on le peut.
E Le maître-livre de notre poésie
Nous devons ce beau qualificatif à Yves Bonnefoy dans la préface qu’il rédige pour « Les Fleurs du mal », édition 1955 du Club du meilleur livre.
Ses mots exacts : « Voici le maître-livre de notre poésie : Les Fleurs du mal. Jamais la vérité de parole, forme supérieure du vrai, n’a mieux montré son visage. »
En quelques mots, celui que l’on peut tenir pour le plus grand poète français du XX° siècle 58 va, comme de coutume, à l’essentiel :
=> « parole » et non pas phrase ou vers.
=> le « vrai » comme fondement du beau qui est émergence. C’est en cela, et en cela seulement, qu’il y a « fleurs » du mal.
=> le « visage » parce que le dire poétique n’a pas vocation à désigner ou à évoquer mais à faire surgir « la présence réelle »
=> « maître-livre » parce que c’est en se plaçant en apprentis de cette alchimie poétique de Baudelaire que Stéphane Mallarmé d’abord et Yves Bonnefoy ensuite sont devenus des maîtres en poésie.
________________ 58 Je me souviens encore avec émotion de cette salle bondée du Haut Conseil de l’Institut du Monde arabe où Yves Bonnefoy donna son ultime conférence. Salle tellement pleine de
« bonnefidèles » qu’il avait fallu ajouter des chaises pliantes et que Jack Lang lui-même n’avait trouvé place que sur l’une d’entre elles. Aucun des assistants n’aurait jamais pu imaginer qu’il partageait avec tant d’autres ce plaisir délicat d’une poésie toutes en nuances, suffisamment puissante toutefois pour faire émerger peu à peu comme une troisième dimension du dire poétique.
Enfin, pour finir, rappelons l’enthousiasme du jeune Rimbaud. Pour autant on n’entre pas dans ce temple de la poésie sans passer par le vestibule.
I Une grande variété d’écrits
Ce serait une erreur de croire que Baudelaire a composé ce bouquet d’un seul jet, sous l’effet d’une brûlante inspiration. En fait entre le moment où « La Fanfarlo » est éditée (1847) et celui qui voit paraître « Les fleurs du mal », dix ans vont passer. Il faut imaginer que pendant ces 10 années Charles Baudelaire, tout à la fois, consacre son temps à des publications alimentaires mais n’hésite jamais à s’interrompre dès que survient l’inspiration.
Inspiration parcellaire toujours, allant de quelques vers à l’idée d’un poème ou celle d’une réécriture d’une pièce existante. La preuve, c’est qu’il subsiste des épreuves d’imprimerie de poèmes corrigés par Baudelaire.
Et puis, concurremment, de ces feuillets disparates des premières versions, émerge progressivement une structure générale qu’il faudra peu à peu renforcer et achever.
Voyons préalablement les publications qui servent de terreau à l’ écriture poétique.
1) Edgar Poe, frère d’âme et d’esprit
« Révélation magnétique » , c’est la traduction d’une nouvelle d’Edgar Poe
– « Mesmeric revelation » – dont on rendrait plus exactement le titre par « révélation hypnotique » – traduction que Baudelaire entreprend après avoir publié son roman.
Ce qui importe ici, c’est l’influence décisive qu’Edgar Poe va exercer d’abord sur Charles Baudelaire, ensuite sur une grande partie des lettres françaises au XIX° siècle, à commencer par Mallarmé. On se souvient peut-être de la traduction que celui-ci fit du poème « The crow », « le corbeau », restituant merveilleusement toute l’inquiétante étrangeté de cette composition. Il est vrai qu’Étienne Mallarmé avait commencé par être professeur d’anglais ; de là aussi, peut-être, l’anglicisation de son prénom.
Si l’on voulait caractériser globalement cette influence, on pourrait dire qu’elle bouscule la rationalité cartésienne, grandement renforcée par le siècle précédent, et qui règne encore sur les lettres françaises avant 1850.
Edgar Poe, c’est une place laissé à l’étrange, à l’inquiétant, au surnaturel. Et l’on comprend pourquoi Baudelaire – qui commence à le traduire aussitôt après avoir achevé « La Fanfarlo » – y trouve de quoi renforcer ses convictions « swedenborgiennes ».
Mais il y a plus : ce qu’on pourrait nommer une fraternité des esprits.
Quelques années plus tard, après avoir rédigé sur l’écrivain américain plusieurs notices biographiques, il écrit à Armand Fraisse : « (…) en 1846 ou 47, j’eus connaissance de quelques fragments d’Edgar Poe ; j’éprouvai une commotion singulière ; ses œuvres complètes n’ayant été rassemblées qu’après sa mort en une édition unique, j’eus la patience de me lier avec des Américains vivant à Paris pour leur emprunter des collections de journaux qui avaient été dirigés par Poe. Et alors je trouvai, croyez-moi, si vous voulez, des poèmes et des nouvelles dont j’avais eu la pensée, mais vague et confuse, mal ordonnée, et que Poe avait su combiner et mener à la perfection. Telle fut l’origine de mon enthousiasme et de ma longue patience.» Ce qui se donne à lire derrière ces lignes, c’est l’enthousiasme immédiat qu’éveille les premiers textes, la « longue patience » étant celle du traducteur.
Généralement, hormis un encouragement à la liberté créatrice, on ne discerne pas l’influence réelle que Poe exerça sur Baudelaire.
Exception : le projet tardif de « Mon coeur mis à nu » dont il ne nous reste que le « work in progress » 60.
Baudelaire y mentionne, parmi les tâches requises, « Histoire de ma traduction d’Edgar Poe. » mais on n’en verra pas la couleur.
C’est dans la lecture des Marginalia d’Edgar Poe 61 que l’on trouve l’élément déclencheur de cette 3° époque du journal de Baudelaire ; citation :
« S’il venait l’idée à un homme ambitieux de révolutionner d’un seul coup l’univers de la pensée, de l’opinion et du sentiment humains, il n’a qu’une opportunité à saisir, et la voie de la renommée éternelle s’étend alors devant lui, droite et claire. Il lui suffit d’écrire et de publier un très petit ouvrage ; son titre tiendrait en quelques mots ordinaires : “ Mon Cœur mis à nu ”. Mais cet opuscule devrait être fidèle à son titre. » Plus loin : « (…) Nul n’ose l’écrire. Nul n’osera jamais. »
Charles Baudelaire l’osera mais les circonstances feront qu’il ne pourra mener ce projet à bien. Ceci dit, il relève le défi.
Lignes décisives que celles de ce court recueil totalement véridique : c’est dans ces brèves notations que l’on découvre un Baudelaire à la fois « sacrilège » dans ses assertions théologiques – par exemple « la création ne serait-elle pas la chute de Dieu ? » – et pourtant plein de piété, par exemple dans ce passage intitulé « Prière » :
« Ne me châtiez pas dans ma mère et ne châtiez pas ma mère à cause de moi. – Je vous recommande les âmes de mon père et de Mariette.
– Donnez-moi la force de faire immédiatement mon devoir tous les jours et de devenir ainsi un héros et un Saint » .
L’impact de la lecture d’Edgar Poe ne s’arrête pas là.
Baudelaire a pu retrouver dans les traductions de Kierkegaard en anglais une recension des implications métaphysiques de la théorie de Swedenborg mais c’est plus probablement par l’intermédiaire de ses traductions d’Edgar Poe qu’il a transmué cette lecture en une véritable vision du monde.
Au fond, dans celle-ci, ce ne sont pas seulement les êtres humains, leurs discours et leurs oeuvres qui sont porteurs de sens. Tout le reste, le soleil, les nuages, les fleurs, l’apparition fortuite ou familière de l’oiseau… fait signe.
_______________ 60 Le français ne donne que des approximations – travail en cours ou chantier – qui ne restituent pas la dimension de relecture et de correction, de notation et de développement, que comporte généralement le travail d’écriture qui est une tension vers la forme optimale. 61 Marginalium, marginalia : notes manuscrites en marge d’un texte. Ce sont, pour l’essentiel, des réflexions inspirées par ses diverses activités dans le journalisme, de pigiste à rédacteur en chef et inversement.
Dieu a tout créé et, par conséquent, Dieu est en toute chose. S’il veut, en telle occasion ou telle autre, se manifester aux êtres humains, c’est par le truchement de la beauté qu’il éveille leur esprit.
Ce credo de Charles Baudelaire, c’est l’indispensable substrat à l’intelligence du fameux poème « Correspondances ».
Et puis c’est Baudelaire qui traduira « The Philosophy of composition » sous le titre « La Genèse d’un poème ». Nouvelle publiée en 1846, elle décline à nouveau le thème du « never more » – « jamais plus » – semant au passage quelques notations qui attestent d’une vision parente du monde.
Celle-ci, par exemple :
« Jamais plus ! De cette idée, l’immensité, fécondée par la destruction, est remplie du haut en bas, et l’Humanité, non abrutie, accepte volontiers l’Enfer, pour échapper au désespoir irrémédiable contenu dans cette parole. »
Pour aller à l’essentiel : non seulement Edgar Poe, avide de tout ce qui est relatif au « paranormal » a lu Swedenborg mais en plus il est en relation épistolaire avec des swedenborgiens.
Et surtout Poe écrit en 1848 un essai métaphysique intitulé « Eureka » qui expose uniment sa cosmologie, écrit atypique que Baudelaire traduira en 1859.
Sans entrer dans les détails, indiquons simplement que Jean-Pierre Luminet, éminent astrophysicien, lui reconnaît un mérite considérable :
« Voulant embrasser d’un seul coup d’oeil l’immensité de tout ce qui est connu en son temps, Poe offre à ses lecteurs un texte visionnaire dans lequel il anticipe de multiples découvertes du XX° siècle : les trous noirs, la théorie du chaos, l’expansion de l’espace, l’existence des nébuleuses et bien d’autres encore. »
Préface de l’édition de 2017 de l’essai d’Edgar Poe sous le titre « L’univers selon Edgar Poe ». Il est assez truculent de relever que c’est la traduction de Baudelaire qui a été conservée.
Quant à l’accointance entre Edgar Poe et Charles Baudelaire, elle émerge d’un bout à l’autre de cet essai dont la traduction a dû ravir le traducteur.
Après avoir posé la Divinité (avec une majuscule) comme point de départ de tout et cité le baron de Biefield, déclarant que pour connaître Dieu, « il faut être Dieu même », Poe admet implicitement une survie de l’âme ; citation :
« j’ose toutefois demander si notre ignorance actuelle de la Divinité est une ignorance à laquelle l’âme est éternellement condamnée. »
Après quoi il reprend, à sa façon, le dogme de la création : « Enfin, contentons-nous aujourd’hui de supposer que c’est Lui, — Lui, l’Incompréhensible (pour le présent du moins), — Lui, que nous considérerons comme Esprit, c’est-à-dire comme non-Matière (distinction qui, pour tout ce que nous voulons atteindre, suppléera parfaitement à une définition), — Lui, existant comme Esprit, qui nous a créés, ou faits de Rien, par la force de sa Volonté, (…) »
Ce Baudelaire croyant – voire mystique – a été généralement ignoré par la critique universitaire. Une exception, mais plutôt inquiétante : Jean-Pierre Albert, anthropologue, qui a donné une conférence intitulée : « Utopies sensorielles. Du jardin d’Eden aux Fleurs du mal.»
Visiblement les spécialistes en littérature lui préfèrent le Baudelaire subjugué par la volupté, l’horreur, la mélancolie. Dans l’article que wikipedia lui consacre, Dieu n’est cité qu’une fois et métaphoriquement, sous la plume de Rimbaud, comme nous l’avons vu en exergue :
« Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu. »
2) Divers essais
Ils portent sur l’art, la littérature, la philosophie du quotidien.
a) « Les drames et les romans honnêtes »
Celui-ci est édité en 1850. Baudelaire s’y insurge contre la moralisation de la littérature, en particulier contre la contrainte d’exposer de bons sentiments à laquelle paraissent se soumettre certains dramaturges.
Cette « fureur d’honnêteté », comme il la nomme, aboutit paradoxalement à un double naufrage : celui de la vraisemblance et celui de la moralité véritable.
Et notre poète qui est la droiture même, que nous avons vu rétif à toute « fausse monnaie » en matière de morale, suffoque à nouveau d’indignation.
Il donne deux exemples de cette perversion dont celui-ci, tiré d’une pièce d’Émile Augier 62 :
« Écoutons Gabrielle, la vertueuse Gabrielle, supputer avec son vertueux mari combien il leur faut de temps de vertueuse avarice, en supposant les intérêts ajoutés au capital et portant intérêt, pour jouir de dix ou vingt mille livres de rente. Cinq ans, dix ans, peu importe, je ne me rappelle pas les chiffres du poëte. Alors, disent les deux honnêtes époux : NOUS POURRONS NOUS DONNER LE LUXE D’UN GARÇON ! Par les cornes de tous les diables de l’impureté ! par l’âme de Tibère et du marquis de Sade ! que feront-ils donc pendant tout ce temps-là ? Faut-il salir ma plume avec les noms de tous les vices auxquels ils seront obligés de s’adonner pour accomplir leur vertueux programme ? »
__________________ 62 « La ciguë », comédie en deux actes, de 1844.
Après quoi Baudelaire se place, sans le nommer, sous le patronage de Théophile Gautier, se référant plus particulièrement à la préface que celui-ci écrivit pour son premier roman, « Mademoiselle de Maupin », édité en 1834.
Nul doute qu’il n’y ait retrouvé les principes de son esthétique personnelle, en particulier l’affirmation catégorique que l’art doit être entièrement voué au beau, ne devant prêter allégeance à rien ni à personne;
« Retrouvé », parce que ces deux-là se sont connus dans leur jeunesse au club des
« hashishins » de l’hôtel Pimodan, qu’ils y ont goûté ensemble au « dawamesk » et que leurs esprits se sont élevés de conserve 63 vers les cimes du beau en soi.
________________ 63 Oui, je sais, ça fait un peu trop « boîte de » ; mais c’est l’expression originelle, relative à deux navires qui voguent dans la même direction, conservant la vue l’un sur l’autre. Et ici, s’agissant de nos deux écrivains, elle convient bien mieux.
Fraternité esthétique tellement essentielle que non seulement c’est à Théophile Gautier que Baudelaire dédiera la première édition des « Fleurs du mal », mais encore qu’il le fera en des termes dithyrambiques. Qu’on en juge : « Au poète impeccable, le parfait magicien ès Lettres françaises, à mon très cher et très vénéré maître et ami, Théophile Gautier avec les sentiments de la plus profonde humilité, je dédie ces fleurs maladives.»
Pourquoi cette dédicace disparaît-elle ensuite ?
On l’ignore, tout dépendant de la date où il le décide.
Peut-être une discussion qui tourne mal. A titre d’hypothèse, Théophile Gautier aimait beaucoup Alfred de Musset ; or on a vu plus haut que Baudelaire le détestait.
Et puis il a pu se rendre compte de ce que cette dédicace avait d’excessif, avant de réaliser qu’il aurait été encore plus discourtois de l’affadir que de la supprimer.
Enfin il existe entre Baudelaire et Gautier une dissension profonde sur la nature de l’art poétique. Cette suppression peut par conséquent s’expliquer par la rupture avec le credo de ce qui deviendra l’école du Parnasse.
Pourtant Théophile Gautier n’a, semble-t-il, pas cessé d’admirer et de vénérer Baudelaire, au point de lui consacrer une notice biographique.
Trait remarquable : celle-ci est aussi un plaidoyer en faveur du poète, qui s’élève contre les bruits qui circulent à propos de sa supposée dépravation. Citation :
« Ce poète, que l’on cherche à faire passer pour une nature satanique, éprise du mal et de la dépravation (littérairement, bien entendu), avait l’amour et l’admiration au plus haut degré. »
Source inégalable de celui qui est resté, dans la littérature du foisonnant XIX° siècle – et pour l’essentiel – comme l’auteur du « Roman de la momie » ; dans le meilleur des cas, celui qui portait un gilet rouge lors de la bataille d’Hernani.
Ce qui est à la fois le défaut et la qualité de Théophile Gautier, c’est une description scrupuleuse de tout ce qu’il rapporte, n’omettant aucun détail. Sa véritable vocation, probablement méconnue de lui-même, était sans doute celle d’historien de première source.
Piètre poète, mais grand travailleur il co-écrit le livret de Giselle, ballet qui connaît un succès considérable, ce qu’il ne parvient pas à s’expliquer.
Par contre, capable d’exprimer ses idées avec la plus grande précision, il compose, à l’occasion de la préface de son roman, une épitre incendiaire contre la bien-pensance, laquelle, sans doute, a enchanté Baudelaire.
Étape intermédiaire de cette charge qui est un combat de plus :
« À quoi sert la beauté des femmes ? Pourvu qu’une femme soit médicalement bien conformée, en état de faire des enfants, elle sera toujours assez bonne pour des économistes.
À quoi bon la musique ? À quoi bon la peinture ? Qui aurait la folie de préférer Mozart à M. Carrel, et Michel-Ange à l’inventeur de la moutarde blanche ?
Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ; tout ce qui est utile est laid, car c’est l’expression de quelque besoin, et ceux de l’homme sont ignobles et dégoûtants, comme sa pauvre et infirme nature.
L’endroit le plus utile d’une maison, ce sont les latrines.
Moi, n’en déplaise à ces messieurs, je suis de ceux pour qui le superflu est le nécessaire, (…) »
Bref, l’art n’a à rendre des comptes à qui que ce soit.
Et l’essai de Baudelaire s’inscrit naturellement dans cette lignée.
b) « L’école païenne », un article réactionnaire
Cette apologie de « l’art pour l’art », de l’art voué exclusivement au beau, ne va pas persister longtemps dans l’esprit de Baudelaire.
C’est sans doute l’origine du clivage intellectuel avec Théophile Gautier.
Celui-ci dans « Émaux et camées », recueil de poèmes paru en 1852 – soit la même année que cet article – fait porter l’essentiel de ses efforts sur la forme.
C’est son patient travail sur les ressources infinies de l’octosyllabe qui fera de ce recueil le livre fondateur de l’école du Parnasse.
Mais il y a aussi le fond, ou, plus exactement, le fait qu’il soit devenu accessoire, prétexte, en somme. A titre d’illustration – dans le poème intitulé « Caerulei occuli » – soit « Yeux céruléens 64 » ou, plus littérairement, « Les yeux bleus » – Gautier évoque successivement le roi de Thulé 65, Cléopâtre, Harald et enfin la sirène, qui décline, dans les dernières strophes, tous ses charmes mortels.
_______________ 64 D’un bleu intense ou d’un bleu sombre. 65 C’est Goethe qui a imaginé ce personnage dans un poème de 1774 que Gérard de Nerval traduira en 1855. Mais la plus connue des traductions est celle que Gounod utilisera dans son opéra Faust et mettra donc en musique. Première strophe :
Il était un roi de Thulé À qui son amante fidèle Légua, comme souvenir d’elle, Une coupe d’or ciselé.
D’autre part ce qu’on pourrait tenir pour le système implicite des représentations sur lequel s’édifie cette poétique, puise largement dans les légendes du Nord, les croyances et mêmes les pratiques antiques.
A cet égard le poème intitulé « Bûchers et tombeaux » est exemplaire, exposant l’évidente supériorité des pratiques funéraires antiques sur les chrétiennes.
Les deux premières strophes :
Le squelette était invisible,
Au temps heureux de l’Art païen ; L’homme, sous la forme sensible, Content du beau, ne cherchait rien.
Pas de cadavre sous la tombe, Spectre hideux de l’être cher, Comme d’un vêtement qui tombe Se déshabillant de sa chair,
Du coup il ne fait pas de doute que, dans l’esprit de Baudelaire, non seulement Théophile Gautier fait partie de ce qu’il nomme « L’école païenne » mais encore qu’il pourrait bien en être le fondateur.
A cet égard la gravure commandée à Félicien Rops pour servir de frontispice 66 à l’édition ultérieure des « Épaves » – poèmes que le tribunal dirigé par Pinard avait condamné Baudelaire à ôter des « Fleurs du mal » – pourrait y trouver une double explication.

66 Titre principal d’un livre illustré de gravures ou ornements.
Ce serait une façon de signifier à la fois à Théophile Gautier et autres tenants de l’école païenne, au procureur Pinard et autres bien-pensants, que lui, Baudelaire, fait bel et bien partie de l’école chrétienne, même s’il n’est d’aucune confession.
Position difficile dont ce court article porte partout la marque.
Le dernier poème du recueil de Théophile, intitulé « L’Art », décline de plusieurs façons l’idée que le temps emporte tout- sauf les oeuvres.
Une strophe :
Les dieux eux-mêmes meurent. Mais les vers souverains Demeurent
Plus forts que les airains.
Pour Baudelaire, au contraire, il s’agit ici d’arrimer le Beau au Vrai.
Or le vrai, dans sa conception, c’est l’attestation d’une permanence de l’être que l’on trouve à la fois dans la science et dans la philosophie. Citation :
« Le temps n’est pas loin où l’on comprendra que toute littérature qui se refuse à marcher fraternellement entre la science et la philosophie est une littérature homicide et suicide. »
Comment interpréter cette assertion ?
Comme ceci : la science énonce des vérités intemporelles, la philosophie découvre partout dans la nature la finalité qui atteste l’oeuvre d’un Créateur.
C’est ici, précisément qu’intervient le clivage entre ces deux sensibilités poétiques. Certes le Parnasse a fait école – le mot d’ordre de « l’art pour l’art » ayant, en ce siècle agité, la puissance des jeunes talents ; mais les profondes racines des « Fleurs du mal » ont eu , tout compte fait, une postérité plus conséquente.
Parmi les talents les plus remarquables, côté Parnasse on peut citer Leconte de Lisle et José-Maria de Heredia ; dans la postérité de Baudelaire, comme nous l’avons dit, il faut placer Mallarmé et Yves Bonnefoy.
Quant aux grands poètes à venir, Verlaine et Rimbaud, ils ne font pas allégeance à qui que ce soit, même si, comme nous l’avons vu, Rimbaud place Baudelaire dans son panthéon.
On ne se lassera pas de le répéter : il ne peut pas y avoir d’école en littérature. Toute création véritable est, par essence, singulière. Cela n’interdit pas l’intelligence de l’autre.
Verlaine compose un poème paradoxal, intitulé « À Charles Baudelaire ». Premiers vers :
Je ne t’ai pas connu, je ne t’ai pas aimé, Je ne te connais point et je t’aime encor moins :
Le second quatrain est une évocation cryptée de la crucifixion, et le premier tercet témoigne de la profonde intelligence que Verlaine eut de Baudelaire :
Tu tombas, tu prias, comme moi, comme toutes Les âmes que la faim et la soif sur les routes Poussaient belles d’espoir au Calvaire touché !
On est donc ici dans le véridique ; si Baudelaire avait voulu faire école, c’eût été le premier article de son credo.
Et puis, on retrouve dans ces vers les marques indubitables de cette liberté qu’il a été le premier à introduire dans l’art de la versification.
Dernier point : ce poème est le premier de l’un des derniers recueils de Verlaine – « Liturgies intimes » – édité en 1892, quelques années avant sa mort.
Autant dire qu’il est en position de dédicace pour la majeure partie de l’oeuvre.
Mais revenons à Baudelaire. c) « La morale du joujou »
En 1853, alors qu’il vient de boucler de nouvelles traductions d’Edgar Poe, rémunératrices, il fait paraître dans on ne sait quel journal 67 un article composite relatif à ce qu’on pourrait nommer une « sociologie du jouet », mais ponctué par plusieurs séquences narratives, relevant de l’autobiographie.
La première relate une petite scène de sa propre enfance, lors de laquelle on voit le petit Charles invité à choisir, par une dame qui l’a reçu avec sa mère dans son hôtel particulier, un joujou dans une pièce où elle constitue ce qu’elle nomme « le trésor des enfants ».
Il avait spontanément choisi le plus beau ; il doit y renoncer sur les instances de sa mère.
________________ 67 La tradition rapporte que celui-ci serait « Le monde littéraire » ; mais pas moyen d’en trouver trace. Il n’est pas non plus répertorié dans la liste de la presse écrite disparue en France.
Il pourrait s’agir d’une publication intermittente du Figaro. En 1854, reprenant ce journal, M. de Villemessant y avait embauché Baudelaire comme rédacteur. La lune de miel sera de courte durée.
De là résulte une longue et précise analyse du rapport des enfants à leurs joujoux. Rien d’ennuyeux dans ces lignes mais une parfaite restitution du vécu des petits tout en conservant sur eux le regard pénétrant de l’adulte, avec à la fois son tropisme analytique et sa subjectivité.
Illustration : cette séquence relative au « joujou du pauvre » :
« Sur une route, derrière la grille d’un beau jardin, au bout duquel apparaissait un joli château, se tenait un enfant beau et frais, habillé de ces vêtements de campagne pleins de coquetterie. »
Plus loin : « À côté de lui gisait sur l’herbe un joujou splendide aussi frais que son maître, verni, doré, avec une belle robe, et couvert de plumets et de verroterie. Mais l’enfant ne s’occupait pas de son joujou, et voici ce qu’il regardait : de l’autre côté de la grille, sur la route, entre chardons et orties, il y avait un autre enfant, sale, assez chétif, un de ces marmots sur lesquels la morve se fraye lentement un chemin dans la crasse et la poussière.
À travers ces barreaux de fer symboliques, l’enfant pauvre montrait à l’enfant riche son joujou, que celui-ci examinait avidement comme un objet rare et inconnu. Or ce joujou que le petit souillon agaçait, agitait et secouait dans une boîte grillée, était un rat vivant ! »
Baudelaire écrit ensuite que les parents du petit souillon lui ont offert ce « joujou vivant » par économie. Je crois qu’il le fait par souci des convenances ; à cette date le Figaro n’est pas encore un journal ultra mais il est déjà un journal royaliste.
Or sous le toit d’un paysan pauvre on ne prend pas le risque de laisser repartir un rat dans la nature. Et puis quand on n’a que ce qu’il faut pour survivre, on ne s’occupe pas de cadeaux. C’est donc le gamin qui a fabriqué le piège pour capturer l’animal. Seulement c’est rassurant pour les lecteurs d’apprendre que même les paysans pauvres font des cadeaux à leurs enfants.
Ceci dit, cet article est l’occasion pour Baudelaire de restituer cette scène qui l’a frappée et de laquelle émerge, une fois encore, cette sensibilité sympathique du regard qui jamais ne se laisse subjuguer par les préjugés.
Par ailleurs il a clairement mis en évidence, avec toutes les nuances possibles, la fonction éducative du jouet – à savoir l’imitation des adultes.
Le comble de l’étroitesse de vue est atteint, selon lui, dans la formation des filles :
« Je ne veux pas parler de ces petites filles qui jouent à la madame, se rendent des visites, se présentent leurs enfants imaginaires et parlent de leurs toilettes. Les pauvres petites imitent leurs mamans ; elles préludent déjà leur immortelle puérilité future, et aucune d’elles, à coup sûr, ne deviendra ma femme. »
A quelques décennies de là ce court texte va inspirer Rainer Maria Rilke – bilingue autrichien, suisse et parisien de coeur – qui le reproduira à la suite de son essai intitulé « Les poupées ».
Baudelaire poursuit ses traductions d’Edgar Poe ; nous savons désormais qu’elles ne sont pas purement alimentaires. Et puis, toujours passionné de peinture – comme était son père – il fait encore un compte rendu du « Salon de 1855 »
e) L’exposition universelle de 1855
Pas de brochure de la plume de Baudelaire pour cet événement ; seulement trois articles.
De fait notre critique d’art affronte un problème de taille : il va falloir se prononcer à propos de l’art de Gustave Courbet. Indépendamment de la délicate question esthétique, ils ont fait connaissance depuis longtemps, probablement par l’intermédiaire de Champfleury, ami de Courbet et camarade de Baudelaire, sur les barricades comme au Salut public.
Le problème c’est que Courbet est clairement de la famille des « dessinateurs », – autrement dit du côté d’Ingres, que Baudelaire débine une fois encore – et pas de celui des « coloristes » dont le chef de file est Delacroix, qu’il célèbre une fois de plus.
Or non seulement Delacroix a pour Courbet la plus grande estime mais encore la grande oeuvre de celui-ci – « L’atelier du peintre » – vient d’être refusée au salon.
Pas moyen de cautionner la censure ou de déplaire à son peintre favori.
Et comme si ça ne suffisait pas, Courbet a inséré dans ce tableau une reproduction d’un portrait qu’il avait fait de lui, Baudelaire, jeune – dans le style « coloriste », contrairement au reste – mais aussi de Jeanne se regardant dans un miroir.
On ne sait quand ni comment il négocie avec le peintre mais Charles obtient que le portrait de Jeanne soit effacé.

Supposition : influencé par les brochures précédentes de Baudelaire, Courbet s’était d’abord mis à l’école de Delacroix.
Mais cette fois-ci il a opté pour le style « réaliste » parce que c’est au fond le seul qui puisse restituer la dimension symbolique de sa composition.
Et Delacroix n’y voit aucune objection.
Quant à la dimension symbolique, il l’expose sans doute ingénument : tout ce qu’il déteste à gauche ; tout ce qu’il aime à droite ; tout ce qu’il se plaît à peindre, au milieu.
Baudelaire est la dernière figure à droite ; le préféré, en somme.
Après quoi on peut imaginer une sorte de négociation à mots couverts : Gustave effacera Jeanne – c’est dommage : elle était en style « coloriste » – « Ça n’est pas si important que ça… », dit Charles. Mais, par le phénomène optique de transparence accrue, l’ombre de Jeanne est toujours là.

Tout cela émane de ce qu’on peut imaginer d’après l’écho qu’on en a gardé, à savoir trois articles de Baudelaire parus dans « La revue française » en 1855.
Texte composite, généralement méconnu mais essentiel, en particulier parce qu’il commence par l’affirmation de l’oeuvre de « la Providence » dans toute espèce de finalité.
Et puis, une fois posé le principe de « l’harmonie de l’univers » (sic), notre critique invoque la beauté, opposant celle, étrangère, par laquelle le voyageur ingénu se laisse subjuguer et celle, dogmatique, qu’enseignent les professeurs d’esthétique.
Après quoi Baudelaire, qui s’est d’abord placé dans cette seconde catégorie, fait amende honorable, sans doute, quoi qu’il n’en dise rien, à propos de ses affirmations péremptoires sur le clivage entre dessinateurs et coloristes :
« Condamné sans cesse à l’humiliation d’une conversion nouvelle, j’ai pris un grand parti. Pour échapper à l’horreur de ces apostasies philosophiques, je me suis orgueilleusement résigné à la modestie : je me suis contenté de sentir ; je suis revenu chercher un asile dans l’impeccable naïveté.»
Et puis, en dépit de ce parti pris de la modestie, un premier article de foi : « Le beau est toujours bizarre ». Même s’il est difficile de lui donner sens à partir de ce terme – bizarre : qui s’écarte de l’ordre habituel des choses – on peut concéder simplement que ce que nous qualifions de « beau », c’est ce qui nous arrête, ne serait-ce que pour un instant de contemplation, et qui nous surprend toujours.
Mais pourquoi ? Paradoxalement, rien de formel dans l’esprit de Baudelaire, au contraire. Et ici il se place sous le patronage d’un éminent écrivain :
« On raconte que Balzac (qui n’écouterait avec respect toutes les anecdotes, si petites qu’elles soient, qui se rapportent à ce grand génie ? ), se trouvant un jour en face d’un beau tableau, un tableau d’hiver, tout mélancolique et chargé de frimas, clair-semé de cabanes et de paysans chétifs, – après avoir contemplé une maisonnette d’où montait une maigre fumée, s’écria : » Que c’est beau ! Mais que font-ils dans cette cabane ? à quoi pensent-ils ? quels sont leurs chagrins ? les récoltes ont-elles été bonnes ? ils ont sans doute des échéances à payer ? «
Rira qui voudra de M. de Balzac. J’ignore quel est le peintre qui a eu l’honneur de faire vibrer, conjecturer et s’inquiéter l’âme du grand romancier, mais je pense qu’il nous a donné ainsi, avec son adorable naïveté, une excellente leçon de critique. »
De là le principe que Baudelaire en tire : « La peinture est une évocation, une opération magique », bref l’équivalent de ce que George Steiner nommera plus tard « la présence réelle » et qui fonde l’essentielle parenté entre peinture et poésie.
Après une longue digression sur l’illusion du progrès matériel – et ici Baudelaire est véritablement visionnaire – il s’évertue à éradiquer ce qui en serait l’équivalent dans la création artistique.
De là, un nouvel article de foi : « L’artiste ne relève que de lui-même.»
Du coup on ne peut évidemment pas demander à Courbet de se ranger dans la brigade « Défense et illustration d’Eugène Delacroix ».
Sur Ingres, après quelques précaution oratoires, ce jugement : « C’est une sensation puissante, il est vrai, – pourquoi nier la puissance de M. Ingres ? – mais d’un ordre inférieur, d’un ordre quasi maladif. »
Même reconnaissance du droit à ce qu’on pourrait nommer la singularité essentielle de l’artiste véritable – Baudelaire a conspué plus haut la troupe des imitateurs – mais du coup, émergence de la nature de son rejet :
« Plus d’imagination, partant plus de mouvement. Je ne pousserai pas l’irrévérence et la mauvaise volonté jusqu’à dire que c’est chez M. Ingres une résignation (…) »
Extrapolons : sous le pinceau d’Ingres pas de fumée qui, s’échappant de la cheminée d’une modeste chaumière, découvrirait à l’esprit de l’admirateur, une humble famille paysanne ; pas de tremblement de la couleur qui rendrait une odalisque 68 simplement vivante… pas d’arrière-boutique, pas d’arrière-monde… une peinture athée, en somme.
_______________ 68 Esclave attachée au service des femmes d’un harem.
Après avoir associé Courbet à cette école de la forme, Baudelaire poursuit sa critique en montrant comment Ingres, abolissant toutes les imperfections de la nature, ne produit au bout du compte « (qu’) une matière molle et non vivante ».
Quoiqu’il ne l’ait pas écrit on peut en inférer qu’il lui reproche d’aller jusqu’à éradiquer toute chance, pour qui contemple ses oeuvres, d’en voir émerger la beauté.
Cet « enfermement dans le formol » – si l’on peut dire – est particulièrement sensible dans la représentation des grandes figures légendaires : Jeanne d’Arc et Napoléon.
Rien ne soutient le char céleste de l’Empereur, ni les rennes qui contrôleraient la force des chevaux, ni l’ascension glorieuse ; ce char va donc inévitablement d’effondrer. Emporté par sa fougue, Baudelaire parvient enfin à formuler son grief : « absence totale de sentiment et de surnaturalisme ».
Comme Ingres est quasiment l’artiste le plus célébré de l’époque, l’article est refusé par un premier journal avant d’être publié dans « Le Portefeuille ».
Le troisième article est une consécration du génie de Delacroix, « le peintre aimé des poètes », comme il est écrit ; ce titre n’a rien d’anodin.
Comme il ne peut pas reproduire son apologie précédente, Baudelaire cite largement le poème de Théophile Gautier intitulé Compensation dans lequel celui-ci déclare en particulier :
Il naît sous le soleil de nobles créatures
Unissant ici-bas tout ce qu’on peut rêver :
Corps de fer, cœurs de flamme, admirables natures !
Dieu semble les produire afin de se prouver ; Il prend pour les pétrir une argile plus douce, Et souvent passe un siècle à les parachever.
Après quoi Baudelaire, qui s’en prend à ceux qui ont osé critiquer ce grand peintre, a sans doute le dessein d’entrer dans la présentation de quelques nouvelles oeuvres.
Mais, comme c’est une exposition universelle et qu’on est allé chercher toutes les oeuvres disponibles, il revient irrésistiblement devant celles qui l’avaient enthousiasmé dix ans plus tôt.
C’est que, comme il le dit au passage, par un involontaire alexandrin, « Et le tableau quitté nous tourmente et nous suit. »
Des femmes peintes par Delacroix, créatures issues des textes religieux, mythologiques ou littéraires, il dit ceci : « On dirait qu’elles portent dans les yeux un secret douloureux, impossible à enfouir dans les profondeurs de la dissimulation. Leur pâleur est comme une révélation des batailles intérieures.»
Bref, une fois encore, « présence réelle ». Ce pouvoir de créer accordé aux grands artistes est à nouveau restitué, sans le dire explicitement, comme un miroitement de la création divine.
Dans la même veine, il suggère la correspondance de ce qu’on pourrait nommer « les arts poétiques », étymologiquement « créateurs » :
« On dirait que cette peinture, comme les sorciers et les magnétiseurs, projette sa pensée à distance. »
Plus loin, à propos de l’emploi de la couleur : « Ce singulier phénomène tient à la puissance du coloriste, à l’accord parfait des tons, et à l’harmonie (préétablie dans le cerveau du peintre) entre la couleur et le sujet.
Il semble que cette couleur, qu’on me pardonne ces subterfuges de langage pour exprimer des idées fort délicates, pense par elle-même, indépendamment des objets qu’elle habille. Puis ces admirables accords de sa couleur font souvent rêver d’harmonie et de mélodie, et l’impression qu’on emporte de ses tableaux est souvent quasi musicale. »
Enfin, après un passage par Edgar Poe – et l’usage de l’opium – la formule qui résume la peinture de Delacroix : « Comme la nature perçue par des nerfs ultra-sensibles, elle révèle le surnaturalisme. »
Dimension quasi religieuse de « ces arts poétiques » dont on retrouve encore l’écho dans une liasse de feuillets qui sont restés à l’état de brouillon, les premiers mots faisant titre : « Puisque réalisme il y a ».
Au terme de quelques propositions lapidaires qui esquissent l’idée que le réalisme est une blague de Champfleury, évangile esthétique foireux dont Courbet s’est fait l’apôtre, la pensée de Baudelaire s’exprime, plus lumineuse que partout ailleurs :
« La Poésie est ce qu’il y a de plus réel, c’est ce qui n’est complètement vrai que dans un autre monde. »
«Ut pictura poesis 69 », par conséquent. Quittons l’exposition de 1855. Pour le poète qu’est Baudelaire, l’année décisive est la suivante.
______________ 69 « Comme la peinture est la poésie »
II Le centre de gravité de l’oeuvre
1) La rupture
En septembre 1856 il écrit à sa mère, installée à Honfleur après son veuvage :
« Ma liaison, liaison de quatorze ans, avec Jeanne est rompue. J’ai fait tout ce qu’il était humainement possible de faire pour que cette rupture n’eût pas lieu. Ce déchirement, cette lutte a duré quinze jours. Jeanne m’a toujours imperturbablement répondu que j’avais un caractère intraitable, et que d’ailleurs je la remercierais moi-même un jour de cette résolution. »
Relation orageuse, sans doute, mais aussi conjugale.
Deux choses à relever : 1° : c’est Jeanne qui décide d’y mettre un terme. 2° : c’est le comportement de Charles qui est la cause de cette rupture.
Il est probable que ce comportement « irresponsable » – donc fort éloigné de celui d’un chef de famille que Jeanne attendait peut-être – trouve ses racines dans la constellation oedipienne de son enfance.
Du reste quelques années plus tard il formera le projet d’aller vivre à Honfleur auprès de sa mère…
Mais Jeanne disparue, il rassemble les poèmes qu’elle lui a inspirés et il en compose probablement d’autres afin de fixer, par la magie de la poésie, les sensations et la matière des souvenirs qui ne se renouvelleront plus.
C’est ce qui va donner ce que les universitaires nomment « le cycle Jeanne Duval » : 15 poèmes qui ne constituent pas la première partie du recueil mais qui sont plutôt son noyau de condensation.
Le projet d’un recueil de poèmes date de 1845.
Deux titres ont précédé celui que Baudelaire choisira finalement sur les conseils d’Hippolyte Babou 70 : « Les lesbiennes » et « Les limbes ».
_______________ 70 Critique littéraire ; Baudelaire a probablement fait sa connaissance par l’intermédiaire de Charles Asselineau. Ce jour du début 1855, alors que le recueil est en projet et qu’ils se sont attablés ensemble au café Lemblin, il convainc Baudelaire qui a dû lui donner quelques indications sur son contenu, d’adopter le titre qu’il lui propose.
Pourquoi la première option, « Les lesbiennes » ?
Sans doute parce qu’il est troublé – mais essentiellement sur le plan métaphysique – par ce corps à corps féminin. La femme est au fond dans sa nudité, altruiste par nature, puisque manifestement vouée à pourvoir à la nourriture du nouveau-né. Éditeur ou critique ou ami, on ne sait… mais l’un ou l’autre l’a dissuadé de choisir ce titre qui ferait immanquablement scandale.
Il opte donc pour « Les limbes », image, là encore, issue de sa représentation du monde. Sa vie et celles de ses semblables pourraient bien constituer les limbes d’un séjour à venir, plus heureux, aux marges du paradis 71.
Pas de chance : le titre est déjà pris.
__________________ 71 Les limbes, invention théologique en plusieurs étapes, étaient les lieux de séjour des morts qui ne méritaient pas l’enfer mais ne pouvaient prétendre au paradis. Ce fut d’abord le cas des êtres humains nés avant la venue au monde de Jésus Christ, puis, par la suite, dans la religion catholique, celui des enfants morts avant d’avoir pu être baptisés.
Ce qui fait que la proposition de Babou emporte définitivement la mise, c’est évidemment la rupture avec Jeanne. La dédicace initiale, à Théophile Gautier, le confirme : il voue au « poète impeccable », ainsi qu’il le désigne, « ces fleurs maladives » ; le malade – de chagrin, de désespoir – c’est lui ; le mal, c’est donc aussi cette rupture.
Et cette floraison – même si elle a aussi une dimension théologique – c’est ce qui surgit d’abord du départ de la femme aimée.
Mise au point : la formule « Les fleurs du mal » est de Baudelaire. Seulement il comptait sans doute, à l’origine, n’en faire qu’une partie du recueil.
Autre difficulté : non seulement il a soigneusement agencé l’ordre des parties du recueil… mais encore l’ordre des poèmes à l’intérieur de chacune de ces parties.
Or quand la première édition paraît en juin 1857, il faut à peine plus d’un mois, après une critique incendiaire du Figaro, pour que le recueil soit retiré de la vente pour « outrage à la morale publique et religieuse ».
Nous y reviendrons plus loin.
Au terme du procès 6 poèmes seront interdits de publication. Autant dire – cette première édition ne comportant que 100 poèmes – que c’est toute l’architecture de l’ensemble qui est remise en cause.
Je fais le double choix d’en aborder l’étude à partir de deux axes :
1° Position de la figure de Jeanne Duval comme centre de gravité de l’oeuvre.
2° Restitution partielle de sa première édition chaque fois que la modification a été imposée à Baudelaire et non pas choisie.
2) Le cycle Jeanne Duval
Il faut commencer par le circonscrire avant de l’analyser, d’une part parce que certains des poèmes inspirés par la « Vénus noire » précèdent évidemment cette rupture, d’autre part parce que Baudelaire, ne le nommant pas, ne l’a pas intégré comme tel à l’architecture de son recueil.
Pourtant il est là. Personnellement je le place à partir du poème intitulé « Hymne à la beauté » – qui en est le prologue – au sonnet XXXIX, sans titre, qui en est l’épilogue.
Puisque ce cycle constitue, pas à pas, les fondations du recueil, nous allons le parcourir de façon méthodique mais brève, en particulier pour les poèmes déjà vus.
a) Hymne à la beauté
Ce poème / prélude a sensiblement développé et modifié, dans la deuxième édition (1861) le sonnet placé là à l’origine et intitulé « La Beauté ».
Celui-ci fait toujours partie du recueil mais a été avancé
L’hymne porte cette fois la marque d’une ambivalence essentielle que nous allons retrouver, d’une façon ou d’une autre, à chaque étape de ce cycle.
La beauté est désormais, et à la fois, céleste et infernale.
Or ici elle s’enracine très clairement dans la beauté de l’être aimé, comme il est signifié dans ces deux vers :
Tes baisers sont un philtre et ta bouche une amphore Qui font le héros lâche et l’enfant courageux
Audace de l’enfant qui enlace spontanément sa mère, peur du héros qui, craignant d’être refusé, peine à déclarer son amour.
Et si Jeanne – dont le portrait va émerger des poèmes qui suivent – participe en tout de cette dualité, c’est tout simplement parce qu’elle en est la source.
Cette nouveauté est marquée par le « Qu’importe ! », scandé à 3 reprises dans les deux dernières strophes.
Jeanne, à la fois source de jouissance et d’inspiration, a transfiguré à ce point sa vie, a tellement allégé son spleen, que le poète amoureux est prêt à payer cette débauche – au propre comme au figuré, par exemple ces dépenses exorbitantes qu’elle exige – par une damnation éternelle.
C’est la rencontre de Jeanne qui, pourrait-on dire, infléchit la théologie de Baudelaire.
Jusqu’ici la beauté – comme on l’a vu en particulier dans son analyse des oeuvres exposées dans les salons – était le signe d’une accointance avec le divin, qu’il s’agisse de la beauté céleste du soleil couchant ou du pouvoir créateur de l’artiste.
Désormais il n’est pas exclu qu’elle tienne en particulier son pouvoir de subjuguer d‘une source démoniaque. Ce trait est signifié en particulier dans le poème intitulé « Le serpent qui danse ».
b) Parfum exotique
Le sonnet qui suit – et qui ouvre le cycle proprement dit – nous livre la source de cette attirance irrésistible que Jeanne exerça sur Charles.
Son charme ne vient pas de son apparence – elle n’est pas belle – mais de la fragrance 72 que son corps dégage.
Par elle, dès qu’il l’a approchée pour la première fois, Baudelaire a perçu toutes les notes odorantes de son périple dans les îles, chacune appelant toute une palette de sensations puis de souvenirs.
Et quand ensuite il la prend dans ses bras, c’est toute sa jeunesse qu’il retrouve ou, plus exactement, son versant coloré, lumineux, exaltant.
Par conséquent poème de la première rencontre.
________________ 72 Fragrance : odeur agréable
c) Les bijoux
A n’en pas douter ce sont ces vers érotiques qui ont porté à son comble l’indignation du critique du Figaro, avant de valoir à Baudelaire un procès et la contrainte de remanier son recueil.
Il y a dans cet aveu de ce qui chez Jeanne éveille son appétit sexuel quelque chose d’ingénu et, simultanément, dans la restitution de cette vague enfiévrée qui monte vers elle, une admirable restitution de son irrésistible plaisir.
Seulement, ce qu’il faut relever dans cette transposition poétique de leur pratique érotique, c’est la constante froideur de cette complaisante déesse.
Il nous est dit qu’elle « se laissait aimer », « essayait des poses ».
Enfin, en quelque vers, il nous est suggéré que Jeanne ne paraît pas avoir saisi que son amant est épuisé et satisfait, n’ayant elle-même rien connu de tel.
c bis) La chevelure
C’est le poème de remplacement. Nous l’avions évoqué à propos de l’abondante chevelure de Jeanne, objet de fascination pour ses amants, et qui apparaissait aussi dans le sonnet 73 relatant, sous couvert d’une métaphore, une violente dispute avec Théodore de Banville.
Comme c’est, dans ce cycle, le poème de la flamme érotique et amoureuse, analysons-le comme tel.

L’étrangeté de l’abondante chevelure de Jeanne est avant tout, pour celui qui est devenu son amant, la marque de l’exotisme. Et cet ailleurs, nourris de souvenirs, est de part en part empreint d’une nostalgie du bonheur.
Cet amour paraît donc reposer tout entier sur cette résurgence du voyage dans les mers du Sud.
C’est peut-être que l’Asie et l’Afrique, ici invoquées, ont acquis, du fait du terne, du blafard, du fade de l’Europe, une dimension nouvelle.
Il se pourrait aussi qu’y entre la nostalgie de la vie paisible et simple qu’il aurait pu mener aux côtés de la belle Dorothée, tendrement maternelle avec sa petite soeur.
Le vers « Je la veux agiter dans l’air comme un mouchoir ! » fait signe comme symbole du retour et des retrouvailles. Et la troisième strophe est, d’un bout à l’autre, le rêve éveillé de ce retour :
« J’irai là-bas où l’arbre et l’homme, pleins de sève, Se pâment longuement sous l’ardeur des climats ; Fortes tresses, soyez la houle qui m’enlève !
Tu contiens, mer d’ébène, un éblouissant rêve
De voiles, de rameurs, de flammes et de mâts : »
Dimension poétique de cette aspiration : retrouver par là, comme il est dit ensuite, le lieu où, citation : « mon âme peut boire À grands flots le parfum, le son et la couleur » ; en somme la source de toute création, de toute « poïésis ».
Une vingtaine d’années plus tard, dans sa « Lettre à Demeny », Rimbaud écrira : « Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. »
73 intitulé « A Théodore de Banville ».
Et Baudelaire, que Rimbaud baptisera « roi des poètes », à défaut du soleil des tropiques qui fait surgir une nature et une humanité luxuriantes, prend une cuillerée de « dawamesk » dans son café du matin.
Enfin la dernière strophe, après une nouvelle invocation des précieux souvenirs, livre la nature des rapports de Baudelaire et de Jeanne Duval :
Longtemps ! toujours ! ma main dans ta crinière lourde Sèmera le rubis, la perle et le saphir,
Afin qu’à mon désir tu ne sois jamais sourde !
N’es-tu pas l’oasis où je rêve, et la gourde Où je hume à longs traits le vin du souvenir ?
Rapports marqués par la vénalité, par conséquent, mais, du côté de Charles, pour de nobles motifs : Jeanne est la source de son inspiration.
Ceci, comme on le verra, n’exclut pas la satisfaction réciproque du « désir ».
d) Je t’adore à l’égal de la voûte nocturne
En quelques vers le poème suivant fait apparaître les sources de la dissension entre Jeanne et son amant. Elle est triste et taciturne ; soit nostalgie de sa vie antérieure, soit insatisfaction de la nature de sa relation à cet homme.
Or plus elle le fuit, plus elle l’excite.
Évidemment le poème ne va pas jusque là. Pourtant – et c’est un des traits de l’art de Baudelaire – il le laisse transparaître. Nous retrouverons cette sincérité, mais décuplée cette fois, dans « Le mauvais vitrier ».
En tout cas si l’on parcourt le recueil des « Fleurs du mal » comme un roman – ce qu’il est à coup sûr dans ce cycle – on sait à ce stade que les choses vont se gâter entre les amants.
e) Tu mettrais l’univers entier dans ta ruelle
C’est ici, déjà évoqué, le poème du joug de la femme aimée, joug devenu peu à peu insupportable à l’amant mais auquel il faut néanmoins consentir. Il y a donc d’abord renversement avec le poème précédent : ce n’est plus Charles qui indispose Jeanne mais l’inverse.
Mais dans la mesure où il l’aimait passionnément pourquoi ce mouvement d’elle vers lui ne mène-t-il pas simplement à une réciproque affection ?
C’est qu’elle a révélé sa nature de séductrice démoniaque et c’est que, simultanément, il ne trouve pas moyen de s’affranchir du pouvoir qu’elle exerce sur lui.
Ruelle du lit 74, bien sûr ; ce qui est dire qu’elle a séduit d’autres hommes. Tout le poème est édifié à l’aide des connotations du diabolique (âme cruelle, en cruautés féconde, buveur du sang, ce mal, reine des pêchés) et celle de l’ordurier (femme impure, vil animal, fangeuse).
Mais il ne faut pas s’arrêter à cette première apparence de vitupération 75.
________________ 74 Espace laissé entre un côté du lit et le mur. 75 Blâme ou reproche violent.
Ce poème est encore celui de l’amour ; Il s’y trouve sous deux formes :
=> Jeanne est une « femme publique », une sorte de prostituée même si elle ne fait pas le trottoir ; ceci est suggéré par ces vers :
Tes yeux, illuminés ainsi que des boutiques
Et des ifs flamboyants dans les fêtes publiques,
Mais elle vieillit et ses séductions disparaîtront ; deux autres vers :
Comment n’as-tu pas honte et comment n’as-tu pas Devant tous les miroirs vu pâlir tes appas ?
Celui qui le sait – et qui le lui dit – est aussi le seul qui restera auprès d’elle quand elle aura vieilli.
=> Cette diablesse de femme est en même temps un don de la puissance divine puisqu’elle est, pour le poète, une source constante d’inspiration.
C’est sous cette lumière qu’il faut placer les derniers vers :
Quand la nature, grande en ses desseins cachés, De toi se sert, ô femme, ô reine des péchés, – De toi, vil animal, – pour pétrir un génie ? Ô fangeuse grandeur ! sublime ignominie !
Cette femme est donc aussi la source de la souffrance et du malheur qui font éclore les fleurs poétiques.
Que nous apprend la suite du cycle ?
f) Sed non satiata 76
Bizarrement ce poème puise ses métaphores dans les mystères de la Grèce antique et le culte vaudou. Autant dire que si « l’école païenne » est proscrite par Baudelaire, il fait exception dès qu’ il s’agit d’approcher la source du pouvoir implacable que Jeanne Duval exerce sur lui.
___________________ 76 « Mais (toujours) pas satisfaite »
Métaphores seulement suggérées qui nimbent cette figure de la maîtresse d’une aura d’autant plus infernale qu’elle est composite et figurée en demi-teinte.
D’abord la figure de Messaline, cette épouse impériale qui eut autant d’amants qu’elle en voulait et autant de biens que le trône pouvait lui en procurer.
Comme elle obtient de son époux le pouvoir de faire exécuter qui elle veut, elle élimine ceux qui s’opposent à ses désirs ou ont excité sa convoitise par leurs possessions.
Elle finit par épouser l’un de ses amants. Le favori de Claude, qui lui expose le complot, parvient à obtenir sa condamnation à mort.
Comblée chaque jour… mais jamais satisfaite. Comme Messaline, Jeanne est incapable de borner ses désirs. De cette « hubris 77 » on ne peut rien attendre de bon.
Le premier quatrain ouvre l’espace imaginaire du culte vaudou, né dans les petits royaumes littoraux d’Afrique de l’Ouest puis transplanté aux Antilles et en Amérique du Sud, du fait de l’esclavage.
Les deux premiers vers reprennent la thématique de Parfum exotique et de La chevelure : exotisme de Jeanne.
C’est dans le troisième qu’apparaît cette dimension nouvelle, laquelle suppose une connaissance remarquable de la tradition Vaudou qui n’a pu être livrée que par Jeanne elle-même.
L’homme obi est un maître prédicteur, prescripteur et guérisseur du Vaudou ; mais s’il est « le Faust des savanes » c’est qu’il doit se conformer à un rituel précis pour convoquer et révoquer l’esprit obi doté de ces puissances, faute de quoi il périra.
Faust est une sorte d’homme /obi qui, parce qu’il ne s’est pas conformé aux prescriptions religieuses, le paiera par une damnation éternelle.
Et l’esprit diabolique qui entraîne le poète dans la damnation, c’est Jeanne, à la fois sorcière et déité.
Après ce noir tableau, le second quatrain est celui de ce qu’on pourrait nommer « l’amour malgré tout ».
D’abord un vers quelque peu obscur :
« Je préfère au Constance, à l’opium, au Nuits ». Ce sont les artifices qui soutiennent le courage : « le Constance », vin muscat d’Afrique du Sud ; l’opium, puissant analgésique mais abrutissant, ainsi que Baudelaire en avait fait l’expérience ; le Nuits : entendre Nuits-Saint-Georges, l’un des meilleurs Bourgogne.
_________________ 77 Du grec ὕβρις, nom féminin : excès, démesure.
Et puis cet aveu que les baisers de Jeanne – ou plutôt ceux qu’il cueille inlassablement sur ses lèvres – le guérissent de tout.
Le dernier vers – « Tes yeux sont la citerne où boivent mes ennuis.» – ne doit donc pas être entendu comme « ton regard séducteur est la source de tous mes ennuis » mais signifiant, au contraire, « comme le bon vin, tes beaux yeux me soulagent pendant quelques heures de mes ennuis ».
Soulagement, par nature, seulement temporaire. Les deux dernier tercets nous plongent dans le Hadès, et ceci sans rémission.
Proserpine, du moins, avait obtenu de son sévère époux, Pluton, qu’il lui permette de revenir chaque année à la surface de la Terre pour donner naissance à la belle saison.
Ceci dit, elle passait l’autre moitié de l’année à l’entière disposition dudit époux. « Je ne suis pas Proserpine » signifie donc : la moitié du temps, c’est déjà beaucoup trop. On retrouve donc ici l’insatiable Messaline.
L’allusion précédente est plus difficile à déchiffrer. En fait le Styx, fleuve des enfers, était l’un des dix bras d’Océanide, dont les neuf autres embrassaient la Terre. Baudelaire se saisit de cette partie du récit d’Hésiode dans sa Théogonie pour signifier élégamment à l’insatiable Jeanne qu’elle épuise littéralement son amant.
Cet érotisme débridé, auquel son corps au moins consent, constitue aussi pour Baudelaire, comme on le verra, un sujet de réflexion.
g) Avec ses vêtements ondoyants et nacrés
Sonnet, agencé comme une fable. Il constitue une parfaite description de l’allure de Jeanne, déesse inaccessible, insensible, indifférente, de la froideur des statues.
Il s’achève sur la délicate mention de sa stérilité. Jeanne ayant enfanté, Jeanne devenue mère, ça aurait peut-être tout changé, en eux et entre eux.
h) Le serpent qui danse
Ce poème que nous avions déjà évoqué, fait partie de la même veine que le précédent. Il s’agit de saisir Jeanne en son essence, à la fois royale et animale.
Comme le reste des poèmes qui composent ce cycle – à deux exceptions près – celui-ci porte une des multiples formes de l’ambivalence qui s’attache pour Baudelaire à la femme à la fois aimée et détestée.
i) Une charogne
Celui-ci est le poème d’après la rupture. Ceci se marque d’abord aux interpellations et notations qui le ponctuent : « rappelez-vous », « vous crûtes », « nous regardait », « vous serez », « vous, mon ange », « vous irez ».
Bref, les amants ne se parlent plus.
Ensuite, avec une virtuosité incomparable – c’est là, incontestablement, l’un des plus grands poèmes de Baudelaire 78 – il fait « jouer », comme avec un instrument de musique, le champ sémantique de certains termes :
= « une charogne », c’est à la fois la désignation de ce cadavre découvert avec horreur lors d’une promenade, et l’insulte qu’il adresse secrètement à cette femme qu’il aime tant et à laquelle il a tout sacrifié. Écho plus explicite encore avec « vous serez semblable à cette ordure ».
= « de mes amours décomposés » : vous, ma muse et ma Vénus – qui, inévitablement, entrerez en décomposition – par votre départ, vous avez arraché les liens qui nous unissaient. Et je vous aimais – et vous aime encore – de multiples façons.
Enfin, dans le troisième vers du dernier quatrain – « Que j’ai gardé la forme et l’essence divine » – est signifié à la fois le dernier geste d’amour de Charles pour Jeanne – faire que son souvenir survive – et la tâche première de la poésie : s’emparer de l’essence des êtres et des choses.
Et c’est bien par ces vers qu’il nous fait parvenir le fantôme de Jeanne.
_______________ 78 C’est par ce poème que j’ai fait la connaissance de Baudelaire, chez mon oncle et ma tante. J’ai feuilleté « Les Fleurs » ; ces vers-là m’ont arrêtée avant de me subjuguer ; Je devais avoir 13 ou 14 ans.
j) De profundis clamavi
Le premier vers – « J’implore ta pitié, Toi, l’unique que j’aime, » – ramasse tout le sens de ce sonnet. Poète inconsolable du départ de la femme aimée, départ qui l’a fait descendre au tombeau.
De là le titre : « Des profondeurs j’ai crié ».
Le latin est la langue rituelle des célébrations catholiques et donc, celle des enterrements, supplication que l’on retrouve dans les cantiques, par exemple « Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur !».
Le reste fait part d’un abyssal ennui. Le pays qu’habite désormais l’âme du poète est dépourvu de toute forme de vie, pire que « la terre polaire ». La source constante d’inspiration a disparu et il n’aspire plus qu’à « un sommeil stupide ». Bref, vivre n’a plus de sens.
k) Le vampire
Nouvelle étape de cette descente aux enfers. Elle est double et pour la restituer, il faut inverser la lecture. D’abord entendre la 4° strophe :
J’ai prié le glaive rapide De conquérir ma liberté,
Et j’ai dit au poison perfide De secourir ma lâcheté.
Donc une tentative de suicide ; comme il n’a pas eu la force de surmonter la douleur du couteau, Baudelaire se rabat sur le poison ; sans plus de succès.
Mais du coup cette agressivité, d’abord dirigée contre soi, se retourne contre sa source : Jeanne l’ingrate qui, comme un vampire, a pris de lui tout ce qu’elle pouvait avant de l’abandonner à moitié mort.
Et cette strophe pivot peut aussi se lire comme le projet d’un meurtre.
De là deux étapes encore qui apparaissent dans les vers suivants :
Infâme à qui je suis lié Comme le forçat à la chaîne, Comme au jeu le joueur têtu, Comme à la bouteille l’ivrogne, Comme aux vermines la charogne, – Maudite, maudite sois-tu !
Donc, la dépendance, déclinée sous toutes ses formes – et nous savons qu’elle était à la fois érotique et spirituelle ; et puis la malédiction.
Mais, celle-ci à peine prononcée, le forçat de l’amour regrette que cette dépendance l’ait conduit au projet du meurtre. Les derniers mots du poème reviennent aux personnifications du glaive et du poison :
Imbécile ! – de son empire Si nos efforts te délivraient, Tes baisers ressusciteraient Le cadavre de ton vampire !
En substance : tu l’aimes trop encore pour porter sur elle une main meurtrière.
l) Une nuit que j’étais près d’une affreuse juive
Nous nous sommes déjà référé à ce poème au début du cours à propos de Sarah la louchette. De facto il déploie tout ce qu’était l’amour de Baudelaire pour Jeanne Duval.
Il suffit donc ici de le replacer dans leurs parcours respectifs : Charles sacrifie à Éros par l’entremise d’une prostituée, Sarah.
Mais tandis qu’il repose à son côté, le souvenir des nuits passées auprès de Jeanne ressurgit, autrement plus douces et plus exaltantes.
Alors il rêve : ils se croiseraient, il aurait envie de pleurer et il n’y aurait dans le regard qu’elle porterait alors sur lui, ni haine, ni mépris.
Et à partir de là nous comprenons que cette savante construction du cycle de Jeanne est aussi un message qu’il lui adresse, que ces poèmes aient été ou non accessibles pour elle.
Quand il les compose il les lui destine, message ou prière. C’est évidemment le cas du second tercet :
Si, quelque soir, d’un pleur obtenu sans effort Tu pouvais seulement, ô reine des cruelles ! Obscurcir la splendeur de tes froides prunelles En substance : je forme le voeu que quelque dureté de la vie réveille un soir et toi mon souvenir et qu’au moins ta pensée se tourne vers moi avec quelque douceur.
m) Remords posthume
Et comme rien de ce modeste rêve n’advient, dans le temps du moins où il compose ces poèmes, il imagine dans ce sonnet Jeanne morte, reposant dans son tombeau, en proie au remords de n’avoir pas connu l’amour.
Attention : ce ne sont pas là des figures de style. Son âme séjournera, comme c’est probable, dans les limbes de l’enfer. Et puis – qu’on se souvienne du « Qu’importe ! » du début du cycle – l’âme de Baudelaire s’y trouvant aussi, ils se retrouveront, partiront, selon Swendenborg, pour une nouvelle vie, et alors, peut-être, consentira- t-elle à l’aimer.
n) Le chat
C’est, semble-t-il, l’étape de l’apaisement. Charles console son « coeur amoureux » comme il est dit, avec ce chat docile et voluptueux, avatar de la femme aimée, ayant, comme elle, un regard « profond et froid ».
On se souvient d’une dispute à propos d’un chat entre les deux amants.
Comme il paraît qu’une fois Jeanne aurait rapporté un chien dans l’appartement, c’est le sujet de dispute le plus probable. On est chien ou chat et les deux ne font pas, habituellement, bon ménage.
En fait ce poème a été placé là en lieu et place d’un autre, censuré par Pinard et compagnie : Le Léthé.
o) Le Léthé
Ce poème-là est l’apothéose d’Éros qui ne requiert même plus le consentement des coeurs. Transport érotique qui franchit toutes les bornes et accomplit excellemment ce qu’est au fond l’orgasme : « la petite mort ».
De là cet apaisement des corps, des coeurs et des âmes.
Fleuve de l’oubli dans le royaume de Hadès, le Léthé libérait les ombres qui
buvaient de son eau, de tous les souvenirs de leur vie antérieure, préludant ainsi à leur réincarnation « sous les feux du soleil », pour reprendre l’expression homérique.
C’est « le tigre adoré » qu’est Jeanne qui commande à la fois la mise à mort
« somatique » de son amant et la transfiguration de la maîtresse en chat dans le poème de remplacement.
Là encore, comme dans « Les bijoux », Baudelaire suggère avec une habileté inégalable, les audaces et la complexité de ce rapport sexuel, en particulier dans les deux derniers quatrains :
À mon destin, désormais mon délice, J’obéirai comme un prédestiné ; Martyr docile, innocent condamné, Dont la ferveur attise le supplice,
« supplice », « martyr » sont ici un peu plus que des métaphores.
Baudelaire a toujours été fasciné par cette parenté entre les signes de la douleur et ceux de l’acmé de la jouissance. Comme il est, ici aussi, avide du sens, il se questionne sans doute sur la nature de cette alchimie entre souffrance et jouissance : est-elle divine ou diabolique ?
Je sucerai, pour noyer ma rancœur,
Le népenthès et la bonne cigüe
Aux bouts charmants de cette gorge aigüe Qui n’a jamais emprisonné de cœur.
Le début du premier vers a dû donner des sueurs froides à Ernest Pinard…
En fait c’est plus innocent qu’on ne l’aurait cru et, du coup, moins compatible avec le quatrain précédent.
N.B. : « gorge » est ici la métonymie 79 tolérable des seins.
Quant au népenthès, il appartient lui aussi au champ sémantique de l’Antiquité. C’est la boisson que Paris offrit à Hélène pour lui faire oublier les circonstances dramatiques de son enlèvement.
____________________ 79 Figure par laquelle on exprime un concept au moyen d’un terme désignant un autre concept qui lui est uni par une relation nécessaire (cause et effet, inclusion, ressemblance, etc.).
Étymologiquement : né : non ; penthès : tristesse, chagrin. Ceci dit, c’est une plante carnivore qui a hérité ce nom.
Enfin « bonne cigüe » est la métaphore de la « petite mort » orgastique, celle dont on revient, sauf imprévisible accident 80.
Un poème intitulé « Duellum » – Le duel – avait été inséré dans la version censurée pour remplacer « Les bijoux ».
Il paraît d’abord relater une violente dispute entre « deux guerriers », comme il est dit. En fait c’est une autre transposition d’un rapport érotique, cette fois clairement orageux.
De ces trois versions des rapports intimes entre Charles et Jeanne, finit par émerger, comme dans le tableau de Delacroix, le visage de leur irréparable dissension.
Schématiquement, il la comble de bienfaits. Sans le dire il exige donc implicitement qu’elle cède à ses avances.
Seulement elle ne l’aime pas – comme il est dit de « sa gorge » dans le dernier vers du poème précédent : « Qui n’a jamais emprisonné de cœur. ».
Et puis elle n’est pas une prostituée qui devrait consentir par nécessité.
De là, sans doute, à nouveau, une violente dispute. On trouve la trace de la précédente, quatre ans plus tôt, dans une lettre de Charles à sa mère :
« J’ai des larmes de honte et de rage dans les yeux en t’écrivant ceci ; et en vérité je suis enchanté qu’il n’y ait aucune arme chez moi ; je pense aux cas où il m’est impossible d’obéir à la raison et à la terrible nuit où je lui ai ouvert la tête avec une console. 81 »
Les deux amants s’étaient alors rabibochés. Mais cette fois la rupture paraît définitive.
______________ 80 comme celui qui mit fin aux jours de Félix Faure, mort auprès de sa maîtresse Meg, « d’avoir trop sacrifié à Vénus » écrivit Le Journal du Peuple. 81 Lettre du 27 mars 1852.
p) Le balcon
Une fois sa souffrance apaisée, ce sont quelques souvenirs heureux de cette relation essentielle qui émergent dans l’esprit de Baudelaire. Premiers vers de ce poème de la nostalgie :
Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses,
Ô toi, tous mes plaisirs ! ô toi, tous mes devoirs ! Tu te rappelleras la beauté des caresses,
La douceur du foyer et le charme des soirs,
Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses !
Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon,
Et les soirs au balcon, voilés de vapeurs roses.
Que ton sein m’était doux ! que ton cœur m’était bon !
On entend ici les notes de l’irrémédiable en même temps que la douceur des souvenirs. Comme il est dit ensuite :
Je sais l’art d’évoquer les minutes heureuses !
C’est ce qui ouvre au dernier poème du cycle. Pourtant l’espoir n’est pas complètement anéanti :
Ces serments, ces parfums, ces baisers infinis, Renaîtront-ils d’un gouffre interdit à nos sondes, Comme montent au ciel les soleils rajeunis Après s’être lavés au fond des mers profondes ? – Ô serments ! ô parfums ! ô baisers infinis !
On aura compris, grâce à la métaphore magistrale du soleil réapparaissant à l’horizon, après passage à travers « un gouffre interdit à nos sondes », qu’il s’agit ici de la vision swederborgienne du monde.
Alors, dans une autre vie, peut-être…
Mais celle-ci n’est pas encore achevée. Voyons ce dernier poème du cycle.
q) Je te donne ces vers
C’est peut-être le plus émouvant, l’ultime cadeau de Baudelaire à sa maîtresse, du moins dans son esprit, au moment où il écrit ces vers.
Premier avril 2022 ; qui, aujourd’hui se souviendrait de Jeanne Duval, s’il n’y avait pas eu son ténébreux amant ?
Personne, sans doute.
On objectera que ça lui fait une belle jambe, à la maîtresse. Mais, sauf à croire à l’au-delà, infernal ou paradisiaque, c’est la seule forme de survie qui nous soit octroyée : par les oeuvres, qu’on en soit l’auteur ou l’objet.
Enfin il ne semble pas que nous soyons taillés pour l’immortalité. D’ailleurs peut-on seulement concevoir quelque chose comme la félicité éternelle ?
Ceci dit, contrairement à ce qu’en croit Charles quand il compose ce poème, il n’en a pas fini avec Jeanne. Mais, pour le moment, fin du cycle.
Je fais le pari que le reste du recueil était édifié avec la même rigueur, dès sa version première (1857), et que cette exigence s’est maintenue par la suite, en dépit de la censure.
III Le reste de l’édifice
1) L’entrée et la sortie
C’est manifestement le cas pour l’incipit et l’excipit 82., si du moins l’on omet – pour le moment – le poème à la fois préface et dédicace, intitulé « Au lecteur ».
=> Les deux premiers poèmes des Fleurs sont relatifs à la naissance du poète, naissance à la fois réelle et symbolique.
=> La dernière partie est intitulée « La mort » ; elle y est déclinée de toutes les façons possibles, en un ensemble lui-même composite :
= Cinq poèmes ordonnés thématiquement
= Un long ensemble de huit pièces (ou sept, le poème estampillé « V » ne comportant qu’un hémistiche), ensemble intitulé « Le voyage » et dédié à Maxime Du Camp que nous avons déjà rencontré, il y a 10 ans, à l’occasion de l’étude de Flaubert, comme son compagnon de voyage, justement.
____________ 82 Respectivement, premiers et derniers termes d’un texte.
a) Les deux premiers poèmes
Ici une première parenthèse sur les relations complexe entre Charles Baudelaire et Maxime Du Camp. Le second a consacré au premier quelques pages mémorables de ses « Souvenirs littéraires ».
Ça commence en 1850 alors que Charles et Maxime – qui ont cette année-là moins de 30 ans – ne se connaissent pas encore. Maxime et son ami Gustave, lors de leur périple en Orient, sont invités par l’ambassadeur de France à Constantinople… un certain général Aupick.
Celui-ci s’enquiert des nouveautés littéraires à Paris.
Du Camp cite Murger, auteur dramatique, puis un certain Baudelaire dont Louis de Cormenin – qui l’a rencontré – lui a fait, par lettre, le plus grand éloge.
Récit de la suite de la scène :
« Dès que j’eus prononcé le nom de Baudelaire, Mme Aupick baissa la tête, le général me regarda fixement comme s’il eût relevé une provocation, et le colonel Margadel me toucha le pied pour m’avertir que je m’aventurais sur un mauvais terrain.
Je demeurai assez penaud, comprenant que j’avais commis une maladresse, et ne sachant laquelle. Dix minutes après, le général et Flaubert se disputaient à propos de je ne sais quel livre de Proudhon.
Mme Aupick se rapprocha de moi et, à voix très basse, me dit :
– N’est-ce pas qu’il a du talent ?
– Qui donc?
– Mais le jeune homme que M. Louis de Cormenin vous a cité avec éloges ?
Je fis un signe affirmatif sans répondre, car je comprenais de moins en moins. »
Cette admiration maternelle, Baudelaire ne l’apprendra, selon toute vraisemblance, que lorsque Maxime du Camp lui en fera le récit.
Dans le premier poème de l’incipit, intitulé « Bénédiction », voici comment il imagine ce qu’il en est d’enfanter un poète :
Lorsque, par un décret des puissances suprêmes, Le Poète apparaît en ce monde ennuyé,
Sa mère épouvantée et pleine de blasphèmes Crispe ses poings vers Dieu, qui la prend en pitié :
– « Ah ! que n’ai-je mis bas tout un nœud de vipères, Plutôt que de nourrir cette dérision !
Maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères
Où mon ventre a conçu mon expiation !
Pourtant, dans cette négativité des premières strophes, une discrète notation affaiblit quelque peu le trait ; c’est le premier vers de la strophe suivante ; la malheureuse mère s’adresse toujours à Dieu :
Puisque tu m’as choisie entre toutes les femmes
Comme la Sainte Vierge, en somme, destinée à mettre Jésus Christ au monde, afin que celui-ci puisse sauver l’humanité.
La suite est toute empreinte de ce dessein divin, en particulier l’évocation de l’ange et de l’esprit qui prennent le poète enfant sous leur protection. Il n’est pas interdit d’y voir une double transfiguration, celle de Mariette et de Joseph Baudelaire, son père.
Et puis nous retrouvons cette foi ingénue dans la survie des chers disparus dont le jeune garçon cherche les messages dans les beautés de la nature :
Pourtant, sous la tutelle invisible d’un Ange, L’Enfant déshérité s’enivre de soleil,
Et dans tout ce qu’il boit et dans tout ce qu’il mange Retrouve l’ambroisie et le nectar vermeil.
Il joue avec le vent, cause avec le nuage,
Et s’enivre en chantant du chemin de la croix ; Et l’Esprit qui le suit dans son pèlerinage Pleure de le voir gai comme un oiseau des bois.
Les quatre strophes qui suivent sont manifestement une évocation de Jeanne Duval, par le moyen de la prosopopée 83. Ceci laisse à penser que ce long poème a été composé au dernier moment, la rupture datant de 1856, l’année précédant la première édition.
Citons-en deux :
Et je me soûlerai de nard, d’encens, de myrrhe, De génuflexions, de viandes et de vins,
Pour savoir si je puis dans un cœur qui m’admire Usurper en riant les hommages divins !
Comme un tout jeune oiseau qui tremble et qui palpite, J’arracherai ce cœur tout rouge de son sein,
Et, pour rassasier ma bête favorite,
Je le lui jetterai par terre avec dédain !
____________ 83 Figure de rhétorique par laquelle on fait parler et agir une personne que l’on évoque (absent, défunt, animal ou chose personnifiée).
Enfin les strophes suivantes sont une véritable profession de foi.
Nous y retrouvons cette intuition paradoxale que le mal, par l’intermédiaire de la souffrance qu’il cause, est aussi la source de la création poétique et, par conséquent, le principe de la transfiguration du réel.
Lisons-les, une fois encore, comme une invitation à comprendre la nature véritable de l’âme de Baudelaire, en nous demandant pourquoi elles n’ont pas arrêté les juges du tribunal correctionnel :
Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance Comme un divin remède à nos impuretés,
Et comme la meilleure et la plus pure essence Qui prépare les forts aux saintes voluptés !
Je sais que vous gardez une place au Poète Dans les rangs bienheureux des saintes Légions, Et que vous l’invitez à l’éternelle fête
Des Trônes, des Vertus, des Dominations.
Ces catégories sont celles de la hiérarchie angélique selon la Kabbale.
Or Swedenborg fut un lecteur scrupuleux de la Kabbale. C’est sans doute par son truchement que Baudelaire a pu s’y intéresser. Et puis, une fois encore, dans la mesure où le soleil et les nuages ont pu, par l’apparition fugitive de la beauté, apporter une consolation à ses chagrins d’enfant, il ne cessera jamais de croire que l’âme de Mariette et celle de son père l’attendent dans les limbes célestes.
Nous avons déjà évoqué le second poème introductif ; il s’agit de l’Albatros. Cette dévotion à la quête de l’essence des choses qui porte l’âme du poète à tenter sans cesse de s’élever vers le ciel, c’est précisément ce qui le rend si maladroit dans son commerce avec les autres hommes, incapable d’aller comme ils vont ; dit poétiquement, « empêché de marcher ».
Voyons maintenant comment s’achève ce temple poétique.
b) A Maxime du Camp
Il faut revenir, pour le comprendre, à ce qu’ont pu être les rapports entre les deux hommes. Seconde parenthèse, donc.
Celui qui fut aussi le compagnon de voyage de Flaubert partage avec celui-ci la franchise et la truculence. Ça n’est évidemment pas le cas de Baudelaire, d’abord tout entier enfermé dans cette exigence de l’apparence qui marque le dandy.
Un épisode significatif relaté par Du Camp : « Longtemps après notre première entrevue, un dimanche, qui est le jour où mes amis veulent bien venir me voir, il entra chez moi avec les cheveux teints en vert.
Je fis semblant de ne pas le remarquer. Il se plaçait devant la glace, se contemplait, se passait la main sur la tête et s’évertuait à attirer les regards. N’y tenant plus, il me dit : « – Vous ne trouvez rien d’anormal en moi ? – Mais non. – Cependant j’ai des cheveux verts, et ça n’est pas commun. » Je répliquai : « Tout le monde a des cheveux plus ou moins verts ; si les vôtres étaient bleu de ciel, ça pourrait me surprendre ; mais des cheveux verts, il y en a sous bien des chapeaux à Paris.»
Presque immédiatement il s’en alla et, rencontrant un de mes amis dans la cour, il lui dit : « Je ne vous engage pas à entrer chez Du Camp ; il est aujourd’hui d’une humeur massacrante. » »
La première fois où Baudelaire s’invite chez Maxime du Camp, il est fort discourtois. Après avoir déclaré qu’il avait soif, puis refusé successivement de la bière, du thé et un grog, il consent à se faire offrir du vin. Son hôte lui demande s’il veut du Bordeaux ou du Bourgogne.
Non seulement il veut les deux mais encore il exige qu’on ôte de la table la carafe d’eau dont la vue le dérange. Et pour finir, en une heure et à grandes lampées, il vide les deux bouteilles.
Après une telle expérience, n’importe qui l’aurait définitivement pris en grippe, quels que soient par ailleurs ses mérites. Pas Maxime du Camp. Sans doute celui-ci commence-t-il par lui faire le récit de l’épisode de Constantinople. Et du coup Baudelaire renonce à jouer la comédie et lui fait des confidences.
C’est ainsi que nous apprenons que le voyage dans les mers du sud s’enchaîne immédiatement à une violente dispute entre Charles et son beau-père.
Dîner rassemblant des sommités à la table d’Aupick, alors colonel.
Charles, âgé de 17 ans, fait une mauvaise blague. Semonce du beau-père ; l’adolescent se lève et déclare qu’il va l’étrangler. Aupick se lève à son tour, et le plaque au sol ; Charles fait un malaise.
Des domestiques le transportent dans sa chambre avec ordre de l’y enfermer.
Il y restera deux semaines avant d’être transporté à Bordeaux et embarqué sur le Paquebot des Mers du Sud.
Comme le poète semble avoir renoncé à toute théâtralité avec cet ami-là, il lui confie encore, à propos de cet épisode de sa jeunesse, que sa mère lui envoyait régulièrement de l’argent.
Ce privilège de Maxime du Camp trouve sa source en deux circonstances :
=> Il est sensible à la beauté des poèmes de Baudelaire.
=> Il lui prête de l’argent quand il en a besoin, ce dont – autre trait d’une certaine élévation de caractère – il ne dira rien dans les pages qu’il lui consacre dans ses « Souvenirs littéraires ».
Evidemment il n’est pas toujours très attentif à ce que Baudelaire lui raconte de son existence ; il semble avoir confondu la belle Dorothée et la sulfureuse Jeanne Duval.
Mais il faut croire que ce qui, dans ces échanges, les passionne l’un et l’autre, ce sont d’une part les souvenirs de leur périple respectif, d’autre part les questions métaphysiques. Maxime est probablement un mécréant.
Voilà peut-être pourquoi Charles lui fait don, au terme de cet imposant ensemble qui achève le recueil et de sa dernière partie qui décline la mort de toutes les façons possibles, de ce poème métaphoriquement intitulé « Le voyage ».
Tentons d’aller à l’essentiel de cette longue composition, la dernière du recueil initial, et qui comporte donc 8 pièces poétiques, dont l’une, rappelons-le, n’est faite que d’un hémistiche.
1° Maxime fut un voyageur par vocation, Charles par contrainte ; le premier poème, de façon très élaborée, enchaîne tous les motifs qu’il y eut, pour les uns ou les autres, de partir en voyage : un rêve d’enfant, comme ce fut probablement le cas de Maxime, la suite d’une blessure, comme ce fut le cas de Charles.
Motifs contradictoires mais que le poète enchaîne dans le deuxième quatrain, comme si, symboliquement, son dédicataire et lui-même embarquaient ensemble :
Un matin nous partons le cerveau plein de flamme Le coeur gros de rancune et de désirs amers
Les vers suivants font lentement émerger un autre motif : le chagrin d’amour. Et comme notre poète a sans doute eu la tentation d’en finir par un breuvage empoisonné, lors des moments les plus sombres de sa relation avec Jeanne Duval, il invoque alors, par la métaphore qui la désigne de façon irréfutable, « la Circé tyrannique ».
Il puise une seconde fois dans sa vie intérieure pour exhumer un quatrième motif – que l’on pourrait désigner comme la quête du signe – motif dissimulé d’abord sous les atours du « vrai voyageur », lequel, prétendument ne partirait que pour partir. De là cet obscur quatrain dont le sens n’est accessible que via la sensibilité swedenborgienne de l’auteur :
Ceux-là dont les désirs ont la forme des nues, Et qui rêvent, ainsi qu’un conscrit le canon, De vastes voluptés, changeantes, inconnues, Et dont l’esprit humain n’a jamais su le nom !
2° Le deuxième poème est celui du dévoilement des illusions. Deux vers éloquents :
Une voix de la hune, ardente et folle, crie : « Amour… gloire… bonheur ! » Enfer ! c’est un écueil !
Les six strophes qui le composent opèrent subrepticement le glissement de l’impératif des désirs à la quête du sens. C’est d’abord la métaphore de la toupie, bientôt explicitée par les deux premier vers de la strophe suivante :
Singulière fortune où le but se déplace,
Et, n’étant nulle part, peut être n’importe où !
C’est ensuite la déconvenue que la réalité oppose au rêve. On croit apercevoir l’Eldorado ; ce n’est qu’un récif. Cette contrée mythique est l’un de ces « pays chimériques » qui empoisonnent l’âme du matelot. La question de savoir s’il faut le mettre aux fers ou le jeter à la mer implique qu’il a perdu tout contact avec l’âpre réalité.
Dans la dernière strophe ce matelot s’est transmué en vagabond et c’est bien de « brillants paradis » qu’il rêve. Mais à ce stade s’opère une sorte de transmutation de la réalité puisqu’une chandelle suffit à transformer son taudis en Capoue, autrefois ville des délices où Hannibal alla jusqu’à perdre son instinct de guerrier.
Figure implicite qui incarne le complet renversement des valeurs.
3° Les deux premiers mots du troisième poème, « Étonnants voyageurs » ont fait florès 84 puisqu’ils sont devenus le nom d’un festival annuel de littérature et de cinéma qui se tient à Saint-Malo.
S’il y a lieu de s’étonner, c’est qu’à ce stade s’est opérée ce qu’on pourrait nommer la complète dématérialisation de ce qui était initialement la quête du voyage. Il n’en reste que de chatoyants souvenirs, comme l’exprime le quatrième vers :
Ces bijoux merveilleux, faits d’astres et d’éthers.
Les bijoux se sont donc spiritualisés et ils brillent de telle manière dans le regard des voyageurs que les sédentaires, comprenant enfin qu’ils sont le seul véritable gain de ces voyages, réalisent alors qu’il n’est plus nécessaire qu’ils partent.
Il suffit que ces voyageurs leur en fassent part.
________________ 84 Obtenir des succès, de la reconnaissance.
La question qui clôt ce troisième poème – « Dites, qu’avez-vous vu ? » – est donc celle qui ouvre au quatrième poème, puis, après réitération – « Et puis, et puis encore ? », hémistiche qui fait le cinquième – au sixième.
4° Paradoxe de ces souvenirs : ce qui importe d’abord dans l’âme des matelots, c’est ce qu’ils n’ont pas vu. C’est la troisième strophe qui donne la clef :
Les plus riches cités, les plus grands paysages, Jamais ne contenaient l’attrait mystérieux
De ceux que le hasard fait avec les nuages.
Et toujours le désir nous rendait soucieux !
Ensuite, après avoir paradoxalement célébré l’arbre, ces voyageurs qui nulle part n’ont pris racines, donnent à voir le folklore demandé par l’auditoire.
5° Auditoire enfant qui en redemande, voici l’unique vers hémistiche de ce poème : Et puis, et puis encore ?
6° Alors, après avoir déploré cette immaturité – « Ô cerveaux enfantins » – le locuteur pluriel se lance par une longue tirade, dans un tableau saisissant de toutes les tares de l’humanité qui sont autant de figures du péché.
= La femme et l’homme d’abord, la première toute pleine de son narcissisme, le second, dévoré par ses insatiables appétits. Charles parlant ici de Jeanne et de lui- même en ces termes : Esclave de l’esclave et ruisseau dans l’égout ;
= Tous ceux qui infligent la souffrance ; un alexandrin : La fête qu’assaisonne et parfume le sang
= La perversion du sentiment religieux ; le vers évocateur de ce quatrain : Dans les clous et le crin cherchant la volupté ;
= Enfin les sophistes qui s’en prennent à l’essence divine : « Criant à Dieu, dans sa furibonde agonie :
« Ô mon semblable, ô mon maître, je te maudis ! »
= Résumé du dernier quatrain : ceux qui ne supportent pas cette abomination universelle se réfugient dans l’opium. No comment.
7° Le septième poème du cycle Maxime Du Camp, si l’on peut dire, paraît être l’écho des conversations qu’ils ont eu entre eux à propos des voyages. C’est singulièrement le cas du deuxième quatrain :
Faut-il partir ? rester ? Si tu peux rester, reste ; Pars, s’il le faut. L’un court, et l’autre se tapit Pour tromper l’ennemi vigilant et funeste,
Le Temps !
Je tronque le vers à dessein afin de souligner ce qui est en train d’émerger de ce périple symbolique. Voici donc la seconde colonne du malheur humain : le Temps majuscule qui passe inexorablement et nous approche de notre mort.
La première colonne, nous y viendrons bientôt ; quand on parcourt un espace symbolique d’une savante architecture, il est parfois nécessaire de faire des allers et retours ; ou des pauses.
Or voici justement que cette mort est maintenant déclinée sous les aimables couleurs par lesquelles la peignaient les Grecs et les Égyptiens d’autrefois.
= Cette « mer des ténèbres » sur laquelle il faut s’embarquer, c’est le Styx.
= Ces « voix charmantes et funèbres » qui nous guident dans le royaume de Hadès, ce sont les ombres des disparus qui y séjournent désormais. Ombre de Pylade, incarnation de l’amitié, et d’Électre, celle de la fidélité, à la fois fraternelle et conjugale. Façon de suggérer qu’une fois morts, nous retrouverons nos chers disparus, ce que Baudelaire croyait sans doute.
= Ce lotus parfumé, c’est le nénuphar bleu d’Égypte, plante symbolique de la renaissance. Chaque soir il se ferme et disparaît sous les eaux ; chaque matin il émerge et s’épanouit à nouveau. C’est pourquoi il est lié substantiellement au soleil – lequel chaque matin s’élève de l’horizon – renaissance dont il porte les couleurs : jaune de l’astre sacré et bleu du ciel.
8° C’est le dernier poème de ce cycle et il en livre le sens dès les premiers vers :
Ô Mort, vieux capitaine, il est temps ! levons l’ancre ! Ce pays nous ennuie, ô Mort ! Appareillons !
Nous comprenons alors que si le cycle en question s’intitule « Le voyage », ce n’est pas une désignation thématique ; c’est une métaphore. Ce voyage, c’est la vie.
Et plus peut-être que les voyages dont il a été question, celui-ci s’achève sur une note optimiste : la possibilité du renouvellement.
Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe ? Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau !
Relevons d’abord que le « tu » est devenu un « nous ». Pas de doute : Baudelaire, avec sa faconde habituelle, a tenté de convaincre Maxime Du Camp du bien-fondé des thèses de Swedenborg. Et comme, selon toute vraisemblance, il n’y est pas parvenu il lui lègue cette série de poèmes. C’est dans la dernière phrase du chapitre qu’il consacre à Baudelaire dans ses « Souvenirs littéraires » que l’on trouve l’unique allusion à ces débats métaphysiques ; encore est-elle très discrète :
« La mort le délivra ; il avait écrit les litanies qui convenaient à ses rêves : O Satan ! prends pitié de ma longue misère !
Il fut exaucé.»
Dernière remarque : ces vers sont les derniers mots des Fleurs du Mal. Mais pas le dernier mot, pourtant, ainsi que nous le verrons au terme de cette étude.
Malédiction de la naissance du poète puis mort déclinée de toutes les façons possibles avant de devenir pour lui une aspiration…
Sous cette structure maîtresse, l’architecture du reste du recueil est tout aussi élaborée. Albert de la Fuzelière, éditeur, aurait déclaré que cette organisation poétique était « prodigieusement exceptionnelle » ; on devra en convenir.
2) Deux autres cycles amoureux
Comme l’amour est sa source la plus constante de son inspiration, c’est aux deux muses qui suivent Jeanne dans le courant de sa vie qu’il faut demander à Baudelaire l’accès aux deux chapelles suivantes.
Néanmoins on peut déroger à l’ordre de ces cycles dans la mesure où les deux muses que furent pour Baudelaire Marie Daubrun et Apollonie Sabatier s’entrecroisent et n’occupent pas dans sa vie des places comparables.
a) Le cycle Marie Daubrun
Le théâtre est ce lieu où, pour peu qu’une comédienne vous plaise, vous êtes condamné à la contempler dans toutes les postures possibles, à l’entendre moduler toutes les intonations de sa voix, ceci dans une immobilité et un silence contraints ; bref, le plus sûr moyen de tomber amoureux.
Août 1847. Baudelaire est au Théâtre de La-Porte-Saint-Martin où l’on donne « La belle aux cheveux d’or 85». Marie Daubrun, de son nom de scène 86, interprète le rôle titre. Elle est belle, comme on le sait, puisqu’elle n’est pas débutante. Mais dans ce rôle-là elle joue divinement bien. Succès considérable : 150 représentations.
Dans les intermittences plus ou moins douloureuses de sa relation avec Jeanne, cet amour clandestin va trouver place, d’autant plus aisément qu’il est d’abord d’une nature complètement différente.
En fait, ça commence par une bonne blague. On ne sait si Charles l’a préméditée et on ignore jusqu’à quel point Marie est complice. Toujours est-il qu’après l’échec de la révolution de 1848 puis celui de son journal, « Le salut public », Baudelaire se fait d’abord embaucher à « La Tribune nationale ». Mais ce quotidien républicain fera, lui aussi, faillite avant la fin de l’année.
Là-dessus il apprend qu’un journal de province, « Journal de l’Indre », cherche en vain un rédacteur en chef. Le siège est à Châteauroux ; le voyage est payé et un banquet est offert à l’impétrant et à sa famille 87.
Marie Daubrun n’a plus de rôle (150 représentations, à raison d’un jour de relâche par semaine et d’un congé d’une semaine tous les deux mois, ça ne fait jamais que 7 mois). Charles Baudelaire l’embauche comme actrice pour jouer son épouse.
C’est du moins le plus probable. Une fois sur place, lors du banquet promis, il découvre avec horreur qu’il siège au milieu d’une assemblée de royalistes.
Ça se confirme au moment des discours post prandium 88 : les hôtes commencent par condamner les révolutionnaires de 1848 et puis, carrément, ceux de 1789.
Du coup quand Baudelaire prend la parole et il célèbre…Robespierre.
On avait sans doute beaucoup bu et les employeurs potentiels ont pu croire à une plaisanterie.
_______________ 85 Pièce de Marie-Catherine d’Aulnoy (1651-1705) 86 Marie Brunaud, pour l’état civil. Parfait anagramme, donc véridique, avec juste ce qu’il faut de noblesse. 87 D’après un article intitulé « Charles Baudelaire, éphémère rédacteur en chef », paru dans « La Nouvelle République » le 12/08/2021. 88 d’après repas
Ils déchantent dès le lendemain. Premier article du brillant rédacteur pour le Journal de l’Indre : « Lorsque Marat, cet homme doux, et Robespierre, cet homme propre, demandaient, celui-là, 300.000 têtes, celui-ci, la permanence de la guillotine, ils obéissaient à l’inéluctable logique de leur système. »
Le sieur Baudelaire est licencié illico. Il n’y a plus qu’à remonter avec Marie dans la diligence pour Paris. Il a eu largement le temps de lui tourner quelques compliments mais les choses en sont alors restées là.
Dernier point sur l’excursion à Châteauroux : quand les castelroussins sont devenus républicains ils ont baptisé l’une de leurs allées « Charles Baudelaire » ; sans doute pour se faire pardonner. Ce n’est pas si courant et il faut saluer l’initiative. Saint-Memmi et Saint-Denis de la réunion ont également créé une allée Baudelaire ; et puis trois ou quatre rues, ici ou là, dont une à Paris.
Il semble que notre poète ne soit pas encore sorti du purgatoire, toujours prisonnier de l’image sulfureuse et incomplète que l’on s’est faite de lui…
Mais revenons à ses amours.
Ce clivage entre la sombre et cruelle Jeanne et la lumineuse et angélique Marie est sensible dès son apparition sous la plume de Baudelaire. Voici les deux dernières strophes du poème intitulé « L’irréparable » :
– J’ai vu parfois, au fond d’un théâtre banal Qu’enflammait l’orchestre sonore,
Une fée allumer dans un ciel infernal
Une miraculeuse aurore ;
J’ai vu parfois au fond d’un théâtre banal Un être, qui n’était que lumière, or et gaze, Terrasser l’énorme Satan ;
Mais mon coeur, que jamais ne visite l’extase, Est un théâtre où l’on attend Toujours, toujours en vain, l’Être aux ailes de gaze !
Je forme l’hypothèse que cet « irréparable », c’est précisément d’être arrivé à ses fins avec Marie – laquelle d’abord se refusa à lui – et d’avoir perdu du coup l’être angélique qui l’avait d’abord subjugué.
Toujours est-il que la lumineuse Marie aux yeux clairs et à l’heureux caractère vient en contrepoint de la sombre Jeanne, d’allure et d’humeur.
Rappelons les dates : la relation avec Jeanne fut continue jusqu’en septembre 1856. La relation avec Marie Daubrun a commencé en 1848 mais, pour l’essentiel, elle est restée chaste et amicale pendant plusieurs années. Baudelaire, amoureux, conservait un souvenir ému de sa première apparition.
Les « ailes de gaze » mentionnées dans la dernière strophe de ce poème sont corrélées à sa première apparition aux yeux de Baudelaire en 1845. Elle a alors 17 ans et se produit dans un ballet intitulé « Les fleurs animées ».
Pour ce qui est du cycle Marie Daubrun, une interprétation large le fait aller du poème numéroté « XLVIII » (89) au poème numéroté « LVIII » (90). Mais il n’est pas exclusivement constitué de poèmes qui évoquent à coup sûr cette figure essentielle quoique transitoire du parcours de Baudelaire, du moins dans les faits.
Au préalable, afin de bien saisir la nature de cette relation, c’est à une lettre non datée qu’il faut faire appel. L’extrait capital :
« Un homme qui dit : « Je vous aime », et qui prie, et une femme qui répond : « Vous aimer ? Moi ! jamais ! Un seul a mon amour, malheur à celui qui viendrait après lui ; il n’obtiendrait que mon indifférence et mon mépris. »
Et ce même homme, pour avoir le plaisir de regarder plus longtemps dans vos yeux, vous laisse lui parler d’un autre, ne parler que de lui, ne vous enflammer que pour lui et en pensant à lui. »
Scène clef, évidemment. Il a dû commencer par lui envoyer des poèmes, on ne sait trop lesquels – peut-être un éloge de l’amour – en arguant qu’elle était devenue sa muse. Ensuite il obtient de la rencontrer en privé. C’est peut-être à cette occasion que, pleine de confiance, elle lui fait cette confidence : elle est amoureuse et d’un homme merveilleux ; version soft.
Version hard : il tente de porter la main sur elle, pour la seconde fois, et elle le repousse avec la dernière énergie.
Comme il s’efforce de rattraper les choses en protestant de son amour, elle ne lui laisse aucune chance et aucune illusion. Elle en aime un autre, irrévocablement, s’enflamme et se lance dans l’apologie de cet homme inégalable. L’amoureux éconduit, simplement pour avoir le plaisir de l’entendre et de la contempler, la laisse dire. C’est aussi qu’il ne renonce pas.
Cette lettre essentielle nous révèle plusieurs autres moments clefs de cette relation : => Cette certitude d’abord qui émerge à plusieurs reprises dans ces lignes fiévreuses : il est follement amoureux de Marie. Citation : « Je vous aime, Marie, c’est indéniable »
En outre cette lettre permet d’exhumer plusieurs épisodes de cette relation finalement assez orageuse. Dans l’ordre de l’écriture :
=> Marie ne veut plus revoir Charles
=> Elle se faisait peindre par on ne sait quel artiste mais a dû renoncer à poser avant que le portrait ne soit achevé parce que cet amoureux importun assistait à toutes les séances.
=> Le jeudi précédent il est venu chez elle plaider sa cause dans ce qu’il désigne lui- même comme une « longue conversation », laquelle, pour le coup, a dû être insupportable à Marie.
=> Il lui a alors déclaré qu’il de « contenterait de miettes », en d’autres termes qu’il accepterait d’être l’amant en second. Marie en a été indignée.
=> Elle le met à la porte, définitivement.
Lettre qui est donc aussi un plaidoyer pour la défense : il s’agit de convaincre Marie qu’elle est devenue pour Charles, citation : « (non) plus simplement une femme que l’on désire, mais une femme que l’on aime ».
Comme elle ne veut plus qu’il l’approche, il choisit, de façon plus ou moins délibérée – et donc plus ou moins sincère – de transformer Éros en Agapé, pour reprendre la distinction ultérieurement établie par Anders Nygren 89 , l’amour corporel, si l’on veut, par l’amour divin.
Faute de pouvoir s’unir à elle, Charles fera désormais de Marie un objet de culte, une déesse, une madone.
Et cette lettre est, d’un bout à l’autre, ponctuée de notations de cet ordre :
=> « mon parti est pris de me donner à vous, pour toujours. »
=> « (…) vous êtes pour moi un objet de culte, et il m’est impossible de vous souiller (…) »
=> « (…) vos yeux, qui ne peuvent inspirer au poète qu’un amour immortel (…) » => « (…) vous êtes une adorable créature (…) C’est un sentiment vertueux qui me lie à jamais à vous. »
=> « (…) l’amour que je ressens pour vous, c’est celui du chrétien pour son Dieu (…) »
Emporté par son élan, Baudelaire en rajoute : « (…) aussi ne donnez jamais un nom terrestre, et si souvent honteux, à ce culte incorporel et mystérieux, à cette suave et chaste attraction qui unit mon âme à la vôtre, en dépit de votre volonté. Ce serait un sacrilège.
J’étais mort, vous m’avez fait renaître. Oh ! vous ne savez pas tout ce que je vous dois ! J’ai puisé dans votre regard d’ange des joies ignorées ; vos yeux m’ont initié au bonheur de l’âme, dans tout ce qu’il a de plus parfait, de plus délicat. »
Indication essentielle puisqu’elle permet enfin de mettre en rapport avec précision ce terme de leur relation et le cycle poétique dans lequel Baudelaire l’a transposée.
Last but not least : ce rival heureux qui supplante sans difficulté Baudelaire dans le coeur de Mademoiselle Daubrun est… Théodore de Banville. Trois ans plus tard, quand la ville de Nice sera rattachée à la France Marie sera engagée par l’un de ses théâtres et Théodore l’y suivra.
89 Théologien suédois (1890-1978)
Pour résumer brièvement les rapports extra-littéraires entre ces deux-là : = Baudelaire séduit d’abord Jeanne sur les instances de la maîtresse en titre de Théodore.
= Jeanne devient la maîtresse en titre de Charles.
= Charles tombe amoureux de Marie
= C’est Théodore qu’aime Marie, et réciproquement puisqu’il la suivra à Nice.
Au fond c’est un peu l’équivalent, mutatis mutandis, de l’erreur de l’éditeur qui, alors qu’ils font leurs premières armes en poésie, envoie à l’un les épreuves à corriger de l’autre et réciproquement.
Entrons brièvement dans le cycle Marie Daubrun.
α Le flacon
Ce premier poème semble être le signe d’une double réminiscence. D’une part il y a effectivement cette expérience quasi universelle d’un parfum ou d’une saveur qui réveille instantanément un souvenir enfoui, quelque chose comme l’éblouissant surgissement d’une fraction du passé à nouveau vivante. C’est naturellement l’expérience décisive qui va engendrer quelques décennies plus tard, une oeuvre monumentale :
« Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d’un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j’avais laissé s’amollir un morceau de madeleine. Mais à l’instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d’extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m’avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. » (Marcel Proust, Du côté de chez Swann )
Voici de quelle façon Baudelaire la formule :
Voilà le souvenir enivrant qui voltige
Dans l’air troublé ; les yeux se ferment ; le Vertige Saisit l’âme vaincue et la pousse à deux mains
Ce poème prélude évoque un vieux flacon retrouvé au fond d’une armoire :
Parfois on trouve un vieux flacon qui se souvient, D’où jaillit toute vive une âme qui revient.
Quelle âme ? Après avoir évoqué Lazare ressuscité, Baudelaire invoque « un vieil amour ranci, charmant et sépulcral. » Toutes ces indications convergent vers son grand amour d’enfant : Mariette, « la servante au grand coeur dont vous étiez jalouse ».
Souvenons-nous de ce que sa mère était littéralement corsetée dans les principes éducatifs, au point de ne jamais exprimer sa tendresse maternelle pourtant réelle. Nous venons de la voir, dans la même soumission à l’égard de son second époux, quand Maxime Du Camp cite le nom de Baudelaire.
Double réminiscence parce que ce flacon est aussi la métaphore de celle qui, par un enchantement comparable, fait revivre la tendre servante.
On ne saura jamais ce que Marie avait en commun avec Mariette, hors la parenté des prénoms ; mais ce poème n’est pas là par hasard.
Enfin ce rapprochement est encore suggéré par le fait que les deux derniers quatrains sont adressés à un destinataire non nommé mais dont l’identité peut être aisément décryptée. Le poème sera le flacon dans lequel survivra la mémoire de « l’aimable pestilence », dont on apprend encore ceci :
Cher poison préparé par les anges ! Liqueur Qui me ronge, ô la vie et la mort de mon cœur !
Ce poème a donc été composé au terme non seulement de la relation avec Marie Daubrun, mais encore à un moment où il n’y avait plus aucun espoir de renouer avec elle, de quelque façon que ce soit.
Ces vers sont encore tout empreints de souffrance et de détestation mais ils entrent aussi en résonance avec un passage de la lettre précédemment citée :
« Par vous, Marie, je serai fort et grand. Comme Pétrarque, j’immortaliserai ma Laure. Soyez mon Ange gardien, ma Muse et ma Madone, et conduisez-moi dans la route du Beau. »
J’ai l’intuition – et ce n’est pas la première fois – que Baudelaire finit par être ici absolument sincère. Tout se passe comme si cohabitaient en lui deux personnalités, comme si les deux instances psychologiques que sont le ça et le sur-moi – pour reprendre la seconde topique freudienne – menaient séparément leur existence ou encore comme si le commandement de la personnalité – donc de la personne – pouvait passer instantanément de l’un à l’autre.
Du coup il pourrait bien s’agir de ce qu’on désigne en psychiatrie comme « trouble bipolaire » ou encore mélancolie maniaco-dépressive.
Une thèse allant dans ce sens a été déposée à l’université de Rhode Island en 2017 par une certaine Kristen Murphy 90.
Inutile d’entrer dans les détails des clivages, à ce sujet, entre psychiatres et psychanalystes puis entre freudiens et lacaniens. Ce qui importe ici c’est de comprendre que Baudelaire, en effet, comme il l’inscrit lui-même dans la principale partie de son recueil, oscille continuellement entre spleen et idéal ou, pour le formuler autrement, entre ses pulsions, érotiques ou agressives, et ses idéaux du moi.
Nous le verrons d’ailleurs dans l’un des poèmes suivants.
90 La double vie de Baudelaire: le trouble bipolaire et la dépendance à l’opium. 2007
β Le poison
Ce deuxième poème est bâti sur une opposition entre les deux moyens dont use le poète pour échapper au poids de l’existence – à savoir le vin et l’opium – le premier transfigurant la sordide réalité, le second libérant l’âme de tout ce qui l’arrime au corps.
De façon symétrique la femme aimée – simplement apostrophée par le moyen des adjectifs possessifs ( tes, ta) – supplée au vin par la beauté de ses yeux verts.
Le poète qui se voit désormais à travers ce regard, est replacé par celui-ci dans la réalité embellie que Marie perçoit pour lui ; de là, peut-être la métaphore du renversement.
Et puis, par ses baisers, elle soulage des douleurs du corps, l’approchant de cette apathie de satisfaction qui est, au sens étymologique, le fait de ne plus souffrir. C’est en cela que, cette fois, elle remplace l’opium.
Relevons d’abord que ce poème – qui est évidemment celui des préludes amoureux – ne rapporte que des baisers. Mais par ces baisers l’amoureux reçoit un poison ; par ailleurs les yeux de l’aimée sont « amers » et sa bouche instille une « salive qui mord ».
Poème sans doute écrit après la rupture signifiée par la lettre. On va un peu loin, comme on verra, en prétendant que Baudelaire fut l’amant de Marie Daubrun. Relevons à cet égard que le baiser conduit l’âme de l’amoureux « aux rives de la mort » et donc sans que le corps ne plonge dans cet oubli miraculeux de soi qui survient après « la petite mort ».
J’ai le sentiment qu’en dehors de ces baisers il n’y eut entre Marie et Charles qu’un unique rapport sexuel.
γ Ciel brouillé
C’est le poème célébrant Marie Daubrun de la façon la plus évidente. Ces yeux clairs, à la couleur incertaine et changeante, c’est ce qui a d’abord séduit Baudelaire. Et cette puissance hypnotique demeure, quoi qu’il doive survenir entre eux par la suite.
Il faut relever ici l’ambivalence qui parcourt ces vers, à commencer par le titre.
=> L’adjectif verbal « brouillé » renvoie en effet aussi bien au brouillage qu’à la brouille.
=> Cet aspect changeant exprime tour à tour des sentiments contradictoires puisque ce regard peut être, tour à tour, « tendre, rêveur, cruel ».
=> Poème d’adoration d’où émerge pourtant, discrètement, un désespoir absolu : « se fondre en pleurs », « mal inconnu ».
Second caractère : c’est évidemment le poème prélude de « L’invitation au voyage ».
Comme celui-ci est à coup sûr postérieur à la lettre – « Mon enfant, ma soeur » marquant sensiblement le glissement de la relation avec Marie que Baudelaire entend opérer – il faut supposer que c’est aussi le cas de ce poème-ci. C’est cette circonstance qui rend compte de ses connotations ambivalentes.
Quelques rapprochements entre ces deux poèmes du cycle :
=> « Ciel brouillés » <=> « Les soleils mouillés de ces ciels brouillés »
=> « Ton oeil (…) tendre, rêveur, cruel » <=> « De tes traitres yeux »
=> «… ces beaux horizons » <=> «… Ces vaisseaux Dont l’humeur est vagabonde »
Le basculement dont la lettre témoigne pourrait donc bien avoir connu une étape intermédiaire, faisant écho à l’épisode de Châteaudun : Marie et Charles deviendraient effectivement époux et épouse. Seulement Charles, décrété « mineur à vie », n’est pas en droit de se marier.
Ceci pourrait expliquer
=> d’une part qu’il se mette à rêver d’une expatriation,
=> d’autre part qu’il continue d’en vouloir à sa mère en dépit de son dévouement.
δ Le chat
Trois poèmes du recueil célèbrent les chats, celui-ci et deux autres :
=> « Viens mon beau chat sur mon coeur amoureux »
=> « Les chats » ; premier vers : « Les chats puissants et doux, orgueil de la maison,»
Baudelaire avait donc une prédilection pour les chats, ce qui se conçoit aisément. Que vient faire ici celui-là ? La même chose que les autres : consoler.
C’est le premier vers qui permet d’abord de le dire : « Dans ma cervelle se promène » Plus loin il nous est dit de la voix du chat : « Elle endort les plus cruels maux ».
Le chat est tendre et fidèle ; pour autant il n’abdique ni sa force, ni son indépendance. En plus il est éloquent, portant à l’oreille, avec la même discrétion, sa tendresse et sa colère.
Questionnement implicite à ce poème : pourquoi les femmes qu’on aime ne sont-elles pas bâties sur le même modèle ?
Enfin, dans le moment de la relation à Marie Daubrun, cette étape est celle qui suit immédiatement la rupture révélée par la lettre : elle en aime un autre.
L’amoureux éconduit se console avec son chat.
Comme il l’avait annoncé dans cette même lettre, Baudelaire, renonçant à accabler Marie de ses baisers, se fait ici Pétrarque célébrant sa Laure. Pétrarque, le plus français de tous les poètes italiens, demeura en Avignon pendant la période où la papauté s’y était installée.
C’est là qu’il tombe amoureux de Laure de Sade, ancêtre du marquis du même nom, à la fois belle à ravir et véritablement angélique. Du coup Francesco Petrarca va s’installer dans la région, à Fontaine-de-Vaucluse précisément, pendant 5 ans. Relation parfaitement platonique mais source constante d’inspiration poétique.
La célébration de Marie que Baudelaire agence dans ce poème, sur la métaphore filée du navire, porte tout entière la marque du souvenir, quoiqu’elle soit écrite au présent. Mais paradoxalement la distance, à la fois spatiale et temporelle, se signifie dans ce présent parce qu’il est celui de l’interpellation. Marie a disparu de l’horizon ; on ne peut plus désormais que lui écrire ; et si c’est un poème, elle le lira sans doute.
Superbe description de l’altière Marie, d’abord, voguant dans son ample robe comme un navire avançant par ses voiles, prenant le large, ce qui est le cas de le dire. La fermeture des possibles est marquée à la fois par la récurrence du verbe « raconter » et par la répétition de la première et de la deuxième strophe.
Autre trait remarquable : la lente remontée du désir. On y passe en effet des notations relatives à l’enfance – « l’enfance s’allie à la maturité », « majestueuse enfant » – à la célébration érotique, évoquant successivement « Ta gorge » ( 5° et 6° strophes), « Tes nobles jambes » (8°strophe), « Tes bras » (9°strophe), «… ton cou large » (10°strophe).
Ce poème qui s’adresse explicitement à la femme aimée et qui lui a sans doute été envoyé, ne reçoit probablement pas de réponse. C’est ce qui explique la suite.
Ce cycle, comme le précédent, est aussi la recomposition d’une histoire et d’une histoire d’amour.
ζ L’invitation au voyage
C’est l’un des poèmes les plus connus de Baudelaire. Pourtant on ne peut en saisir le sens et la portée qu’à condition de le replacer dans son cycle.
Alors il dévoile sa véritable nature : c’est une demande en mariage.
Ce voyage, en effet, n’a pas de retour et, du coup, il devient métaphoriquement celui de la vie. Quant à sa dimension conjugale, elle se décline en une suite de notations fort explicites :
=> « … vivre ensemble » : il s’agit donc bien non pas de passer un moment « là-bas » mais de s’y établir.
=> « Aimer à loisir, Aimer et mourir » : donc un amour paisible qui prend son temps et qui, si rien ne vient l’entraver, durera jusqu’à la mort.
=> « notre chambre » : l’adjectif possessif marque la propriété, ce qui est confirmé, plus haut, par les « meubles luisants » dont le fiancé qu’est devenu Charles entend la meubler.
Ce pays, que certains commentateurs tiennent pour imaginaire, est évidemment la Hollande. Ses canaux qui parcourent « la ville entière », ces vaisseaux qui « viennent du bout du monde », ces « soleils mouillés » et « ciels brouillés » donnent déjà une vision précise de son aspect extérieur. En outre les « meubles luisants », les « miroirs profonds », les « riches plafonds » complètent adéquatement le tableau.
C’est du reste le cas de le dire puisque Baudelaire, amateur de tableaux, a puisé cette connaissance intime du pays dans la peinture hollandaise. Au jugé : Ruysdaël pour les paysages, Vermeer pour les intérieurs.
Néanmoins ça ne suffit pas à répondre à la question : pourquoi la Hollande ?
Ici, scoop : parce que Charles Baudelaire, mineur à vie, peut pourtant espérer y épouser Marie. Le mariage requiert l’autorisation de l’un des parents ou beaux- parents, comme c’est le cas ailleurs en Europe ; mais le roi peut accorder une dispense 91.
Donc si jamais Marie consent à cette union, il écrira au généreux monarque une lettre éloquente pour plaider sa cause ; il a déjà l’esprit tout occupé de son argumentaire. Pour l’essentiel : c’est par l’amour que Dieu, dans son infinie bonté, nous ouvre la voie vers lui. Il importe donc de la maintenir ouverte.
Enfin, discrètement, celui qui veut se fiancer par ces vers fait allusion à ce qui a sans doute constitué le prélude de leurs échanges intimes :
Tout y parlerait
À l’âme en secret
Sa douce langue natale
Qu’est-ce donc que la langue natale par laquelle certaines choses peuvent s’adresser à l’âme ? C’est la beauté, justement, parce qu’elle est divine par essence. Et si Marie est capable de saisir immédiatement le sens de ces vers, c’est que Charles a dû lui présenter sa conception swedenborgienne du monde après lui avoir déclaré que sa beauté ravissante était le signe d’une onction divine.
Enfin comme il s’agit ici d’effacer autant que possible dans l’âme de la jeune femme l’impact désastreux d’une précipitation érotique, il l’apostrophe dans des termes qui excluent la sexualité tout en maintenant la tendresse de l’amour : « Mon enfant, ma soeur ».
______________ 91 Deux extraits d’articles de ce code civil hollandais : « L’homme avant dix-huit ans, la femme avant seize ans révolus, ne peuvent contracter mariage » ; on suppose que cette défense vaut aussi pour les mineurs à vie. Autre extrait : « Le roi peut accorder des dispenses de défenses de mariage »
Vaine tentative : Marie, malgré la précarité de sa situation – à laquelle elle a peu de chance d’échapper du fait de la réputation sulfureuse des comédiennes – ne donne pas suite.
Si nous reprenons avec circonspection l’hypothèse de la bipolarité, nous dirons qu’ici Charles est tout angélique, disposé à accepter tous les sacrifices qui lui permettraient d’entrer dans une union durable et apaisée avec cette femme qu’il a appris à aimer d’amour.
Cette fois c’est le poème de la rupture, du clivage, du « never more » pour reprendre l’antienne 92 d’Edgar Poe.
Hypothèse : après le refus de Marie de le suivre en Hollande et de devenir son épouse, Charles revient sur son passé et la façon dont elle a surgi dans sa vie.
Les deux dernières strophes – comme nous l’avions vu plus haut – évoquent la première apparition de Marie sous les yeux de Charles. Elle a alors 17 ans, elle est angélique et elle a le pouvoir de « Terrasser l’énorme Satan ».
En opposition, les 8 autres strophes déclinent les figures du satanique montées à l’assaut de l’âme du poète.
La plus explicite est accessible par le truchement du binôme « irréparable » / « remords ». Ce qui fonde en partie la thèse d’une tentative de Charles d’avoir un rapport érotique avec Marie, c’est la 6° strophe :
L’Espérance qui brille aux carreaux de l’Auberge Est soufflée, est morte à jamais ! Sans lune et sans rayons, trouver où l’on héberge Les martyrs d’un chemin mauvais !
Le Diable a tout éteint aux carreaux de l’Auberge !
La majuscule mise à l’Auberge renforce l’article défini : il est donc question d’un événement précis et localisé. Cette Espérance majuscule, c’était sans doute celle d’unir sa vie à celle de Marie. Et puis les choses tournent mal, s’engagent dans le « chemin mauvais ».
Charles, talonné par le désir, porte la main sur Marie ; ça ne se passe pas bien, en particulier si c’est pour elle la première fois.
Tout cela a sans doute eu lieu sur le chemin de retour de l’expédition de Châteauroux.
92 Chose que l’on répète, que l’on ressasse.
Quand l’amoureux, des années plus tard, se met en quête de ce qui dissuade Marie de le suivre en Hollande afin d’entrer avec lui dans l’union de leurs vies, c’est cet événement-là qu’il trouve. Alors, comprenant l’ampleur du mal qu’il a provoqué – non seulement à la jeune fille mais à lui-même – il est saisi par le remords.
Et Baudelaire le décline ensuite avec tant de détermination qu’il faut surtout y voir un regret abyssal. De là le titre en quelque sorte « générique » de ce poème : « l’irréparable » c’est à la fois ce qu’on ne peut abolir dans l’ordre des faits, et ce pour quoi il ne peut y avoir réparation, dans l’ordre moral.
La « belle sorcière » c’est ce en quoi s’est transformée la fée d’autrefois, du fait de ce geste incongru. Et le poète, à deux reprises, la supplie de lui apprendre comment sortir de ce remords qui obscurcit désormais sa vie entière.
Dans l’ordre des signifiants il faut encore rapprocher cette nuit étouffante qui se répand, du termite qui attaque le bâtiment à la base. Ce qui est implicitement signifié ici c’est la tentation d’en finir avec la vie.
L ‘ « adorable sorcière » pourrait redevenir un instant la fée aux ailes de gaze d’autrefois et avoir pitié de cet amant malheureux acculé à en finir avec la vie.
Même si la damnation n’a pas le même sens en théologie catholique et pour Swedenborg – lequel rejette la notion de punition divine – dans l’un comme dans l’autre cas, on ne met pas fin à ses maux en mettant fin à sa vie. => Pour le catholique, on va en enfer, le péché d’abolir la vie qui est un don de Dieu étant « irrémissible », id est ne pouvant pas être remis, c’est-à-dire pardonné. => Pour le swedenborgien, on retrouve la même vie avec les mêmes problèmes et, par conséquent, les même souffrances.
C’est en quoi il y a damnation dans l’un comme dans l’autre cas.
θ Causerie
Ce sonnet est celui du passage à l’acte.
En outre il appartient à la fois au cycle Marie Daubrun et au troisième cycle, celui d’Apollonie Sabatier. Celle-ci en est d’ailleurs la destinataire. Cette césure avec le poème précédent est perceptible par le passage du tutoiement au vouvoiement.
Métaphoriquement, si cette femme-là est « un beau ciel d’automne », c’est que née en 1822 elle a – à un an près – le même âge que Baudelaire. Rappelons qu’à l’époque on entre tôt en la vieillesse, particulièrement les femmes.
Si l’on situe en 1856 cette idylle malheureuse avec Marie Daubrun, comme « Les Fleurs du Mal » seront publiées l’année suivante et qu’elles incluent ce sonnet, nous pouvons en déduire que la dédicataire est alors âgées de 34 ans ; c’est très précisément le passage des deux premières saisons de la vie aux deux dernières.
On se focalise généralement sur la prétendue tentative de suicide de 1845, savamment conçue par Baudelaire pour que Jeanne puisse recueillir chez Ancelle quelque argent qui leur permette de survivre.
Là encore, étant donnée la dualité qui marque son tempérament, on ne sait pas jusqu’où est allé le coup de couteau qu’il s’inflige. Sans doute assez profondément pour accréditer la thèse d’une mort possible. Mais s’il avait véritablement voulu mettre fin à ses jours, répétons-le, il disposait, avec l’opium, d’un moyen à la fois beaucoup plus efficace et beaucoup moins douloureux.
Par contre ce qui est suggéré dans ces vers, avec une grande discrétions, paraît plus sérieux. Il y a d’une part ce « limon amer » que la tristesse laisse sur les lèvres, d’autre part ce geste, dont on ne sait s’il est de sauvetage ou de sollicitude :
« Ta main se glisse en vain sur mon sein qui se pâme »
Geste vain parce que le coeur, organe de la vie, ne cessera pas de battre ; d’autre part parce que le siège de l’amour, ravagé par les bêtes, a été anéanti.
Quelles bêtes ? Jeanne et Marie, sans doute.
Celle qui se penche alors avec sollicitude sur le poète malheureux est d’abord
« amie ». Nous reviendrons plus loin sur cette relation prolongée et diverse avec Madame Sabatier. Sans doute devient-elle lors de cet épisode de désespoir, une figure maternelle et secourable. Autre hypothèse : c’est cet infléchissement de leur relation qui fera plus tard d’Apollonie l’amie de Charles.
Enfin comme elle le sait amoureux éconduit et malheureux, elle ne lui demandera pas de devenir son amant.
Pour le moment elle cause ; en d’autres termes elle tente de lui démontrer à quel point son geste était absurde. A quoi il rétorque que si la vie n’est qu’une longue suite de malheurs, autant mourir le plus tôt possible… et c…
ι Chant d’automne
Deuxième poème double des cycles amoureux puisqu’on y est encore dans cette configuration triangulaire d’Apollonie consolant Charles de son amour malheureux pour Marie.
La première partie revient de façon monotone sur les ravages du coeur, sous le double éclairage de la mort et de la souffrance. Triste saison, donc, qui annonce à la fois l’hiver de la vie et celui de l’amour.
La seconde est une supplique, non pour être aimé mais pour être consolé. Deux vers clef :
Et rien, ni votre amour, ni le boudoir, ni l’âtre Ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer.
Paradoxe : l’amour d’Apollonie, ici rejeté, est réclamé dans les deuxième et troisième quatrains. C’est qu’il ne s’agit pas du même amour. Quelques vers :
Et pourtant aimez-moi, tendre cœur ! soyez mère, Même pour un ingrat, même pour un méchant ;
Plus loin :
Ah ! laissez-moi, mon front posé sur vos genoux,
Bref, Apollonie ferait bien son amant de cet amoureux éconduit mais celui-ci veut demeurer le petit garçon que l’on console.
Ces circonstances ont sans doute réveillé le ressentiment que Charles éprouve pour sa mère. Si elle n’avait pas consenti à sa minorité perpétuelle, il n’en serait pas là.
Marie aurait désormais un époux fidèle et dévoué, gagnant sa vie honorablement et lui permettant de poursuivre librement sa carrière de comédienne.
Dernier point : ce « soleil rayonnant sur la mer » que rien ne vaut aux yeux de Charles, c’est, une fois de plus, la métaphore du regard de Marie.
Apollonie a beau avoir de « long yeux à la lumière verdâtre », Charles n’y retrouve pas cette profondeur et cette ambiguïté qui le fascine dans le regard de Marie, de façon quasi hypnotique.
Ce qui s’opère ici, avec une typique brusquerie, c’est le retour du refoulé. Bi-partition de ce poème : célébration de la femme aimée par divinisation : l’âme angélique lui élève une statue, comme si elle était la Sainte Vierge ; et puis, brusquement, dans la seconde partie du poème, l’âme diabolique s’empare des sept couteaux que sont devenus les péché capitaux et en transpercent le coeur de la Vierge.
En réalité ce surprenant dénouement a été savamment préparé : cet autel est édifié « au fond de ma détresse », « dans le coin le plus noir de mon coeur » ; le manteau de la Vierge est taillé « dans ma jalousie » ; et puis, sous les pieds de la Vierge, « le serpent qui me mord les entrailles », « tout gonflé de haine et de crachats ».
D’où cette haine meurtrière surgit-elle ? Ces notations le disent assez qui mêlent étroitement les marques de l’amour à celles de la haine : de la jalousie.
Du coup on peut pratiquement dater ce poème de l’année du départ de Marie pour Nice au bras de Théodore de Banville, soit 1859.
Deux indications supplémentaires à propos de ce poème :
=> Dans ces huit vers meurtriers l’amour est pourtant toujours là ; il s’agit bien, comme il est écrit de « mêler l’amour avec la barbarie ». Et puis le bourreau qu’est alors devenu Charles sur le plan symbolique, est déjà « plein de remords ».
=> Ce poème ne doit donc pas faire partie de la première édition des Fleurs du Mal, qui date de 1857. Et c’est bien le cas. Cela signifie très explicitement que ce recueil de poèmes est conçu d’emblée comme l’histoire de ce poète, de sa vie, de son coeur et de son âme.
Complétons pourtant ce cycle.
λ Chanson d’après-midi
Ce poème – par contraste, plein de légèreté – est celui du retour à Jeanne. Derrière « Chanson d’après-midi » on peut donc entendre « Chanson d’après Marie ». Tout converge vers ce premier amour ; mais la mention décisive pourrait bien être « ma brune » de la 8° strophe. Marie était brune elle aussi mais elle refusait à Charles toute espèce de propriété sur sa personne.
Ceci une fois posé, tout s’enchaîne autour de cette figure exotique de Jeanne, le plus décisif tenant moins à son apparence qu’au type de rapport qu’elle entretenait avec Charles. On relève en particulier ses « poses langoureuses » et ce talent de prodiguer « … la caresse Qui fait revivre les morts ». Il n’y eut jamais rien de tel dans les rapports de Baudelaire avec Marie.
Enfin, évidemment, tous les traits caractéristiques de la « Vénus noire » : « tes sourcils méchants », « tes tresses rudes », hanches « … amoureuses De ton dos et de tes seins ».
Culte païen, cette fois : on est passé de la Madone du poème précédent à « l’idole », de la Sainte à la nymphe. Action de grâce, pourtant, de la dernière strophe :
Mon âme par toi guérie Par toi, lumière et couleur ! Explosion de chaleur
Dans ma noire Sibérie.
C’est cette reconnaissance qui expliquera en partie le dernier épisode de cette histoire d’amour exotique. Mais on n’en est pas là.
b) Le cycle Apollonie Sabatier
Comme on peut s’en douter le retour dans les bras de Jeanne n’est pas longtemps paradisiaque. C’est une muse plus pacifique et plus secourable qui inspirera à Baudelaire quelques uns de ses poèmes les plus beaux.
Aglaé Savatier, pour l’état civil, il l’a connue lors de leur commune jeunesse, à l’Hôtel Pimodan, où ils résidaient l’un et l’autre. Aux yeux de Charles une aimable jeune femme avec laquelle il est possible d’avoir un commerce apaisé et une conversation intéressante ; elle est loin de manquer d’esprit.
De fait, quelques années plus tard, devenue salonnière et demi-mondaine, elle accueille dans son nouvel appartement de la rue Frochot, au dîner du dimanche, tout un aéropage 93 d’écrivains et d’artistes. Nous y retrouvons Maxime du Camp et son inséparable Gustave Flaubert avec, dans la même clique, les frères Goncourt.
Et puis, entre autres, Victor Hugo, Sainte-Beuve, Alexandre Dumas, Feydeau, Théophile Gautier, Musset, Gérard de Nerval, Barbey d’Aurevilly, Manet et Berlioz.
Ces assemblées qui peuvent comporter jusqu’à 20 personnes auraient pu sombrer dans le brouhaha si Apollonie – prénom choisi qui dit assez sa vocation de protectrice des arts – n’y avait mis bon ordre.
Elle s’institue donc présidente de ces assemblées, donnant la parole à chacun et veillant à ce que celui qui parle soit écouté, tout en ne monopolisant pas la parole. C’est de là qu’elle tient son surnom plein de déférence : La Présidente, avec un P majuscule.
Ceci dit cette rigueur n’exclut nullement une complète liberté dans les propos. Une lettre de Théophile Gautier laisse entendre qu’on pouvait même y admettre des propos licencieux 94.
C’est sans doute ce mélange de rigueur et de liberté qui explique le succès de ce salon.
Comment Charles et Apollonie sont-ils entrés en relation ? Le cycle le révèlera.
_________________ 93 Assemblée de juges, de savants, d’hommes de lettres très compétents. 94 D’une extrême liberté, non limité par la pudeur, la décence.
α Semper eadem
Le premier poème de ce court cycle qui n’en comporte que 8, fait part du type de rapports qui s’établit d’abord entre eux. On y voit paraître une figure maternelle, pleine de sollicitude ; voici les deux premiers vers de ce sonnet :
« D’où vous vient, disiez-vous, cette tristesse étrange, Montant comme la mer sur le roc noir et nu ? »
La suite du premier quatrain donne la réponse :
Quand notre cœur a fait une fois sa vendange, Vivre est un mal. C’est un secret de tous connu,
Cette vendange du coeur, c’est l’amour et, en l’espèce, l’amour malheureux, que ce soit avec Jeanne, exigeante et capricieuse, ou avec Marie, qui ne veut rien savoir.
Le second quatrain révèle la nature de la relation de Charles à la Présidente, en partie du moins, tout en dévoilant le sens du titre.
Une douleur très simple et non mystérieuse,
Et, comme votre joie, éclatante pour tous. Cessez donc de chercher, ô belle curieuse !
Et, bien que votre voix soit douce, taisez-vous !
Cette fin de non recevoir des deux derniers vers est encore amplifiée au début du premier tercet :
Taisez-vous, ignorante ! âme toujours ravie ! Bouche au rire enfantin !
On y retrouve cette bipolarité caractéristique de Baudelaire, cette propension à s’emporter, à déverser dans une colère opportuniste toutes ses frustrations.
La répétition de l’impératif et impérieux 95 « Taisez-vous ! » dit assez que Charles est excédé par cette sollicitude d’Apollonie.
« Semper eadem » signifie « toujours de la même façon ».
La belle Apollonie qui rayonne de bonheur, ne sait apparemment pas nouer avec Charles d’autres relations que sur le mode « Qu’est-ce qui ne va pas ? Pourquoi êtes-vous si sombre ? »
Et ce qui rend cette sollicitude odieuse à celui qui en est l’objet, c’est que cette femme est comblée par la vie et qu’elle n’a pas la moindre idée de ce qu’endure Baudelaire, du moins à ce stade de leur relation.
Ici, parenthèse : on sait que Baudelaire adressa à Madame Sabatier le 9 décembre 1852 une lettre anonyme comportant un poème intitulé justement « A une femme trop gaie », lettre qui commence par cette déclaration paradoxale :
« Celui qui a fait ces vers dans un de ces états de rêverie où le jette souvent l’image de celle qui en est l’objet l’a bien vivement aimée, sans jamais le lui dire, et conservera toujours pour elle la plus tendre sympathie. »
Donc, à la fois, lettre de déclaration et de rupture, aussi délicatement énoncée l’une que l’autre. Par ailleurs ce poème ne fut jamais publié. Que nous apprend-il ? Il démultiplie l’ambivalence de ce premier poème du cycle :
95 Qui commande d’une façon qui n’admet ni résistance ni réplique.
= La première strophe est celle d’un amour idéal :
Ta tête, ton geste et ton air
Sont beaux comme un beau paysage ; Le rire joue en ton visage
Comme un vent frais dans un ciel clair.
= Les trois dernières font entrevoir un fantasme sadique :
Ainsi, je voudrais une nuit,
Quand l’heure des voluptés sonne, Vers les splendeurs de ta personne Comme un lâche ramper sans bruit,
Pour châtier ta chair joyeuse, Pour meurtrir ton sein pardonné, Et faire à ton flanc étonné
Une blessure large et creuse,
Et, délicieuse douceur,
À travers ces lèvres nouvelles Plus éclatantes et plus belles T’infuser mon sang, ô ma Sœur.
Voilà pourquoi cet aspirant à trouver par le beau le chemin du divin mais qui se sait en même temps en proie aux pulsions sataniques, préfère mettre un terme à sa relation avec l’angélique Apollonie.
C’est peut-être ce qui explique la suite du premier tercet :
Plus encor que la Vie, La Mort nous tient souvent par des liens subtils
Dernière énigme : quel est ce mensonge dont le poète aspire à s’enivrer ?
Je gage qu’il s’agit d’un pacte passé entre la tolérante confidente et l’amant déchiré par ses querelles conjugales avec Jeanne. Second tercet :
Laissez, laissez mon cœur s’enivrer d’un mensonge, Plonger dans vos beaux yeux comme dans un beau songe, Et sommeiller longtemps à l’ombre de vos cils !
Que cette femme ne soit plus qu’une mère aimante qui veille tendrement sur le sommeil de son enfant. C’est tout ce que Charles lui demande.
Comment ces relations problématiques évoluent-elles entre eux ?
Le plus sûr moyen de l’apprendre, c’est d’aborder la suite de ce troisième cycle amoureux. A ce stade de l’étude du recueil, on peut dores et déjà affirmer que Baudelaire est celui qui réinvente un genre littéraire archaïque : le roman versifié du XII° siècle.
β Tout entière
C’est bien quelque chose comme un amour enfantin qui se donne à entendre dans cette fable. Visite du Démon dont voici la demande :
« Je voudrais bien savoir,
Parmi toutes les belles choses
Dont est fait son enchantement, Parmi les objets noirs ou roses
Qui composent son corps charmant,
Quel est le plus doux. » –
Relevons que « les belles choses » qui font l’ « enchantement » d’Apollonie relèvent de l’âme et sont donc ici séparées, par la composition, des « objets » qui « composent » le corps.
Fort adroitement c’est la polysémie de la douceur qui vient gommer ce clivage entre l’âme et le corps que le poète rejette. Douceur égale des caresses et de l’indulgence de la femme aimée parce que femme aimante.
Au poète souffrant s’il faut « tout entière » cette féminine créature – qui n’est pas même désigné dans ce poème autrement que par le féminin de l’adjectif du titre, relayé ensuite par le pronom personnel – c’est qu’en elle, comme indiqué dans la troisième strophe, « tout est dictame » c’est-à-dire remède pouvant guérir toutes les plaies.
Et ici, à nouveau, âme et corps se confondent. Elle est cette mère qui vous prend dans ses bras, au propre ou au figuré, et qui, par la seule magie de ce geste, fait taire douleur et souffrance.
C’est cette dualité qui engendre, comme il est dit au premier vers de la dernière strophe, la « métamorphose mystique », c’est-à-dire une transformation essentielle dont le processus restera secret, inviolable.
Que peut-on en dire ? Ce qu’indiquent les deux vers d’une strophe précédente :
Elle éblouit comme l’Aurore Et console comme la Nuit ;
Elle est donc à la fois cette éblouissante apparition qui enflamme amoureusement et cette bonne fée du soir qui apaise craintes et chagrin. Et quand elle vous prend tendrement dans ses bras, elle est à la fois l’une et l’autre.
Voilà pourquoi à l’enfant qui est encore en l’homme, il la faut « tout entière ».
On touche ici à cet attachement à la fois enfantin et oedipien qui constitue le fondement de toute relation amoureuse ultérieure, excepté du moins ce que Freud désignera plus tard comme le continent noir de la psychologie féminine 96 .
Pouvoir considérable de la Présidente qui va, du moins pour un temps, remettre les choses en ordre dans la vie de Charles.
______________ 96 « La vie sexuelle de la femme adulte est encore un continent noir pour la psychologie” dans « La question de l’analyse profane », 1926.
γ Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire
Ce sonnet décline, de toutes les façons possibles, les bienfaits de cette rencontre essentielle dans la vie et dans l’oeuvre de Baudelaire.
Comme il est énuméré dans le dernier vers, Madame Sabatier est à la fois « l’Ange gardien, la Muse et la Madone. » ce qui signifie successivement un être dévolu par Dieu à la protection du poète, une source d’inspiration poétique et une figure maternelle toute de bonté et de sollicitude.
Or cette nature angélique – désignée métaphoriquement comme « fantôme » dans le dernier vers du premier tercet – s’est donc transmuée en la conscience du poète, et même, pourrait-on dire, en son « moi idéal ».
On le perçoit en ce que
=> d’une part elle continue à s’adresser à lui, même quand elle n’est pas là, => d’autre part, ainsi qu’il l’exprime : « Rien ne vaut la douceur de son autorité ; »
Par conséquent, même dans la solitude, elle continue délicatement à prescrire.
D’où tient-elle ce pouvoir extraordinaire ? C’est le premier quatrain qui nous l’apprend :
Que diras-tu, mon cœur, cœur autrefois flétri, À la très belle, à la très bonne, à la très chère, Dont le regard divin t’a soudain refleuri ?
Cette métaphore n’est pas là simplement pour faire joli. Nous avons entrevu Baudelaire, au début de ce cycle, en proie à des fantasmes sadiques, peut-être pas très loin, quoique sans doute avec horreur, du passage à l’acte.
Or non seulement Apollonie entend cela, mais elle le pardonne. Par là, elle tient les démons de cette âme tourmentée à distance. Grâce à quoi elle va permettre le déplacement de cette énergie, enfermée dans les pulsions, vers la création, la quête du beau.
A nouveau, « les fleurs du mal », ce qui s’entend cette fois clairement comme passage de la flétrissure des mauvais penchants à la beauté de la floraison poétique.
Ce flambeau éclairant le chemin de l’ idéal, fait l’objet du poème suivant.
δ Le flambeau vivant
Ce flambeau vivant, c’est Apollonie Sabatier ; plus précisément son divin regard qui, par la vertu de sa transmutation en conscience, est devenu le regard même du poète. C’est ce qu’exprime le premier quatrain :
Ils marchent devant moi, ces Yeux pleins de lumières, Qu’un Ange très savant a sans doute aimantés ;
Ils marchent, ces divins frères qui sont mes frères, Secouant dans mes yeux leurs feux diamantés.
L’effet principal de cette assimilation est énoncé dès les vers suivants :
Me sauvant de tout piège et de tout péché grave, Ils conduisent mes pas dans la route du Beau ;
C’est une confirmation de ce que laissait augurer le poème précédent ; « péché grave » laisse bel et bien entendre meurtre.
Les deux vers suivants sont remarquables en ce qu’ils transposent en quelques mots l’essentielle pluralité de l’âme humaine :
Ils sont mes serviteurs et je suis leur esclave ; Tout mon être obéit à ce vivant flambeau.
« mes serviteurs » tant que je me voue à la tâche de faire fleurir la beauté ; « leur esclave » quand mes vieux démons tentent à nouveau de m’entraîner vers le mal.
Les deux tercets sont plus obscurs, bâtis sur une opposition entre les deux signifiés que sont le soleil et le flambeau.
Pour les comprendre il faut distinguer le flambeau des cierges.
Le flambeau c’est cette lumière intérieure qui procède du don d’Apollonie et guide à la fois sur la route du beau et du bien.
Le soleil, c’est l’éblouissement du monde et de ses tentations.
De même que les cierges restent visibles en plein jour, de même le flambeau continue d’éclairer dans l’éblouissement des tentations.
Différence pourtant entre ces deux signifiants : le cierge, on l’allume dans une église pour se souvenir des morts, s’adresser aux âmes des disparus, ou bien prier pour préparer son âme à la mort.
Le flambeau du regard d’Apollonie c’est, au contraire, ce qui a permis le retour de l’âme du poète à la vie.
Mais rien ne dure en ce bas monde ; tout peut se retourner en son contraire. C’est d’une certaine façon, l’objet du poème suivant.
γ Réversibilité
Au fond Charles s’est constitué, dès son enfance, sa propre religion.
Il commence par prier ses chers défunts. Petit coeur meurtri, il les interroge ; ils lui répondent par les merveilleux reflets du soleil dans les nuages.
Et puis, lisant Swedenborg, il acquiert la certitude qu’il les retrouvera dans une autre vie, si du moins il oeuvre avec assez de constance pour atteindre les limbes du paradis où ces deux âmes résident à coup sûr.
Enfin la secourable Apollonie entre dans son panthéon, le prenant par la main, secourable guide sur la bonne route.
Seulement il n’est aucune religion qui n’inspire, en telle ou telle occasion, le scepticisme. Que vaut le flambeau dont la belle Madone prétend éclairer sa route si elle n’a aucune idée du lit des serpents sur lesquels il faut marcher ?
Ce poème-là décline toutes les formes de la négativité qui se sont emparé de l’âme du poète :
=> Tous les sentiments qui marquent la tension douloureuse entre les bas instincts et les hautes aspirations : l’angoisse, la honte, les remords, les sanglots, les ennuis 97.
=> La haine qui peut pousser abruptement à la violence meurtrière, parce que trop longtemps contenue, ce que Jeanne a pu parfois inspirer à son amant ; ou alors…
Les poings crispés dans l’ombre et les larmes de fiel, Quand la Vengeance bat son infernal rappel
Blessures d’amour propre de l’enfance infligées par l’odieux capitaine Aupick qui non seulement lui volait sa mère mais s’arrogeait le droit de le punir sans tolérer jamais la moindre protestation. De là, en 1848, sur la barricade, le rêve de le faire passer devant un peloton d’exécution.
97 Ici dans le sens ancien d’abattement causé par une grave peine, une profonde douleur.
Rappelons qu’entre temps il y avait eu la séquestration dans sa chambre pendant deux semaines puis le périple forcé dans « les Mers du Sud ».
Les trois dernières strophes sont relatives – dans l’ordre – à la maladie, au vieillissement et à la mort. Du coup on entre dans un paradoxe entre l’irréversible du destin commun – ici scandé en trois étapes – et le titre du poème, « Réversibilité ».
Est-ce à dire que Charles, d’abord exalté par cette angélique créature qui le libère de ses vieux démons, les retrouve par une sorte de régression ?
Ou bien le terme doit-il être pris dans son acception juridique de « réversion » comme paraît le suggérer la dernière strophe qui évoque David mourant ?
Pourquoi David ? Selon le récit biblique quoiqu’il ait envoyé Uri sur le champ de bataille afin que celui-ci y périsse et qu’il puisse s’unir à Bethsabée, d’abord épouse d’Uri dont il fut le second époux, Dieu ne le punit pas de mort, ceci parce qu’il avait demandé pardon. C’est le premier enfant de cette union qui mourut. Le deuxième fut Salomon.
Ce poème pourrait bien être, avec les autres, la réversion de l’union coupable d’Apollonie, logée et entretenue par Alfred Mosselman, riche entrepreneur et homme d’affaires, par ailleurs époux et père de famille.
Autre interprétation : il envisage alors de revenir à Jeanne Duval et, par conséquent, de mettre un terme à la cour assidue qu’il fait à la Présidente. Être malade, vieillir, périr… c’est semble-t-il la voie dans laquelle sa vieille compagne est désormais engagée.
En mars 1853, il avait écrit une longue lettre à Mme Aupick : Jeanne est malade et n’a plus le sou ; il est allé la voir de temps en temps pour lui porter un peu d’argent mais il n’en a plus. Il n’a rien dit à Ancelle qui serait trop content de l’apprendre ; de la même façon il dissuade sa mère de lui porter secours.
Pourquoi ? Parce que, semble-t-il, il veut demeurer le seul recours de sa « Vénus noire », comme il la nommait. Ici c’est le moi idéal qui reprend la main et la culpabilité qui reprend la parole, mais habilement :
« Mais en face d’une pareille ruine, d’une mélancolie si profonde, je me sens les yeux pleins de larmes, – et pour tout dire, le cœur plein de reproches. – Je lui ai mangé deux fois ses bijoux et ses meubles, je lui ai fait faire des dettes pour moi, souscrire des billets, je l’ai assommée, et finalement, au lieu de lui montrer comment se conduit un homme comme moi, je lui ai toujours donné l’exemple de la débauche et de la vie errante. Elle souffre et elle est muette. N’y a-t-il pas là matière à remords ? Et ne suis-je pas coupable de ce côté-là comme de tous mes côtés ? »
Rappel : la rupture qu’il vit comme définitive ne surviendra qu’en 1856 ; mais entretemps il y eut, entre les deux amants, plusieurs allers et retours ; ce poème pourrait donc porter l’écho de l’un de ces épisodes. Enfin Baudelaire continuera à se préoccuper et à s’occuper de Jeanne jusqu’à la fin ; et elle lui survivra une dizaine d’années mais, comme on ignore sous quel nom sa mort fut enregistrée, on ne sait pas non plus en quelle année elle mourut.
δ Confession
Merveilleux poème, plein de clarté et de délicatesse. Des vers narratifs qui racontent une promenade que font ensemble Charles Baudelaire et Apollonie Sabatier.
Comme je gage qu’il a choisi, après mûres réflexions, l’ordre des poèmes de ce cycle, il est aisé de concevoir qu’il fait d’abord part à la Présidente de ses déboires amoureux et conjugaux avec Jeanne.
Alors, contre toute attente, cette femme rayonnante de gaieté, soudain envahie par un chagrin secret, se transforme en humble et malheureuse épouse et appuie sa détresse sur le bras de son compagnon.
Elle raconte sans doute que son amant, le riche et généreux Alfred Mosselman, a pris une autre maîtresse… Va-t-elle jusqu’à imaginer de se retrouver à la rue ?
Le plus probable c’est que c’est une larme qui exprime d’abord sa détresse, larme que Baudelaire appréhende musicalement, nous disant :
Une note plaintive, une note bizarre S’échappa, tout en chancelant
Comme une enfant chétive, horrible, sombre, immonde, Dont sa famille rougirait,
Et qu’elle aurait longtemps, pour la cacher au monde, Dans un caveau mise au secret.
Ce poème, d’une parfaite sobriété, s’achève sur une strophe contrastée : beauté de la nuit tombée, amertume de la confidence :
J’ai souvent évoqué cette lune enchantée, Ce silence et cette langueur,
Et cette confidence horrible chuchotée Au confessionnal du cœur.
C’est l’instant du basculement de cette relation. Jusque là Apollonie a été pour Charles une mère bienveillante, compréhensive, et, en même temps, la judicieuse organisatrice des rares moments heureux de son existence.
Et parce qu’elle le connaît bien, qu’elle sait qu’il a du malheur une longue expérience, c’est justement à lui qu’elle choisit de se confier. « Confessionnal » parce qu’il se sent tenu par le secret ; « du coeur » parce que cette souffrance inattendue fait écho à ce qu’il a lui-même éprouvé.
C’est la strophe précédente qui indique dans quelle direction cette relation va désormais s’orienter :
Que bâtir sur les cœurs est une chose sotte ; Que tout craque, amour et beauté,
Jusqu’à ce que l’Oubli les jette dans sa hotte Pour les rendre à l’Éternité ! »
Si les strophes sept, huit et neuf expriment, comme l’indiquent les guillemets, les propos d’Apollonie, le dernier vers indique subrepticement, le mot que Charles a sans doute murmuré pour remplacer celui qu’Apollonie venait de prononcer : « pour les rendre au néant » ; « Non ; à l’Éternité » a dit Charles.
Alors, contre toute attente, il a commencé à lui parler de Swedenborg. Il se peut que je fabule ; pourtant il y a les deux poèmes suivants.
Parenthèse : Arthur Rimbaud fut un scrupuleux lecteur de Baudelaire. Il se peut que ce soient ces vers-là précisément qui lui aient permis de cristalliser une essentielle ambivalence à l’égard de ce maître es poésie.
Du moins c’est ce qu’on est en droit d’entendre dans cette strophe refrain du poème intitulé « L’Éternité » :
Elle est retrouvée. Quoi ? – L’Eternité. C’est la mer allée Avec le soleil.
Cocktail fort économe de légèreté et d’ironie.
ε L’aube spirituelle
C’est le moment de la révélation, celui où ce dandy spirituel sujet aux sautes d’humeur, décide de lever le voile, non plus sur son esprit – au sens du wit 98 anglais – mais sur sa spiritualité.
Précisons au passage que les dîners du dimanche soir, dans l’appartement de la Présidente, faisaient aussi place à l’humour et à la comédie, lors de séquences convenues.
_____________ 98 Esprit, dans le sens de « clever humor », humour intelligent.
Cette fois c’est le poète qui se glisse dans le « confessionnal du coeur ».
Ce que confie le débauché, amateur de vin et d’opium, c’est la façon dont son âme, assoiffée d’idéal, le taraude quand il émerge, le matin, de ses excès de la veille.
Dans ce poème-ci – singulièrement dans le vers « Des Cieux Spirituels l’inaccessible azur » – c’est Mallarmé qu’on entend, dont le poème magistral intitulé « L’Azur » pourrait légitimement être tenu pour un développement de cette « Aube spirituelle » ; cette strophe, en particulier :
De l’éternel Azur la sereine ironie
Accable, belle indolemment comme les fleurs, Le poète impuissant qui maudit son génie
À travers un désert stérile de Douleurs.
Rappelons que Mallarmé le tenait en véritable dévotion ; les habitués de ses fameux « mardis » se souviennent qu’ayant acquis une photographie de Baudelaire, Mallarmé lui avait trouvé un petit cadre afin de la poser sur sa cheminée.
Et puis, comme nous n’aurons probablement pas le temps de nous attarder sur la postérité de Baudelaire, seulement ce pénétrant jugement de Paul Valéry lors d’une conférence :
« La plus grande gloire de Baudelaire […] est sans doute d’avoir engendré quelques très grands poètes. Ni Verlaine, ni Mallarmé, ni Rimbaud n’eussent été ce qu’ils furent sans la lecture qu’ils firent des Fleurs du mal à l’âge décisif »
Cette fois Apollonie n’est plus seulement une muse mais une déesse, celle précisément qui tire le poète des miasmes de l’embourbement corporel et l’appelle à honorer sa divine mission, toute spirituelle, de créateur de la beauté.
On relèvera, pour finir, dans le second tercet, l’inversion des métaphores du lumineux :
Le soleil a noirci la flamme des bougies ;
Ainsi, toujours vainqueur, ton fantôme est pareil, Âme resplendissante, à l’immortel soleil !
C’est qu’Apollon, dieu de la lumière du soleil – et frère symbolique d’Apollonie – lui transmet par là son immortalité et sa fonction de protecteur des arts.
Le dernier poème du cycle livre la clef de cette immortalité.
ζ Harmonie du soir
Ces vers célèbres, parmi les plus beaux de Baudelaire, n’auraient pas pu être composés sans un basculement de son rapport à la Présidente. Il a dû se passer avec elle la même chose qu’entre Baudelaire et Maxime Du Camp : à un moment clef de la relation, Baudelaire, non seulement renonce à tout ce qui, en lui, est de l’ordre du paraître, de la comédie, de l’exploitation domestique, mais encore bascule incessamment dans la confiance absolue, se livrant tout entier.
La clef du sens sous-jacent à cette impeccable harmonie sonore, c’est le vers répété dans le troisième et le quatrième quatrain :
Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir,
D’abord coeur qui s’est révélé lors de la Confession, quatrième poème du cycle, au moment où Aglaé risque de perdre, du fait d’une rivale, tout ce qui en faisait Apollonie.
« Coeur tendre » parce qu’il a suffi de cette faille pour que tout ce qui alimente le mal de vivre resurgisse, en particulier la peur de la mort, « néant vaste et noir ».
Alors Charles raconte ses deuils d’enfant, ses souffrances… et puis les lectures qui ont pansé ses plaies, et encore la beauté comme signe et comme mission. Et ces vers prouvent qu’en s’engageant dans cette voie, on a parfois le bonheur de voir surgir l’une de ces harmonies qui signifient l’existence du divin.
C’est ainsi qu’il se fait que le son de « soir » se retrouve magiquement dans les objets sacrés du culte catholique : l’encensoir qui diffuse pendant la messe le parfum consacré, le reposoir où déposer le corps symbolique du Christ promis à la résurrection, l’ostensoir ou ce corps est placé symboliquement comme soleil.
En quelques mots les deux derniers vers dans cet étonnant poème rassemblent, => la symbolique chrétienne. Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige
Le Christ est mort crucifié, son sang a coulé ; il disparaît du monde des vivants comme le soleil se noie dans ce rouge envahissant du soir. Mais, comme le soleil, il renaîtra de l’horizon, éclairant le nouveau jour.
=> Le sacrement d’amitié Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir !
L’Apollonie solaire et secourable, en laissant temporairement la place à une créature fragilisée par le chagrin – « un coeur qu’on afflige » – a permis cette communion des âmes qui conservera désormais dans le coeur du poète un caractère sacré.
Relevons que cette ultime transmutation n’est possible que par la forme exceptionnelle du poème : le pantoum 99. Deux règles de composition :
= le deuxième et le quatrième vers de chaque strophe sont repris dans l’ordre comme premier et troisième vers de la strophe suivante, ce que Baudelaire respecte scrupuleusement.
= Le dernier vers du poème reprend le premier, règle à laquelle Baudelaire déroge.
99 Naturalisation en France d’une forme poétique de Malaisie, importée par Victor Hugo.
C’est cette forme qui, précisément parce qu’elle rejette finalement la circularité, va permettre d’édifier les correspondances essentielles en les élevant au plus haut.
Démonstration :
=> dans la première strophe chaque fleur « vibrant sur sa tige » entame la ronde des sons et des parfums ; dans la deuxième strophe le deuxième vers, entouré par la répétition des deux vers issus de la strophe précédente, hausse ce son au stade de la musique : « Le violon frémit comme un cœur qu’on afflige ; »
=> Cet effet est amplifié dans le dernier vers de cette deuxième strophe par une sorte de renversement de la comparaison : on est passé du frémissement évocateur du violon à la tristesse essentielle du soleil, comme si celui-ci savait qu’il allait mourir.
=> Ce sont ces deux vers qui encadrent, dans la troisième strophe, le vers clef :
« Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir ! » A ce stade, comme on l’a vu, il s’agit du coeur de cette femme affaiblie par le chagrin, qui a pris dans « Confession » le bras du poète et lui a confié sa détresse. Strophe qui se clôt par la mort symbolique du soleil, renvoyant implicitement à celle du Christ.
=> Le « coeur tendre » de la dernière strophe n’est pas le même ; c’est celui qui, « Du passé lumineux recueille tout vestige ! » , coeur qui, par conséquent, congédie « le néant vaste et noir ! », coeur du poète soutenu par la promesse paternelle d’une autre vie, puis d’une survie des êtres chers, qui font signe par les jeux des nuages et de la lumière du soleil.
C’est justement en transgressant les règles du pantoum que le dernier vers, devenu orphelin, nous livre l’essence de cette transmutation : comme l’hostie sacrée placée dans la loge de l’ostensoir rayonnant comme un soleil, la mort ne signifie pas le néant.
Que peut-on lire dans « Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir ! » ?
Ceci : Le bien que tu m’as fait est devenu sacré pour moi et j’espère, par ces vers, raviver le souvenir de ce moment d’empathie que nous avons partagé, le soir où tu as pris mon bras, le soir où nous sommes entrés en harmonie.
Fin du cycle Apollonie Sabatier.
3) Au lecteur
Sur le plan de la composition de ce bouquet poétique, il faut encore faire un sort à ce premier poème, évoqué au début de l’étude du recueil, à la fois dédicace et apostrophe, intitulé « Au lecteur ».
Ce poème est bâti sur une discrète opposition entre les 7 premiers quatrains et les trois derniers. Formellement on peut tenir que les hommes se livrent sans retenue ni remords à tout ce qui suscite leurs appétits, sans que leur âme se préoccupe jamais de la moralité. Quand par hasard ils prennent conscience de leurs péchés, ils vont en quêter l’absolution et recommencent aussitôt (1° et 2° strophes).
Condition commune – de là le « nous » – qui vient de l’action du diable (3° et 4° strophes). Il en résulte une plongée de plus en plus profonde dans l’abjection (5° strophe), plongée qu’accompagne discrètement l’approche de la Mort (6° strophe). Dans cette déchéance sans fond si le crime n’advient pas, c’est seulement l’effet de notre lâcheté (7° strophe).
Et pourtant si nous sommes les pantins du diable, c’est qu’une entité discrète le seconde à tout moment : l’Ennui majuscule (10° strophe). Il rêve d’échafaud – d’émotion violente, donc – en fumant son houka – à défaut, de disposer de quoi endormir la sensibilité.
De là nous pouvons déduire sa nature secrète : il est fait tout entier de la peur de mourir. Seulement, hypocritement, il ne s’avoue jamais.
Sauf sous la plume de notre poète qui termine son recueil par une longue suite de poèmes consacrés à la Mort, comme nous l’avions vu à propos de la dédicace à Maxime Du Camp.
Cependant il me semble que c’est dans ce conseil d’ami – Enivrez-vous – du Spleen de Paris 100 qu’est le fin mot de l’histoire.
L’Adresse au lecteur, c’est au fond la version baudelairienne du « divertissement » de Pascal. Seulement Baudelaire ne voit pas l’intérêt de se confire en contrition, sauf à l’avoir choisi.
Car il s’agit bien aussi, dans ce poème en prose, d’échapper à l’obsession du poids du temps qui nous courbe vers la terre, donc vers notre mort. Seulement cette fois, le breuvage – symbolique ou pas – qui nous en délivrera, peut désormais être bu en toute légitimité.
____________ 100 Publication posthume.
IV Six scandaleux poèmes
Baudelaire qui entendait s’adresser fraternellement à son semblable, va bénéficier pour ce recueil d’une publicité inattendue.
28 Juin 1857 : « Les fleurs du mal », livre auquel il a soigneusement travaillé et qui comporte exactement 100 poèmes, sort en librairie.
Dans un article du Figaro, en date du 5 juillet , sous la plume de Gustave Bourdin, on lit ceci : « L’odieux y coudoie l’ignoble, le repoussant s’y allie à l’infect. Jamais on ne vit mordre et même mâcher autant de seins dans si peu de pages ; jamais on n’assista à une semblable revue de démons, de foetus, de diables, de chloroses, de chats et de vermine. Ce livre est un hôpital ouvert à toutes les démences de l’esprit, à toutes les putridités du coeur. »
Et Le Figaro – qui se glorifie aujourd’hui de cet événement critique – n’en restera pas là. Si Baumarchais revenait parmi les vivants, il attaquerait ce journal – de bout en bout bien pensant et réactionnaire – pour usurpation d’identité.
Son Figaro à lui était autrement plus aimable.
1) Le procès et ses suites
Comme Ernest Pinard, zélé procureur, est sans doute un lecteur fidèle du Figaro, le sieur Baudelaire est cité à comparaître, deux jours plus tard, devant la sixième chambre du tribunal correctionnel de la Seine, au motif d’outrage à la morale publique et religieuse ainsi qu’aux bonnes moeurs.
Le verdict tombe le 20 août : l’auteur est condamné à 300 francs d’amende, les éditeurs à 100 francs. Les exemplaires en circulation devront être retirés de la vente. En cas d’édition ultérieure six poèmes devront être supprimés.
L’auteur et ses éditeurs, Poulet-Malassis et de Broise, sont privés de leurs droits civiques.
Napoléon III règne avec une poigne de fer sur la France d’alors ; mais son épouse Eugénie, née de Montijo, est encline à l’indulgence. Comme Baudelaire bien conseillé, lui écrit, l’amende est heureusement ramenée à 50 francs. Le principe de la séparation des pouvoirs attendra encore quelque temps pour être mis en chantier.
Et puis, autre bonne chose, comme le sieur Gustave Flaubert a été cité à comparaître en février devant le même tribunal pour « Madame Bovary », Baudelaire et lui font connaissance.
Flaubert a été finalement acquitté ; mais ces deux-là – qui sont loin d’anticiper le rayonnement futur de leur oeuvre respective – entrent aussitôt en sympathie.
Tout, pourtant, les oppose : tempérament, façon de vivre, tropisme littéraire, relations sociales, nébuleuse familiale… tout exceptée l’amitié de Maxime Du Camp.
Tout, sauf la capacité à lire véritablement, id est à accueillir avec toute l’ouverture d’esprit possible, ce qui leur tombe entre les mains.
Dans le chapitre de ses « Critiques littéraires » que Baudelaire consacre à
« Madame Bovary » on trouve une analyse laudative et pertinente, suivie d’un bref parallèle avec « La tentation de Saint Antoine ».
Baudelaire n’est pas souvent enthousiaste mais j’ai le sentiment que « Madame Bovary » était le roman qu’il plaçait au dessus de tous les autres, et avec raison ; il n’y en a pas de meilleur.
Quelques passages éloquents : = A propos du procès intenté à Flaubert pour atteinte à la morale publique et de sa révision :
« Sollicitée par un zèle aveugle et trop véhément pour la morale, par un esprit qui se trompait de terrain, – placée en face d’un roman, œuvre d’un écrivain inconnu la veille, – un roman, et quel roman ! le plus impartial, le plus loyal, – un champ, banal comme tous les champs, flagellé, trempé, comme la nature elle-même, par tous les vents et tous les orages, – la magistrature, dis-je, s’est montrée loyale et impartiale comme le livre qui était poussé devant elle en holocauste. »
= Baudelaire commence par investir, par l’imagination, l’intériorité de Flaubert :
« Je n’ai pas besoin de me préoccuper du style, de l’arrangement pittoresque, de la description des milieux ; je possède toutes ces qualités à une puissance surabondante ; je marcherai appuyé sur l’analyse et la logique, et je prouverai ainsi que tous les sujets sont indifféremment bons ou mauvais, selon la manière dont ils sont traités, et que les plus vulgaires peuvent devenir les meilleurs. »
La gageure que constituait le projet de ce roman a été scrupuleusement détaillée plus haut par Baudelaire : un lieu sans attraits : la province, un événement banal : l’adultère.
Suite de l’exposé : « Il ne restait plus à l’auteur, pour accomplir le tour de force dans son entier, que de se dépouiller (autant que possible) de son sexe et de se faire femme. Il en est résulté une merveille.»
Il y a là deux vérités fondamentales :
= « Madame Bovary, c’est moi » ; les plus anciens se souviennent peut-être de Flaubert souffrant le martyr quant il lui fallut décrire l’agonie d’Emma. Ici, fait exceptionnel dans l’art du roman : le personnage n’est pas un avatar ; c’est une créature.
= Une merveille en effet, le plus grand roman du monde, à la fois le plus émouvant et le plus parfait. Roman école, du coup, puisqu’il engendrera plus tard « Anna Karénine » et « Thérèse Desqueyrou », entre autres.
Estime réciproque, ceci dit, même si Flaubert est moins dithyrambique dans la lettre qu’il envoie à Baudelaire le 13 juillet de la même année, après que celui-ci lui ait adressé son recueil. Citation :
« Mon cher ami,
J’ai d’abord dévoré votre volume d’un bout à l’autre comme une cuisinière fait d’un feuilleton, et maintenant depuis huit jours je le relis, vers à vers, mot à mot. Et franchement cela me plaît et m’enchante.
Vous avez trouvé le moyen de rajeunir le romantisme. Vous ne ressemblez à personne (ce qui est la première de toutes les qualités) et cette l’originalité du style découle de la conception. La phrase est toute bourrée par l’idée à en craquer.
J’aime votre âpreté – et avec ces délicatesses de langage qui la font valoir, comme des damasquinures sur une lame fine.»
Suit une énumération de ses poèmes préférés, dont « Une charogne », évidemment.
Ils échangent quatre lettres et finalement, le 21 décembre de la même année, ils se rencontrent.
Si je pouvais à nouveau être inspirée… A part le fait d’être victime de la censure, ils n’ont pas grand chose en commun…
=> Gustave n’a rien d’un dandy ou d’un séducteur ; en outre c’est un travailleur acharné ; et puis, dans l’intérêt de l’oeuvre, il tient vertueusement son amoureuse Louise à distance. En outre provincial par vocation. Dévoué à Victor Hugo au point de lui servir de boîte aux lettres clandestine sous le second empire.
=> Charles, c’est à peu près le contraire ; d’abord un séducteur qui place toutes ses ressources, aussi bien matérielles que spirituelles, dans son allure et dans sa conversation. Consommateur quotidien de dawamesk mélangé au café, seul dispositif qui lui donne l’énergie d’écrire. Homme à femmes, même s’il ne parvient pas à toutes les séduire. Enfin parisien absolu, au point de grimper sur la barricade en 1848. . Néanmoins il n’aime pas « le père Hugo », comme on disait dans le salon Ancelot.
Et Louis Bonaparte au pouvoir, ça l’a simplement « dépolitiqué » comme il dit.
Au moins ils n’ont pas dû manquer de sujets de conversation ; et puis, au cas où ils seraient allés jusqu’aux confidences, ils se seraient l’un et l’autre, découvert une soeur tendre et attentionnée dont ils adorent recevoir les lettres.
Tout compte fait 1857 n’est pas une si mauvaise année puisque l’abominable général Aupick a eu le bon goût, le 27 avril, de casser sa pipe.
2) Les épaves
Pourquoi ces six poèmes-là ? Voici les attendus 101 du jugement : « les pièces incriminées conduisent nécessairement à l’excitation des sens par un réalisme grossier et offensant pour la pudeur ».
Baudelaire les fera publier en 1866, à Amsterdam, alors qu’il a fui Paris et ses huissiers ;après quoi il trouvera refuge en Belgique.
Le recueil intitulé « Les épaves », comporte, outre les six pièces condamnées, quatre autres parties, le tout étant introduit par un sonnet, intitulé « Le coucher de soleil romantique ».
101 Motifs donnés par les juges de première instance.
Ce poème-là pourrait bien constituer l’épilogue de la partie maîtresse des « Fleurs du Mal », intitulée « Spleen et idéal ».
Dans le recueil initial celle-ci était vouée à détailler, de toutes les façons possibles, le combat sans trêve entre les aspirations célestes à la beauté – l’Idéal – est l’enchaînement terrestre dans la fange de la matière : le spleen.
Ce sonnet c’est celui de l’évanouissement du soleil et du triomphe de la noirceur.
Les tercets :
Mais je poursuis en vain le Dieu qui se retire ; L’irrésistible Nuit établit son empire,
Noire, humide, funeste et pleine de frissons ;
Une odeur de tombeau dans les ténèbres nage,
Et mon pied peureux froisse, au bord du marécage, Des crapauds imprévus et de froids limaçons
Ce poème qui, il faut le répéter, ne fait pas partie des « épaves », devait servir d’épilogue à un livre de Charles Asselineau qui n’a finalement pas été édité ; de là son titre.
Devenu prologue, il prend un tout autre sens.
De façon cruelle, pour ne pas dire diabolique, ces poèmes ôtés de l’édifice poétique des Fleurs avaient seulement vocation à marquer des moments de doute dans la quête de la beauté.
Mais du coup, les voici devenus, une fois rassemblés, l’incarnation de l’irrésistible pesanteur de la mesquinerie humaine qui entraîne le basculement dans le mal.
Le premier poème à s’attirer les foudres de Pinard est « Lesbos » ; il se focalise sans doute sur les amours des lesbiennes qui sont le thème de ses 9 premières strophes. Pourtant là n’est pas l’essentiel ; à la 10° strophe on bascule de la mer Égée à la mer ionienne, de Lesbos à Leucade.
Pourquoi ? Parce que Sapho qui s’était laissé séduire par le jeune Phaon, avait voulu se débarrasser de cet amour qui l’arrachait à tout ce qui, jusque là, avait fait sa vie d’amoureuse et de poétesse.
Alors elle appliqua la recette de l’époque pour se délivrer d’un amour déchirant : faire le saut de Leucade, autrement dit se jeter dans la mer du point le plus élevé de la côte de cette île. Si l’on survivait, on était guéri. Sapho mourut.
Ce que Baudelaire conte par le moyen de ce fantôme attachant, c’est sa propre détresse amoureuse – probablement du fait du refus de Marie Daubrun – et la tentation durable par où il passa, d’en finir avec la vie.
C’est probablement ce qui explique les dernières strophes, celles-ci en particulier :
Pour savoir si la mer est indulgente et bonne, Et parmi les sanglots dont le roc retentit
Un soir ramènera vers Lesbos, qui pardonne, Le cadavre adoré de Sapho, qui partit
Pour savoir si la mer est indulgente et bonne !
(…)
De Sapho qui mourut le jour de son blasphème, Quand, insultant le rite et le culte inventé,
Elle fit son beau corps la pâture suprême
D’un brutal dont l’orgueil punit l’impiété
De celle qui mourut le jour de son blasphème.
Même élision, par la censure, de l’essentiel dans le poème suivant. Celui-ci d’abord intitulé « Delphine et Hippolyte » paraît annoncer d’abord les amours de deux lesbiennes ; ce n’est pas le cas.
Dans l’édition des Épaves le titre de « Femme damnée » chapeaute le titre initial, histoire de faire comprendre de quoi il est question aux lecteurs style Pinard, toujours prêts à s’insurger.
En réalité on a quasiment une tragédie racinienne ramassée en 26 quatrains. En voici les mouvements :
=> Hippolyte est, pour la première fois, en proie aux vagues émotions érotiques de l’adolescence qui travaillent son corps sans que son âme y ait prise.
=> Delphine à ses pieds attend le moment opportun pour la couvrir de ses caresses. => Elle s’allonge près d’elle et plaide sa cause en évoquant la brutalité des amours masculines.
=> Hippolyte est déchirée entre sa naissante attirance pour Delphine et le sentiment de l’incongruité que comporterait une telle relation.
=> Delphine, brièvement traversée par une déconvenue qui frise la colère, l’invite, en ces termes, à prendre le large :
Va, si tu veux, chercher un fiancé stupide ;
Cours offrir un cœur vierge à ses cruels baisers ; Et, pleine de remords et d’horreur, et livide,
Tu me rapporteras tes seins stigmatisés…
=> Du coup, comme saisie par la peur, Hippolyte se réfugie dans les bras de Delphine.
=> Alors une sorte de coryphée102 prend la parole et prononce leur damnation. Les deux derniers quatrains en laisse émerger le motif :
102 Chef du choeur dans la tragédie antique.
L’âpre stérilité de votre jouissance
Altère votre soif et roidit votre peau,
Et le vent furibond de la concupiscence
Fait claquer votre chair ainsi qu’un vieux drapeau.
Loin des peuples vivants, errantes, condamnées, À travers les déserts courez comme les loups ; Faites votre destin, âmes désordonnées,
Et fuyez l’infini que vous portez en vous !
On aura compris que l’infini que portent en elles ces femmes qui ont rejeté toute forme de liaison avec un homme, c’est celui des générations. C’est la puissance d’enfanter qui embellit leur corps quand elles sont enceintes et c’est la stérilité perpétuelle qui le vieillit prématurément.
F Le périple d’Ulysse
Après la déconvenue de la réception des « Fleurs du mal » Baudelaire se remet au travail. Sans doute est-il soutenu par sa mère, avec laquelle il s’est enfin réconcilié, et par cette décision étonnante du Ministère de l’Instruction publique qui lui adresse une aide de 100 frs.
Quel est donc le bon ange qui veille alors sur lui ? Qu’est-ce qui permet cette réconciliation avec sa mère ? Qui sollicite des pouvoirs publics, après le procès en atteinte à la morale publique et religieuse, afin que lui soit accordée cette aide ?
Peut-être, à nouveau la charitable impératrice…
I Les tribulations du navigateur à vue
En 1859 Jeanne est victime d’une attaque d’hémiplégie. Charles commence par lui porter assistance en la faisant admettre dans une maison de santé. Quelques mois plus tard il reprendra la vie commune avec elle, cette fois, enfin, par pur amour de sollicitude.
Du coup il se remet à travailler avec ardeur. Il met en chantier « Mon coeur mis à nu », vieux projet de relever, on s’en souvient, le défi lancé par Edgar Poe. Après quoi il publie coup sur coup « Petits poèmes en prose » (1859) et « Les Paradis artificiels » (1860).
Comme décidément il faut faire contre mauvaise fortune bon coeur, il remanie « Les Fleurs du Mal », ôtant les six poèmes condamnés et en ajoutant de nouveaux, dont « Le Cygne », étrange poème composite dédié à Victor Hugo, interpelant Andromaque et décrivant le Paris d’Haussmann en voie d’édification…
A moins de supposer qu’Andromaque désigne métaphoriquement Paris et Hector, qu’elle pleure, Victor Hugo, absent du fait de l’exil.
Enfin Théodore de Banville lui tend la main en publiant, dans La Revue fantaisiste, quelques uns des Poèmes en prose.
Baudelaire rédige un autre article, cette fois sur Wagner. Il avait assisté, quelque temps plus tôt, à un concert au Théâtre des Italiens où se donnait quelques unes des oeuvres du compositeur récemment établi à Paris
Baudelaire littéralement enthousiasmé, découvre avec horreur de féroces critiques dans les journaux. Du coup il prend sa défense dans l’article et lui adresse aussi une lettre éloquente : « Avant tout, je veux vous dire que je vous dois la plus grande jouissance musicale que j’aie jamais éprouvée. »
Mais en 1861 Jeanne et lui se séparent à nouveau et il fait une tentative de suicide. C’est qu’entre temps un prétendu frère de Jeanne avait fait son apparition avant de disparaître après avoir vendu une partie de ses meubles.
Charles, sans en être tout à fait conscient, avait retrouvé dans le soutien sans faille qu’il apportait à sa maîtresse, l’estime de lui-même et le sentiment d’être enfin engagé dans la bonne voie.
Si ensuite il retrouve en partie ses vieux démons – par exemple la blague ou le coup de folie de sa candidature à l’académie française – il a pourtant atteint une certaine maturité et reprend ses travaux. Du reste il continue à envoyer de l’argent à Jeanne.
L’année suivante, 1862, il l’entraîne dans l’atelier de Manet qui en fait en quelques heures un portrait fameux qu’il intitulera « La maîtresse de Baudelaire » Enfin, on ne sait pourquoi ni comment, Jeanne disparaît de la vie de Baudelaire. Quelques témoins l’auraient aperçue dans la rue, vingt ans plus tard, avançant péniblement sur des béquilles.

Son enthousiasme artistique pour Constantin Guys le distrait un temps de son désarrois ; il publie, stimulé par cette oeuvre étonnante, « Le peintre de la vie moderne »103, essai à forte teneur philosophique dans lequel le génial aquarelliste 104 n’est désigné que par ses initiales, celui-ci ayant demandé l’anonymat.
Un passage sur l’essence du beau : « (…) Stendhal, esprit impertinent, taquin, répugnant même, mais dont les impertinences provoquent utilement la méditation, s’est rapproché de la vérité, plus que beaucoup d’autres, en disant que le Beau n’est que la promesse du bonheur. »
_____________ 103 Synthèse de trois articles que le Figaro avait finalement publiés après plusieurs tentatives dans d’autres journaux. 104 A cette adresse une présentation de quelques une de ses oeuvres, malheureusement assez orientée : https://www.youtube.com/watch?v=4fGDOYT28HQ Il est bien difficile de choisir parmi ces dizaines d’oeuvres croquées prestement ; c’est toute une époque qui revit.
Et puis c’est à nouveau le marasme… rien de lucratif pendant deux ans, à part quatre poèmes en prose publiés par le Figaro dont la rédaction veut décidément se faire pardonner les odieuses critiques qui avaient condamné sans appel « Les Fleurs de mal ».
Quoique sa mère lui envoie régulièrement de l’argent, ses dettes s’accumulent. En 1864 Baudelaire part pour la Belgique, à la fois pour fuir les huissiers et récolter le pactole qu’on lui a promis là-bas : une série de conférences rétribuées 500 francs or par séance. Flop de la première conférence : il n’y a que 20 personnes et 8 d’entre elles partent avant la fin. Les organisateurs ramènent la rétribution à 100 francs.
Comme il ne peut pas rentrer en France on imagine qu’il emploie ses ruses habituelles pour se loger et se nourrir. Evidemment ça ne peut durer qu’un temps. Du coup il prend les Belges en grippe et commence à rédiger un pamphlet fulminant intitulé « Pauvre Belgique ».
Victor Hugo, toujours en exil à Guernesey, est venu visiter son épouse et ses enfants à Bruxelles. Et les Hugo invitent Baudelaire à leur table.
Précisons que deux ans plus tôt celui-ci avait publié dans Le Boulevard une critique enthousiaste des Misérables, allant jusqu’à écrire : « (…) cette dispute de l’homme contre lui-même (Tempête sous un crâne), contient des pages qui peuvent enorgueillir à jamais non seulement la littérature française, mais même la littérature de l’Humanité pensante. »
C’est le chapitre où Jean Valjean, devenu l’honorable M. Madeleine, se demande s’il doit se dénoncer pour sauver un certain Champfleury que l’on a arrêté en le prenant pour lui. Sacrifice conséquent auquel il finira par consentir puisqu’il renonce par là à toute la vie qu’il s’était patiemment bâtie.
Baudelaire est évidemment sensible à ce déchirement qu’engendre l’idéal. Ce ne fut pas, comme on l’a vu en son temps, le cas de Flaubert lequel prit sans barguigner le parti de Victor Hugo contre Napoléon III.
Pour autant Victor Hugo a-t-il été sensible à la quête d’absolu sous-jacente aux « Fleurs du mal » ? Il le semble bien si l’on se fie à la lettre du 30 avril 1857, envoyée depuis Hauteville-house :
« J’ai reçu votre noble lettre et votre beau livre. L’art est comme l’azur, c’est le champ infini ; vous venez de le prouver. Vos Fleurs du Mal rayonnent et éblouissent comme des étoiles. Je crie bravo de toutes mes forces à votre vigoureux esprit. Permettez-moi de finir ces quelques lignes par une félicitation. Une des rares décorations que le régime actuel peut accorder, vous venez de la recevoir. Ce qu’il appelle sa justice vous a condamné au nom de ce qu’il appelle sa morale ; c’est là une couronne de plus. Je vous serre la main, poète. »
Certes tout ce qui s’oppose à « Napoléon le petit » va droit au coeur de l’exilé. Mais il y a aussi, dans cette reconnaissance, l’ouverture de cet esprit audacieux, soutenu par une imagination infinie, et qui survole infatigablement les siècles et les espaces, bâtissant du sens pour cette humanité souffrante et orpheline, dans un univers ténébreux.
Sans parler de l’expérience graphique de la création de profonds paysages, avec seulement quelques feuilles et un peu d’encre.
L’invitation de Victor Hugo, après cette lettre laudative, c’est sans doute le dernier bonheur de la vie de Baudelaire. Quelques jours après ce repas, il a invité Poulet- Malassis, l’un de ses éditeurs, à visiter une église de Namur…
Et puis… « il chancela, pris d’un étourdissement subit, et alla s’abattre sur une marche. Ses amis le relevèrent ; il ne parut pas s’effrayer et prétendit que le pied lui avait glissé. On feignit de le croire ; mais le lendemain matin, en se levant, il donna des signes de trouble mental . On le ramena en hâte à Bruxelles : à peine monté dans le wagon, il pria qu’on ouvrît la portière ; or, elle était ouverte. Il avait dit le contraire de ce qu’il voulait dire. L’aphasie, dont il fallait voir là un indéniable prodrome, ne tarda pas à se déclarer.105»
____________ 105 « Charles Baudelaire, étude biographique » Eugène Crépet
Hospitalisé à Bruxelles, il ne lui reste plus que le plaisir de lire. Sa mère le rejoint et le ramène à Paris. Accueilli dans la clinique du docteur Duval, il est visité chaque jour par celle-ci et ses amis.
Baudelaire a souffert d’une hémiplégie transitoire et partielle qu’il a surmontée à l’aide d’une canne. Son gros problème, c’est la parole. Souvent il ne peut prononcer qu’une seule syllabe ; il tente d’abord de la faire varier pour s’efforcer de la charger de sens ; et puis, quand il ne le peut pas, il utilise d’abord le ton et puis les gestes.
Les amis sont optimistes, envisageant même de lui faire écouter un peu de Wagner pour hâter sa guérison. Nadar y parvient ; voici ce qu’il en rapporte :
« Il avait toujours eu le culte de son corps ; à peine arrivé chez moi, il me montrait ses mains et il fallait que, manches retroussées, avec le savon, la brosse, la lime, je les fisse plus nettes et plus polies encore que ne les avaient obtenues, une demi-heure auparavant, les soins de l’infirmière.
Oh crènom crénom ! s’exclamait-il, joyeux, en les faisant jouer dans la lumière. Un soir, il réclama avec tant d’insistance d’entendre un morceau de Tannhauser dont je n’avais pas la partition, qu’on alla réveiller l’éditeur.
Crénom ! Crénom ! répétait-il avec extase.
Et, la dernière fois que je le vis, à la maison Duval, nous disputions de l’immortalité de l’âme. Je dis nous, parce que je lisais dans ses yeux aussi nettement, moi, que s’il eût pu parler « Voyons, comment peux-tu croire en Dieu ? » répétais-je.
Baudelaire s’écarta de la barre d’appui où nous étions accoudés, et me montra le ciel. Devant nous, au-dessus de nous, c’était, embrasant toute la nue, cernant d’or et de feu la silhouette puissante de l’Arc de Triomphe, la pompe splendide du soleil couchant.»
Plus tard il parvient même à dire « Bonjour, monsieur… bonsoir, monsieur » ; quelque temps plus tard « la lune est belle ».
Bientôt, pourtant, il ne veut plus quitter son lit ; il ne reconnaît plus ses amis.
Le 1° septembre 1867 Charles Asselineau écrivait à Poulet-Malassis :
« C’est fini. Il est mort hier, à onze heures du matin, après une longue agonie, mais douce et sans souffrance. Il était d’ailleurs si faible qu’il ne luttait plus. »
Il faudra encore du temps pour qu’on comprenne qui venait de mourir et plus encore pour que l’on sorte de la légende mensongère d’un Baudelaire mécréant.
II Benjamin Fondane ou l’hommage absolu
« (..) l’ivresse de l’art est plus propre que toute autre à jeter un voile sur les terreurs du gouffre ». A partir de cette affirmation formulée dans l’un des « poèmes en prose » du Spleen de Paris, intitulé « Une mort héroïque » et du poème intitulé « Le gouffre », Benjamin Fondane va organiser le remarquable essai qu’il consacre à Baudelaire : « Baudelaire et l’expérience du gouffre », essai qu’il n’eut pas le temps d’achever.
Juif d’origine roumaine, naturalisé français, il fut arrêté et déporté à Auschwitz en mai 1944. Il aurait pu être sauvé, trois amis étant intervenus en sa faveur avec succès ; mais il refusa d’abandonner sa soeur qui avait également été arrêtée.
Ce gouffre, Fondane le recrée dans un poème intitulé « Ulysse ».
Ce qui justifie ce choix, ce pourrait être l’invocation du voile salvateur par Baudelaire. L’un de ses « Petits poèmes en prose », intitulé « Une mort héroïque », est un apologue de ce pouvoir surnaturel de l’art.
Baudelaire y raconte l’histoire de Fancioulle, bouffon bien aimé de son prince, mais qui a pourtant pris part à une conspiration contre lui. Les conspirateurs sont arrêtés et condamnés à mort. A Fancioulle le prince propose pourtant de sauver sa vie en donnant une belle représentation.
Le bouffon joue alors de façon sublime ; seulement comme le prince ne peut pas lui pardonner, il fait signe à un enfant d’interrompre la représentation par un coup de sifflet. Aussitôt que le sifflet retentit Fancioulle s’écroule, mort.
Ce voile est donc bien plus que l’outil d’une dissimulation. C’est justement celui du récit homérique, voile dont la déesse Leucothée enveloppe Ulysse pour le sauver de la noyade à laquelle Poséidon l’avait condamné en provoquant la tempête qui avait disloqué son radeau.
Ce poème, Fondane en compose les derniers vers avant d’être enfourné dans la chambre à gaz. Rappelons qu’il avait choisi d’accompagner sa soeur dans ce train de la mort alors qu’il aurait pu sauver sa vie.
La terre quelque part. C’est la même folie
et la même insomnie et c’est la même lampe. Oh ! finir proprement en un coin de l’estampe Et que le vent t’emporte, duvet du pissenlit…
Non ce n’est rien… Pitié des hommes. et de moi-même ! Je n’ai plus que mon sang pour t’allaiter, poème
Tu es si lasse, ô voix qui crie dans les déserts
Mon cœur est-il vraiment trop lourd pour ces vendanges ? Meurt-t-on sur le savoir sur la cuisse des anges ?
Dieu, dans sa propre nuit, a-t-il les yeux ouverts ?
Ulysse, il nous faudra nous quitter ; la terre cesse… Les rats, depuis longtemps nous ont rongé les cordes et les mouettes, picoré la cire de nos oreilles
liés par nous-même, c’est trop !
Veux-tu que l’on se jette à la mer – librement ? J’ai hâte d’écouter la chanson qui tue !…
Benjamin Fondane n’a pas eu le temps d’achever son poème.
On ne sait qui a sauvé ces derniers feuillets ; peut-être André Montagne, celui qui a partagé sa captivité et raconté ses derniers jours dans une lettre adressée à la revue « Les Lettres françaises » en avril 1946.
Sa femme Geneviève, qui a recueilli les témoignage de ses co-détenus, a également appris que : « jusqu’au bout, il resta l’homme qu’il avait été, qu’il vécut sa philosophie. Il trouva le moyen de poursuivre des discussions passionnées avec d’autres détenus et sa prodigieuse mémoire poétique lui permit de réciter Baudelaire, interminablement. »106 et aussi « qu’il tentait de réconforter ses compagnons, qu’il continuait à écrire des poèmes. »
_____________ 106 d’après une compilation réalisée par Monique Jutrin, dans son article « Poésie et tragique : la poésie irrésignée de Benjamin Fondane »
La dernière image que nous ayons de Fondane nous est livrée par André Montagne : « Le lundi 2 octobre, dans l’après-midi, les camions vinrent chercher ceux qui avaient été désignés pour la chambre à gaz. Je vois encore Fondane sortir du block, passer très droit devant les SS, fermant le col de sa veste pour se protéger du froid et de la pluie, monter dans le camion »
Comment et pourquoi Baudelaire est-il doté, par l’homme exceptionnel que fut Benjamin Fondane, de ce pouvoir de surplomber le gouffre ?
Il faut revenir au poème de Baudelaire :
Le gouffre
Pascal avait son gouffre, avec lui se mouvant. – Hélas ! tout est abîme, – action, désir, rêve, Parole ! et sur mon poil qui tout droit se relève Maintes fois de la Peur je sens passer le vent.
En haut, en bas, partout, la profondeur, la grève, Le silence, l’espace affreux et captivant…
Sur le fond de mes nuits Dieu de son doigt savant Dessine un cauchemar multiforme et sans trêve.
J’ai peur du sommeil comme on a peur d’un grand trou, Tout plein de vague horreur, menant on ne sait où ;
Je ne vois qu’infini par toutes les fenêtres,
Et mon esprit, toujours du vertige hanté, Jalouse du néant l’insensibilité.
Ah ! ne jamais sortir des Nombres et des Etres !
On aura compris que ce gouffre n’est pas seulement celui de la mort, si du moins celle-ci est anéantissement pur et simple. Il faut lire le dernier vers dans ce sens : « n’être jamais sorti des Nombres et des Êtres » ; autrement dit être délivré pour toujours du poids d’exister ou mieux encore, n’être jamais advenu à l’existence.
C’est aussi, à reprendre la grille de lecture de Fondane, l’abîme de la mer transmuée par les sirènes, elle-même métaphore d’un gouffre qui est à la fois celui du sens et, simultanément, cet espace improbable où quelque chose d’autre que la banalité du quotidien se laisse entrevoir, où l’être surgit dans son mystère, mystère tel que seule la parole poétique peut espérer en restituer le reflet.
Si la figure d’Ulysse constitue l’axe du long poème éponyme de Fondane, le périple odysséen peut être, quoique plus secrètement, tenu pour l’une des trames des « Fleurs du mal ». D’abord parce qu’il est ordonné selon l’axe du temps, allant de la naissance du poète aux multiples façons dont la vie peut s’achever. Ensuite parce que plusieurs figures métaphoriques appartiennent effectivement à l’Odyssée.
Nous avions évoqué la Circé du « Voyage », femme capable de transformer le poète devenu Ulysse, en bête, voire en monstre. Façon, dans ce Voyage – qui est, rappelons-le, celui de la vie – d’évoquer un autre gouffre : les pulsions meurtrières que Jeanne, « diabolique » comme il est dit, faisaient occasionnellement surgir en Charles. L’abîme, c’est aussi celui du mal qui peut aller jusqu’à donner la mort.
On trouve encore, dans l’Hymne à la beauté, ces vers éloquents :
Que tu viennes du ciel ou de l’enfer, qu’importe, O Beauté ! monstre énorme, effrayant, ingénu ! Si ton œil, ton souris, ton pied, m’ouvrent la porte D’un Infini que j’aime et n’ai jamais connu ?
De Satan ou de Dieu, qu’importe ? Ange ou Sirène,
Qu’importe, si tu rends, – fée aux yeux de velours,
Rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine ! –
L’univers moins hideux et les instants moins lourds ?
Ce sont probablement ces vers qui ont inspiré à Benjamin Fondane l’idée de « l’expérience du gouffre » comme cruciale pour Baudelaire.
Partant de cette image récurrente du Poète attaché au mat de son navire – c’est-à-dire à la réalité triviale – pour de ne pas sombrer dans l’abîme qui pourrait être cette fois celui du λόγος et donc du pouvoir d’énoncer, il peut concevoir la tension douloureuse qui a dû être la sienne entre la beauté du chant des sirènes – en d’autres termes le « monstre énorme » qu’est la Beauté en soi – et cette trivialité du quotidien à laquelle il doit pourtant resté arrimé s’il veut conserver le pouvoir de dire.
La beauté est une promesse de sens. Fondane, apôtre et martyr, proclama jusqu’au bout l’évangile de Baudelaire, le seul qui fût encore audible derrière les barbelés d’Auschwitz.
Horreur absolue et hommage absolu.
Conclusion
On connaît la véritable dévotion de Mallarmé pour Baudelaire. Mais Verlaine lui aussi, dans une authentique étude qui restera inédite de son vivant, l’a lu de la première à la dernière ligne et parfaitement compris.
C’est dans la préface de Théophile Gautier aux Fleurs du mal qu’il trouve l’expression la plus ramassée de la conception baudelairienne de la poésie qu’il cite dans son étude 107 et dont il fera aussi la sienne : « Le principe de la poésie est, strictement et simplement, l’aspiration humaine vers une beauté supérieure et la manifestation de ce principe est dans un enthousiasme, une excitation à l’âme – enthousiasme tout à fait indépendant de la passion qui est l’ivresse du cœur, et de la vérité qui est la pâture de la raison. »
______________ 107 éditée dans « Oeuvres posthumes », chapitre intitulé « Baudelaire ».
Verlaine, Mallarmé… c’est toute la modernité poétique qui s’annonce dans cette filiation. Plus tard André Breton en fera la source du surréalisme.
Ceci dit, Baudelaire survivant ne se cantonne pas à la poésie : Nietzsche sera aussi son lecteur assidu et, plus tard, Léo Ferré mettra en musique 12 de ses poèmes. Enfin en 1996 ses oeuvres en prose 108 fourniront à Jean-Louis Cloët la matière d’une pièce de théâtre intitulée « Baudelaire mis à nu ».
_____________ 108 « Fusées », « Mon coeur mis à nu »
Mais Baudelaire vivant, c’est sous la plume de notre dernier grand poète qu’on le trouve : Yves Bonnefoy.
Dans son livre « Sous le signe de Baudelaire », publié en 2011, il dispose tous les éléments du long dialogue qu’il eut avec lui pendant plus de 50 ans.
Enfin, en 2012 il donne une conférence au Collège de France, « Baudelaire moderne et anti-moderne » dans laquelle il rassemble, en préalable à l’étude de trois poèmes, l’essentiel de sa pensée.
En voici la transcription :
« La poésie n’est pas la littérature. Pour penser, pour agir, nous avons recours à la pensée conceptuelle. Or qu’est-ce que la littérature sinon une activité de l’esprit qui, certes, se porte constamment au delà du discours ordinaire, toujours requis par des tâches délimitées, afin d’explorer et d’analyser de façon plus libre, les rapports d’une personne et du monde ambiant, mais qui n’en utilise pas moins les réseaux de concepts qui constituent la langue commune. (…) les concepts qui généralisent ne savent pas exprimer le rapport à soi de l’être particulier, son sentiment de la finitude. Et la poésie, au contraire, c’est ce qui tient ce rapport à soi pour l’unique réalité, parce que c’est à son niveau seulement que peut pleinement s’établir la relation du moi avec l’autre, qui est ce qui fonde la société et même bâtit le monde, lequel n’est pas la chose naturelle qui nous entoure mais le sens que nous décidons d’y porter. Et elle va chercher, par un autre emploi des mots, rythmé, musical, à délivrer les vocables fondamentaux de la langue, de leur réquisition par le conceptuel, ce qui permettra peut-être d’empêcher le langage d’ensevelir l’être humain sous des termes et des formules qui ne diront plus que la matière, faute d’avoir souci d’autre chose.
La poésie se distingue de la littérature comme le désir d’être se distingue de la gestion de l’avoir. Elle ne cherche pas des significations mais le sens, le sens qu’il y a à vivre. Et c’est pourquoi la société a besoin, et surtout aujourd’hui, grand besoin d’elle. (…) la poésie n’est pas facile, (que) le conceptuel se glisse toujours dans la parole qui le dénie (…) les poètes sont constamment à se laisser envahir par les rêves que les concepts nous permettent et c’est alors oublier leur dessein de rénovation de l’être au monde au profit de simples poèmes.
En fait il n’y a pas de poésie ; il n’y a que des ressaisissements par lesquels un auteur de poèmes se remémore son intuition première afin d’en reprendre le projet.
Et pourquoi Baudelaire nous importe, pourquoi il faut lire Baudelaire… C’est parce que, captif comme tout un chacun d’imaginations spécifiquement littéraires, il a su, à certains moments, se ressaisir, de la façon la plus radicale, se faisant alors pour nous un exemple infiniment méditable. »
Pourquoi Baudelaire ?
Parce qu’il est, de tous les poètes, celui qui a le plus approché l’essence de la poésie. Tout est dit…
Ou presque.
Ajoutons quand même que le « Baudelaire » de Sartre est un tour de force d’escroc, comme le reste de son oeuvre, à une exception près 109. Citation :
« C’est dans l’effort et le travail que ce paresseux voit l’apanage de l’écrivain, non dans la spontanéité créatrice. Ce goût pour la minutie dans l’artifice permet de comprendre qu’il ait passé de si longues heures à corriger un poème, même fort ancien, et fort éloigné de son humeur, plutôt que d’en écrire un nouveau. Retravailler un texte longtemps après le délivrait des contraintes de l’émotion et de la circonstance, il était alors libre. »
Reprocher à Baudelaire de passer trop de temps à travailler ses poèmes c’est reprocher à Léonard de Vinci de manier trop longtemps ses pinceaux ou à Mozart de se mettre trop souvent au piano. En d’autres termes, c’est passer à côté de l’essentiel.
____________ 109 « Les mots », autobiographie parue en 1963.
Yves Bonnefoy a justement montré comment la « spontanéité créatrice » pouvait être illusoire, se plaçant comme automatiquement dans l’enchaînement littéraire des concepts.
Il est vrai que Sartre, avec ses 10 comprimés de Corydrane 110 tous les matins, en connaissait un rayon en matière de « spontanéité créatrice ». Voilà pourquoi toute son oeuvre ne vaut pas un seul poème de Baudelaire.
_______________ 110 Stimulant constitué d’un mélange d’aspirine et d’amphétamine.
En voici un, justement, pour finir :
Les plaintes d’un Icare
Les amants des prostituées
Sont heureux, dispos et repus ;
Quant à moi, mes bras sont rompus
Pour avoir étreint des nuées.
C’est grâce aux astres nonpareils,
Qui tout au fond du ciel flamboient,
Que mes yeux consumés ne voient
Que des souvenirs de soleils.
En vain j’ai voulu de l’espace
Trouver la fin et le milieu ;
Sous je ne sais quel oeil de feu
Je sens mon aile qui se casse ;
Et brûlé par l’amour du beau,
Je n’aurai pas l’honneur sublime
De donner mon nom à l’abîme
Qui me servira de tombeau.
Nous savons désormais à quel point ces vers restituent authentiquement la quête de toute la vie de notre poète.
Ironie du sort : il y a deux stèles où figure le nom de Charles Baudelaire au cimetière de Montparnasse. Son corps repose dans la tombe familiale, qui fut d’abord celle de Jacques Aupick, sous la mention suivante : « Charles Baudelaire, son beau-fils, décédé à Paris à l’âge de 46 ans, le 31 août 1867 ».
Voilà pourquoi sans doute ceux qui l’aimaient ont fait ériger plus loin, dans ce cimetière, un cénotaphe où ils ont fait graver simplement le nom de Baudelaire. Le jour où on le comprendra enfin ses restes trouveront au Panthéon une demeure enfin digne de lui.
_____________________________________________________________________________________________________
Table des matières
A Jeunes années
I Enfance lumineuse II Sombre jeunesse
1) L’interne
2) Sarah la louchette
3) Les voyages forment la jeunesse
B Outre-mer
C Entrée en écriture
I Mineur à vie II Des brochures et un roman
1) En quête du paradis 2) Ut pictura poesis 3) La Fanfarlo
D Baudelaire, l’homme justement I Le croyant
II Le sensible
1) L’art de dire 2) Trois poèmes en prose a) La belle Dorothée b) La fausse monnaie c) Une veuve
III Le compliqué
E Le maître-livre de notre poésie I Une grande variété d’écrits
1) Edgar Poe, frère d’âme et d’esprit 2) Divers essais
a) « Les drames et les romans honnêtes »
b) « L’école païenne », un article réactionnaire c) « La morale du joujou »
e) A propos de l’exposition de 1855
II Le centre de gravité de l’oeuvre 1) La rupture 2) Le cycle Jeanne Duval dans la version originelle a) Hymne à la beauté b) Parfum exotique
c) La chevelure
d) Je t’adore à l’égal de la voûte nocturne
e) Tu mettrais l’univers entier dans ta ruelle. f) Sed non satiata g) Avec ses vêtements ondoyants et nacrés h) Le serpent qui danse
i) Une charogne
j) De profundis clamavi k) Le vampire
l) Une nuit que j’étais près d’une affreuse juive m) Remords posthume
n) Le chat
o) Le Léthé
p) Le balcon
q) Je te donne ces vers
III Le reste de l’édifice 1) L’entrée et la sortie a) Les deux premiers poèmes b) A Maxime du Camp 2) Deux autres cycles amoureux a) Le cycle Marie Daubrun b) Le cycle Apollonie Sabatier 3) Au lecteur
IV Six scandaleux poèmes
1) Le procès et ses suites 2) Les épaves
F Le périple d’Ulysse
I Les tribulations du navigateur à vue
II Benjamin Fondane ou l’hommage absolu
Conclusion





